 De René Barjavel, 1943.
De René Barjavel, 1943.
Barjavel, Barjavel… Voilà un auteur que je n’avais plus lu depuis mon adolescence. Je me souviens encore du Grand Secret et de la Nuit des Temps que j’avais trouvé passionnants du haut de mes 12 ou 13 à l’époque. Licencieux aussi, puisque Barjavel était, dans mon souvenir, un fervent défenseur de l’amour libre. Ces lectures, avec les sages descriptions charnelles de Christian Jacq dans ses diverses œuvres égyptiennes, sont des souvenirs de lecture que je conserve encore dans un coin de ma tête depuis plus de 25 ans maintenant. J’avais donc un apriori favorable en prenant Ravage entre les mains, mâtiné sans doute d’une certaine crainte de ne pas y retrouver l’impact de mes souvenirs. Sur le papier, en plus, le livre à tout pour me plaire : vendu comme de la SF (ou, en tous les cas, comme de l’anticipation), contexte apocalyptique, texte pionnier, etc.
Puis vint la lecture de ladite œuvre. Le malaise qui s’en suivi. Et quelques recherches pour vérifier si rien ne m’avait échappé. Évacuons le résumé du scénario rapidement : François Deschamps est un jeune ingénieur de province qui monte sur Paris rechercher sa belle en l’an de grâce 2052. La société a évolué vers le tout automatique et le tout industriel, les villes s’étant élevées dans les cieux sans parvenir à réduire les inégalités de classe, plus importantes que jamais. La belle en question, Blanche Rouget, du haut de ses 17 ans, a cependant succomber aux attraits des médias tout puissants. Elle doit devenir une starlette de la radio (le média tout puissant en question). Le conflit latent entre l’ingénue, l’intriguant producteur qui essaie de la mettre dans son lit et son donjuan provincial, grand, musclé et fort semble être le nœud de l’intrigue, entrecoupé de quelques passages édifiants où Barjavel glose sur les évolutions de la société future qu’il imagine.
Puis vient la catastrophe : la grande nation noire de l’Amérique du Sud, établie par des descendants des esclaves africains chassés des États-Unis, déclare la guerre au monde. Grâce à une technologie inconnue, ils parviennent à mettre à mal tous les outils et instruments fonctionnant à l’électricité. La société verse alors rapidement dans le chaos. François prend à ce moment la tête d’une équipe de survivant pour quitter la ville foyer d’infection et de mort pour tenter la traversée de l’hexagone à pied et rejoindre ainsi sa Provence natale où il espère un retour à la terre et à un bon sens agraire. Ce qu’il achève en devenant dans une dernière partie plus courte une sorte d’autocrate semi-religieux pour tout le Sud de la France.
Et je vous assure que j’ai édulcoré au maximum les deux derniers paragraphes pour éviter de choquer les âmes sensibles. Ce que je ne vais plus faire à partir de maintenant. Ravage est un mauvais livre. Il n’y a pas d’autre façon de le dire. Si, en fait. J’aurais pu utiliser le terme de torchon. Raciste, misogyne et ayant des relents de Vichy-sme tellement puissants que c’est à se demander si l’ouvrage n’est pas une commande du Maréchal lui-même. Pour être honnête, lorsque j’ai fermé le bouquin, avec le même sentiment dérangeant dans le ventre qu’en fermant Rêve de Fer il y a quelques années, je me suis demandé si je n’avais pas simplement mal compris le message. Si l’ironie de l’ensemble ne m’avait pas échappé. Si la critique acerbe (et parfois amusante, il faut le concéder) que Barjavel fait de la société de 2052 n’était pas simplement poussée à l’absurde dans le régime rétrograde et obscurantiste mis en place à la fin du roman par son héros. C’est la thèse des ardents défenseurs de Barjavel, en tous les cas.
Mais… Force est de constater que si moqueries il y avait au début du roman, parfois d’ailleurs assez gauches et simplistes, le ton de la fin du livre est on ne peut plus sérieux. Le parallèle avec Rêve de fer est frappant : le livre de Spinrad n’est jamais drôle. Il est horrible de bout en bout. Son exagération et son mécanisme fasciste poussé à l’extrême indique clairement au lecteur qu’il s’agit d’une satire. D’une allégorie aussi affreuse que vomitoire, mais d’une allégorie malgré tout. Barjavel, de son côté, se veut presque prophétique quand il transforme son François en figure tutélaire, en autorité morale d’un régime autocratique inspiré de quelques principes de la chrétienté défigurés par une morale puante. L’homme de demain, paysan par essence, se doit d’avoir plusieurs femmes dont le rôle se limite à beaucoup enfanter. Les livres sont brûlés car responsables de la dégénérescence de la saine société proche de la nature. L’écriture et la lecture sont prohibés comme distractions parasitaires, sauf pour la classe des dirigeants, les meilleurs des hommes qui ont pour mission de mener leur cheptel sur le chemin vertueux de la société de demain. Soit le manuel du parfait retour à la terre voulu par Pétain en 43, date à laquelle le livre est édité chez Denoël, l’éditeur des écrits les plus horribles de Céline. Ravage a même eu droit à une prépublication épisodique dans Je suis partout, célèbre publication collaborationniste dont la plupart des auteurs ont été mis au ban de la société à la fin de la guerre.
Les analyses que j’ai pu lire ici et là (dont le très bon article d’ActuSF sur le sujet) ont tendance à limiter le discours fascisant à la dernière partie du roman. Pourtant, et même si les premières parties n’épargnent l’inefficacité de l’État (et critiquerait donc partiellement l’administration vichyssoise ?), François Deschamps est un personnage à la moralité douteuse dès le départ. Rejetant les scories de la vie facile, par opposition au producteur véreux, petit et informe (Barjavel n’a pas osé l’affubler d’un patronyme juif, heureusement…), l’homme fort du roman est dès le départ tourné vers le passé, insensible au doute ou à la remise en question, foncièrement misogyne et violent. A aucun moment du roman recourir au meurtre pour défendre ses intérêts ne lui pose le moindre problème. Il va même jusqu’à tuer un de ses compagnons qui s’est endormi sur son quart sans autre forme de procès et sans autre conséquence. Et je ne vous parle évidemment pas de l’usage répétitif du mot nègre en début de roman (qu’il faut replacer dans son contexte, il est vrai).
Cette apologie de l’homme providentiel, qui guidera le peuple par son bon sens paysan et son rejet du modernisme, est un trait commun de tous les régimes fascistes. La nostalgie des temps heureux que l’on doit retrouver quel qu’en soit le prix est une idéologie qui fait froid dans le dos. Et Ravage ne dit rien d’autre, ni dans sa forme ni dans son fond. Je ne comprends pas, dès lors, que le bouquin soit encore au programme de temps d’écoles et de lycées comme un exemple français de SF avant l’heure. Sans vouloir paraphraser le bon article d’ActuSF auquel j’ai déjà fait référence, Ravage est un livre d’anticipation médiocre. Les quelques traits futuristes, souvent grossiers et irréfléchis (la SF a pour vocation de présenter un futur réaliste, sinon cela devient de la fantasy), sont balayés par une société très 1940 dès que les protagonistes quittent Paris. Une fois les voitures volantes crashées au sol, le « futur » présenté par Barjavel se limite aux expériences architecturales moquées de Le Corbusier et à quelques gimmicks dont l’utilité est discutable (conserver ses défunts à domicile sous une forme embaumée, le développement d’une cure électrique qui donne des pouvoirs aux aliénés, etc.)
S’il faut trouver une valeur au bouquin, c’est sans doute l’imagerie qu’il développe dans ses secondes et troisièmes parties, lorsque les villes tombent dans le chaos et lorsque les protagonistes traversent une France ravagée par le feu et les épidémies. On y trouve, c’est vrai, les échos des récits post apocalyptiques modernes qui rencontrent tant de succès ces dernières décennies. En cela, le livre est en effet plus brut et explicite que ses illustres pairs que sont 1984, Le Meilleur des Mondes ou encore le Nous Autres de Zamiatine. Cependant, là où ces trois livres sont peut-être plus sages dans leur récit, ils sont éminemment plus intelligents dans leur propos. Il n’y a que peu de mise en garde dans Ravage : il y a un programme politique. Et c’est celui, rétrograde, décrié et dangereux, du pétainisme.
J’aimerais finir cette chronique en exprimant mon étonnement. Je ne saisis pas que Ravage soit encore régulièrement présenté comme un exemple de science-fiction française, comme un précurseur. Barjavel, discret sur le sujet après avoir été blanchi après-guerre de toutes accusation de collaboration, s’est bien gardé de remettre les mêmes idées dans ses ouvrages suivants. Le Grand secret ou la Nuit des temps remettent également en cause le culte de la modernité, mais ils ressemblent beaucoup plus à des délires de vieux soixante-huitards, où l’amour libre et la foi en l’humain ont autant de valeur que la mise en garde contre les abus des technologies. Barjavel n’est pas Céline, bien sûr. Il n’a pas écrit Bagatelles pour un massacre. Mais Ravage est clairement le produit de son temps et défend, de manière il me semble totalement éhontée, une idéologie infamante. S’il est intéressant de le lire pour comprendre comment un contexte peut produire aussi un roman de genre, il n’en demeure pas moins que c’est un mauvais livre. De la science-fiction cheap, des personnages inintéressants et un message d’un autre temps. La science-fiction, même française, a produit nombre d’autres livres nettement plus riches, intéressants et qui nous forcent à réfléchir aux problèmes d’aujourd’hui à travers une satire d’un demain potentiel. Que ces messieurs (et dames, bien sûr) qui font les programmes officiels de l’enseignement s’en souviennent et laissent de côté les œillères qui les aveuglent sur une littérature « de genre » qu’ils méprisent autant qu’ils ne la saisissent pas. Il est temps de s’y intéresser. Et de faire le ménage pour remiser le vieux grand père un peu raciste à sa juste place : dans une caisse oubliée au fond du grenier.

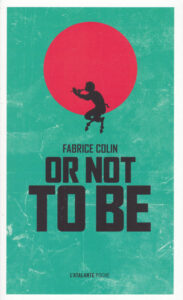 De
De 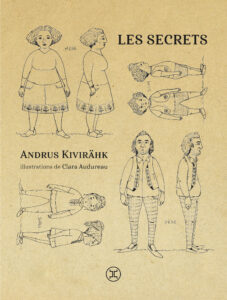 D’
D’ De
De De
De