
De Adam Fyda, 2020.
Résultat d’un financement participatif sur Kickstarter lancé en 2020, le comics indépendant, édité par la petite maison d’édition Blue Fox Comics, est arrivé voilà quelques semaines déjà par la poste. Maintenant que je l’ai lu, vient donc le moment de la sentence. En résumé : on sent que c’est du comics indépendant, de l’artisanat plutôt que du professionnalisme des grosses maisons d’édition, mais le résultat est finalement très sympathique. Adam Fyda, grand amateur de H.P. Lovecraft, a bien saisis le potentiel commercial du reclus de Providence, surtout chez les geeks qui traînent sur KS. Mais au-delà de l’opportunité, on sent à travers le comics le véritable amour que Fyda a pour l’œuvre d’origine.
Sur le fond, Fyda ne propose rien de moins qu’une suite à l’un des plus grands textes de Lovecraft. Nous retournons donc dans les montagnes maudites du Pôle Sud, deux ans après les faits explorés dans Les Montagnes Hallucinées (1936). De braves scientifiques, originaires forcément de la petite ville d’Arkham et de l’Université de Myskatonic, retournent donc dans le grand Sud pour retrouver les traces de la précédente expédition, dont les journaux de l’époque n’ont évoqué que le retentissent échec, sans entrer dans les détails de la catastrophe.
Tous les lecteurs familiers avec l’œuvre de Lovecraft savent déjà qu’il s’agit là d’une bien mauvaise idée. Et c’est bien sûr ce que nous raconte ce comics de 80 courtes planches : les avatars malheureux qui tombent sur la tête (ou, plus précisément, sous les pieds !) de nos braves explorateurs-scientifiques. Et le comics ne surprend pas, en cela. Il s’inscrit en droite ligne dans l’hommage à Lovecraft : on y croise des scientifiques dont la personnalité est peu explorée, des monstres abyssaux ou sidéraux qui sont proches de l’indicible et un rythme pour finir assez lent, partagé entre une fascination pour l’architecture des lieux étranges et une apparition progressive mais inéluctable de l’horreur. L’idée de faire une suite a pour désavantage de réduire un peu la nouveauté, bien sûr, puisque les monstres stellaires dont il est question sont évidemment les mêmes que ceux d’origine.
Fyda, par ailleurs, semble être un meilleur dessinateur et scénariste que dialoguiste. J’ai noté à plusieurs reprises que les dialogues étaient un peu poussifs et semblaient peu naturels. Bien sûr, avec le style ampoulé de Lovecraft et le choix de l’hommage, c’est difficile de faire moderne. Mais Gou Tanabe dans sa version des Montagnes Hallucinées (l’original), dispo chez Ki-oon, rend une copie plus travaillée certainement à ce niveau-là, tout en étant forcément plus proche du texte original, puisqu’il s’agit là d’une adaptation et non d’une suite hypothétique. Le crayonné de Fyda, pour finir, est assez brut. On le sent plus à l’aise avec les décors, les bâtiment ou les architectures étranges qu’avec ses protagonistes humains, résumés parfois à quelques traits peu expressifs.
L’ensemble respire cependant la fraîcheur d’un artiste peut-être encore un peu jeune (dans sa maîtrise technique, pas forcément dans son âge) qui s’est avant tout fait plaisir à lui-même en prolongeant un texte classique d’un grand maître de l’horreur fantastique. Et qui a voulu partager ce plaisir avec un public de convaincus (dont je fais bien entendu partie). Une curiosité pour les collectionneurs du mythos lovecraftien, dont la naïveté est finalement assez rafraichissante. Et puis, c’est toujours une bonne œuvre que de soutenir des éditeurs indépendants et de ne pas donner son argent à Dark Horse, pour une fois.

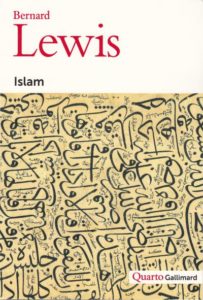 De
De 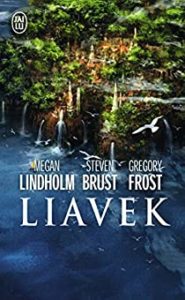 De
De 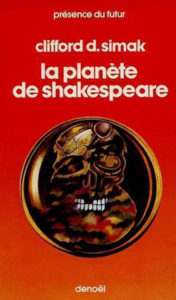 De
De 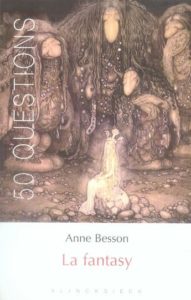 D’
D’