 De Stephen Herek, 1989.
De Stephen Herek, 1989.
Découvert grâce à la fausse bande d’annonce d’Honest Trailer, réalisée à l’occasion de la vraie bande d’annonce du troisième (!) opus des aventures de Bill & Ted qui devrait sortir cette année, j’avoue que je n’avais jamais entendu parlé de ce film avant cela. Et quand je dis jamais, c’est jamais. Ni dans les listes nostalgiques des films de notre enfance (certainement pas en francophonie où le film semble totalement ignoré, mais pas non plus sur les sites/blogs/vidéos anglo-américains), ni dans la filmo interdite de x ou de y. Pourtant, il semble que le film bénéficie d’un noyau de fidèles solide, ce qui explique une première suite en 1991 et une seconde en 2020, 31 ans après l’original. Mais ce noyau fait, semble-t-il, moins de bruits que les amateurs des Goonies et des films de John Hughes (Sixteen Candles, The Breakfast Club, Weird Science et Ferris Bueller’s Day Off).
Et si comme moi ce film ne vous dit rien, je peux vous le pitcher en une phrase : Dumb & Dumber ados, en plus gentil, qui voyagent dans temps à la recherche de figures historiques pour réussir leur dissert d’histoire. Avec Keanu Reeves dans le rôle d’un des deux crétins. Avec ceci, tout est dit, je pense. Allez, pour le plaisir, je peux vous dire que les deux ado would-be rockeurs voyagent dans le temps car, quelque part dans le futur, leur power ballad va sauver l’humanité. Et qu’il est donc d’une importance cruciale qu’ils réussissent leur devoir d’histoire, sous peine de fin du monde. Et ce n’est pas gagné, puisque quand le prof d’histoire demande à Ted qui est « Joanne of Arc » (je le laisse en anglais, sinon, la vanne ne marche pas), Keanu Reeves répond avec un air réjouis « la femme de Noah ! » (puisque l’Arche de Noé, en anglais, se dit Noa’s Arc…. >_<).
A part ça, on peut voir dans le film Napoléon tricher au bowling, Jeanne d’Arc donner un cours d’aérobic, Beethoven se déchaîner sur 5 synthés à la fois, Genghis Khan semer le chaos dans un magasin de sport et, bien sûr, Socrate tenter de draguer les minettes au mall du coin. Voilà voilà. A la base, ça devait être Hitler à la place de Napoléon, mais les scénaristes ont eu une lueur de lucidité et se sont dit que ça, c’était peut-être pousser le bouchon un peu loin (Maurice) !
Honnêtement, je ne sais pas quoi penser de ce film. Je suis autant atterré par sa bêtise abyssale qu’amusé par le fait Stephen Herek, le réalisateur, reconnaissait lui-même qu’il trouvait le script hilarant mais que son humour n’était pas forcément partagé par tous. Succession de sketches sans queue ni tête mettant en scène de grandes figures historiques, le film repose sur un équilibre très fragile. Le spectateur est-il dans les conditions de se farcir un nanar sympathique où deux idiots parviennent à mettre tout le monde dans leur poche par leur bonhommie avenante ? La machine se grippe très vite si l’on n’est pas tolérant. J’avais déjà ressenti à la vision de Pee-Wee’s Big Adventure : une certaine forme de gêne sur le parti-pris. Et heureusement pour le film qui nous occupe aujourd’hui, là où Pee-Wee Herman m’avait rapidement horripilé, j’avoue m’être laissé avoir par Alex Winter et (un très jeune) Keanu Reeves. Ils (sur-)jouent deux parfaits abrutis, c’est un fait, mais deux abrutis sympathiques.
Pourtant le film en lui-même est nettement moins abouti que Pee-Wee’s Big Adventure, pour rester dans le parallèle. Stephen Herek, réalisateur avec une assez longue filmographie de films de série B (son film le plus populaire est sans doute la version live des 101 Dalmatiens de 1996 sur un scénario, comme c’est étonnant, de John Hughes), n’est pas Tim Burton. Les effets spéciaux sont risibles, la direction d’acteur laisse la plupart du temps à désirer (sauf pour Keanu Reeves et pour George Carlin, le « Doc » du film, qui se débrouillent bien tout seuls sans direction), le rythme est bancal et la plupart des plans sont très basiques. Mais… Mais il se dégage, au risque de me répéter, quelque chose de bizarrement sympathique de l’ensemble. Un peu comme quand, en fin de soirée, vous rigolez aux vannes nazes de vos copains pas drôle, juste parce que l’alcool fait de l’effet. Le lendemain matin, vous vous rendez compte que vous avez ri pour rien, mais vous avez quand même encore le sourire aux lèvres. Voilà tout le programme et toute l’ambition de Bill & Ted’s Excellent Adventure. Ni plus, ni moins.
Le film n’aurait jamais existé sans le succès de Retour vers le futur. Le fantasque producteur de ce film étrange s’est dit qu’il y avait peut-être dans ce script quelques similitudes et s’est donc décidé à le financer malgré l’improbabilité du script. Merci à lui. Il n’a pas obtenu ce qu’il espérait, mais nous a permis de voir cet étrange pari. A tester avant que le troisième épisode ne sorte sur les écrans plus tard dans l’année !

 D’
D’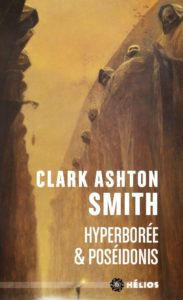 De
De 
 De
De