 Sous-titré : Le trouble du héros
Sous-titré : Le trouble du héros
D’Alexandre Mare, 2010.
Court essai d’Alexandre Mare sorti chez les Moutons électriques il y a dix ans déjà, la republication récente dans la collection Hélios est l’occasion de redécouvrir ce qui fut, à l’époque, l’une des premières études sérieuses à se pencher le comportement sexuel de nos personnages de fiction préférés. Depuis lors, les études psychologiques, sociologiques ou relevant d’autres volets des sciences humaines sur nos « héros modernes » se sont multipliées et il n’y a plus grand chose d’exceptionnel à gloser de manière très sérieuse sur un matériau de base qui l’est nettement moins. Mais est-ce bien le cas ? Est-il réellement moins sérieux, ce matériau de base ? C’est l’une des questions auxquelles Sexe ! […] répond par la négative.
Pour Alexandra Mare, il y a en effet beaucoup à apprendre par exemple en décortiquant l’organisation sociale de cette grande communauté gay-friendly qu’est le Village des Schtroumfs. Et il y a aussi des leçons à tirer du message contradictoire livré par Alerte à Malibu ! ; l’ostentation charnelle cacherait en fait une pudibonderie bien-pensante où le sexe libre est synonyme de mal et est puni par les scénaristes de manière forcément tragique. Et les pauvres Batman, Superman, Wonderwoman et Captain America sont logés à la même enseigne : comme idéaux, comme archétypes inatteignables du genre humain, ils sont soumis aux affres d’une sexualité impossible qui n’est que le reflet de leur ethos dérangé.
Oui, bon, je simplifie un peu. Pour être honnête, le livre alterne les coups d’éclats, les analyses brillantes et inattendues avec, malheureusement, une certaine forme de verbosité de psychanalyse de comptoir. J’exagère sans doute ici en versant dans l’hyperbole, pour le bien de la démonstration, mais c’est le risque avec ce genre d’interprétation : la surinterprétation. Vouloir donner du sens à tous les comportements humains revient de temps à autre à inventer des corrélations douteuses entre des statistiques qui n’ont rien à voir l’une avec l’autre (et qui étaient, jusque-là, bien contentes de s’ignorer mutuellement). Du coup, si Alexandre Mare nous force à réfléchir et à nous poser des questions saines sur des comportements malsains, s’il nous amène intelligemment à jeter un regard nouveau sur des choses que l’on croyait connaître, je trouve qu’il est parfois un peu malhonnête dans son raisonnement.
Il le dit d’ailleurs lui-même dans son livre. Explicitement. Il n’a choisi que les éléments qui lui permettait de creuser son idée dans un corpus qui est souvent beaucoup plus large (et presque toujours plus nuancé) que ce qu’il a choisi de traiter. Le meilleur exemple est sans doute Conan, dont il ne traite que la première adaptation filmée de John Milius. Or, pour intéressante que soit son analyse, le premier film de Conan en dit certainement plus long sur la psyché dérangée de John Milius (et d’Oliver Stone, qui scénarisa le film contre toute attente) que sur le personnage imaginé par Robert E. Howard, infiniment plus riche et plus subtil que sa version « simplifiée » du long métrage. Et sans être un spécialiste de Marvel ou de DC, je suis à peu près sûr que les choix établis pour Batman ou pour Captain America sont du même tonneau, peu ou prou.
Cette réserve majeure mise à part, le bouquin est amusant, ludique et m’a fait découvrir, en effet, des éléments que j’ignorais (notamment sur les origines de Superman et le lien très proche avec la violence dans les rapports physiques de ce dernier). C’est clairement l’œuvre d’un homme qui a une culture évidente dans le domaine des comic books et de la littérature de genre : il aime ce qu’il commente. Même Baywatch. Et cela explique aussi, au moins partiellement, la fascination de l’homme envers ces figures monolithiques, presque mythiques des héros modernes. Car Mare est également un roublard sur un autre aspect de son livre : au-delà des analyses très freudiennes sur les pratiques sexuelles des cas envisagés, il dévie largement vers d’autres analyses psychanalytiques, voire même sociétales, dans les différents textes qui composent cet ouvrage. Car, finalement, ces héros modernes ne sont que le recyclage des figures mythiques qui passionnent l’humanité depuis qu’elles existent. La conclusion de Sexe ! […] ne parle d’ailleurs pratiquement que de leurs ancêtres grecs et romains, puisque nos superhéros ne sont jamais que des avatars modernisés de ces modèles classiques (Hercule, Achille, etc.) D’où la deuxième entourloupe : ce qui nous est présenté ici comme un texte « révolutionnaire » s’inscrit en fait dans la longue tradition de l’analyse des textes antiques, avec, il est vrai, un angle particulier. Car pourquoi jaser sur l’homosexualité latente de Batman ? En quoi est-elle différente de celle d’Achille qui fut, et pour une période beaucoup plus longue que le fana de chauves-souris, un modèle pour l’humanité dans son ensemble (de virilité, qui plus est) ?
Reste entre nos mains un petit livre amusant, par moment un peu trop verbeux, mais qui se lit vite et permet de briller en société avec toute une série d’anecdotes qui vous feront passer pour un vieux sage qui sait prendre du recul sur ce qu’il lit. Et ça, c’est déjà pas mal !
PS : et je ne ferais pas de commentaire (en fait si, c’est ce que je suis en train de faire 🙂 ) sur le titre un peu putassier de l’ouvrage. Le fait d’utiliser le mode Sexe ! en grand sur la couverture alors que l’analyse va bien au-delà de cela revient un peu à un mécanisme bassement mercantile pour attirer le chaland. Et le fait que je sois tombé dans le panneau à pieds joints dit sans doute quelque chose sur mon propre équilibre mental ! 🙂

 De
De 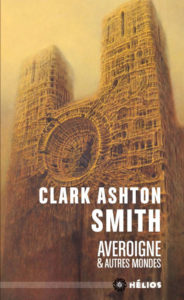 De Clark Ashton Smith, 1930-1951.
De Clark Ashton Smith, 1930-1951. De
De  Suivi de Je répare tout.
Suivi de Je répare tout.