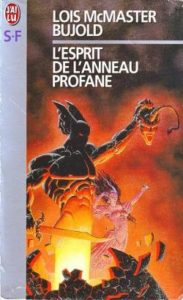 De Lois McMaster Bujold, 1992.
De Lois McMaster Bujold, 1992.
Roman d’une rare légèreté, L’esprit de l’anneau profane est l’une des rares incartades dans le domaine de la fantasy par son auteur, l’une des grandes reines de la SF, Lois McMaster Bujold. Relativement ignorée cette dernière décennies, McMaster Bujold a cependant réussi la passe de trois -le Locus, le Hugo et le Nebula- avec sa saga la plus connue, la Saga Vorkosigan. Ce classique de la SF en pas moins de 18 romans (et quelques nouvelles) ne doit cependant pas faire oublier que l’auteur a également gagné les trois prix les plus prestigieux de la littérature de l’imaginaire avec son autre cycle, sa trilogie de fantasy connue sous le nom du Cycle de Chalion. Le deuxième tome a même réussi à empocher les trois prix la même année (2004), dix ans avant Ann Leckie et sa Justice de l’ancillaire.
Ce n’est pas, à proprement, une néophyte à laquelle nous avions affaire avec ce roman isolé, ne faisant pas partie d’une saga, d’un cycle ou même d’une trilogie, ce qui devient presque notable avec les œuvres de fantasy. C’est un roman qui se situe dans les relatifs débuts littéraires de la carrière de l’américaine, puisque sa première œuvre publiée date de seulement sept ans plus tôt, en 1985, mais un roman dont la forme et le propos sont maîtrisés presque à la perfection.
On y plonge dans l’Italie du XIVème siècle, l’époque des cités-états se faisant la guerre à grands coups de trahisons, d’assassinats et de mercenaires balafrés. C’est dans un contexte difficile que l’on apprend à connaître Fiametta, l’énergique fille de Maître Beneforte, l’orfèvre du duc local. Fiametta, du haut de ses seize printemps, déborde de vitalité et assiste son père dans ses œuvres. Car Maître Beneforte est plus qu’un simple orfèvre, c’est également le mage le plus réputé du duché. Il fabrique de véritables œuvres d’art et leur instille des charmes puissants, bénéfiques, avec l’approbation du clergé local qui garde un œil assez sévère sur les praticiens du Grand Art. Fiametta, impatiente comme seul son âge l’excuse, tente elle-même ses premiers enchantements en se cachant de son omniprésent paternel. Elle fond une bague en or destinée à s’attirer les amours du séduisant capitaine de la garde qui vient régulièrement visiter l’atelier et sert, à l’occasion, de modèle aux sculptures de son père.
Et tout irait bien dans le meilleur des mondes si un mariage arrangé avec la fille du duc local ne tournait au fiasco et que le futur époux, un puissant condottière d’une république voisine, ne finissait pas par assassiner le duc, le gentil capitaine de la garde et, dans la foulée, le brave Maître Beneforte. Et voilà la pauvre Fiametta lancée sur les routes en quête d’alliés et de vengeance. Et je ne développerai plus avant, histoire de ne pas vous gâcher la lecture de ce passionnant divertissement.
Vous l’aurez compris, on est en plein roman de cape et d’épée à l’ancienne, mâtiné çà et là d’éléments fantastiques qui justifient son classement dans les œuvres de fantasy. Oui, on y croise des kobolds et des golems. Oui, s’il y a une magie blanche, il y a évidemment des praticiens de la magie noire. Et le roman de se développer comme un mille-feuilles patient et érudit. Nous ne sommes pas dans une œuvre de grimdark où les personnages sont tous gris et où on torture à tout va. Non, dans L’esprit de l’anneau profane, même le méchant (qui est effectivement méchant, pas de doute) conserve un esprit chevaleresque. Et c’est assez rafraîchissant de redécouvrir cette fantasy parfois un peu naïve qui fait le sel des romans d’aventure où seul le suspense et le plaisir de lecture compte. D’une certaine manière, les romans de Pierre Pevel s’inscrivent dans cette engeance, avec un peu de post-modernisme en plus.
La relative simplicité du roman n’empêche pas son auteur de développer un style particulièrement agréable et érudit. On sent que McMaster Bujold a potassé son sujet avant de se lancer dans cette fresque historique. On voit les pieds des alpes en lisant le roman, on sent l’ambiance d’une Florence imaginaire assiégée et soumise aux brigands. L’écriture fort travaillée est pourtant formidablement fluide et font de ce bouquin un page-turner efficace. Bien sûr, un lecteur assidu de fantasy restera sur des sentiers battus et rebattus en lisant cet œuvre, mais elle est tellement brillamment menée que c’est aussi un sentiment de retour à la maison, de familiarité bienveillante qui se dégage de ce récit plein de rebondissements épiques. Mon seul regret serait sans doute le côté très stéréotypé de la romance entre l’héroïne et son prétendant, cousue de fil blanc, qui lasse peut-être par son côté trop niais, pour le coup.
L’esprit de l’anneau profane est donc une parenthèse bienvenue entre des textes plus ardus ou une fantasy plus dure à laquelle les auteurs modernes nous ont davantage habitué. Ces 400 pages qui se lisent en quelques heures m’ont embarquée dans un voyage certes convenu, mais fort agréable. Et c’est plutôt une bonne nouvelle, quand on considère que la fantasy est aussi une littérature d’évasion.

 Sous-titré : And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn
Sous-titré : And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn De
De  De
De  De
De