 D’Adrian Tomas, 2014.
D’Adrian Tomas, 2014.
Depuis longtemps déjà, La Geste du Sixième Royaume prend la poussière dans ma PAL. Probablement intimidé par son côté grosse brique (l’édition poche Hélios n’est pas des plus simple à manipuler et le grammage/lettrage ne sont pas forcément très agréable) et par le fait qu’il s’agit d’un (premier) roman de fantasy classique comme il en sort dix à la douzaine chaque trimestre, je l’avais volontairement laissé pour plus tard. Ce plus tard étant indéterminé (et sans doute lointain). Dans un moment de doute livresque, je me suis cependant plongé dans Notre-Dame des Loups, du même Adrian Tomas, toujours chez Hélios, intrigué par la quatrième de couverture. Et je me suis rendu compte de mon erreur. Par rapport au Sixième Royaume, je veux dire. Je n’aurais pas dû le laisser moisir dans un coin.
Notre-Dame des Loups, donc. Une histoire de loups-garous, une fois n’est pas coutume. Mais point de bit-lit à l’horizon. Les influences ici ne sont certes pas Stephanie Meyer et ses jeunes éphèbes issus de l’imaginaire gothique : on est en plein dans de la dark fantasy à l’américaine. C’est direct, violent, graphique, prenant. On est dans du Joe Abercrombie, en format court. Et c’est ‘hachement bien, les amis. Comment le décrire autrement ? En gros, c’est un mix entre The Revenant et The Hateful Eight. Et on ne peut même pas accuser l’auteur de plagier, puisque les deux films sont sortis après le bouquin (respectivement 2016 et 2015). Vous l’aurez compris : on a affaire à un western dans le grand Nord américain (l’endroit est incertain, mais on imagine aisément l’action au milieu du Wisconsin en décembre 1880 et quelque), peuplé d’une galerie de salopard en tout genre.
Et c’est exactement ça. Une troupe de sept individus, les Veneurs, qui semble aussi hétéroclite que soudée, parcours les étendues sauvages du Nord-Ouest américain pour chasser les loups-garous. On y retrouve un allemand en redingote, un cowboy à la gâchette facile, un esclave afro-américaine récemment affranchie et mutique, un vieil édenté qui fabrique les balles en argent, un journaliste fauché et, bien sûr, un bandit de grand chemin à leur tête. Et cette bande n’aura de cesse de s’enfoncer dans la nature hostile afin de tuer la Reine mère, l’origine de tous les loups-garous, la quasi-mythique Notre-Dame des Loups. Les personnages, tous « bigger than life » sont remarquablement bien construits et sont tous plus intéressants et complexes qu’ils ne le paraissent au premier abord. Même ceux qui semblent antipathique ont des circonstances atténuantes.
Adrian Tomas prend de plus le pari risqué de raconter chacun des chapitres par un veneur différent, nous permettant ainsi de les découvrir tour à tour, avec leur passé, leurs passions et leur rôle respectifs. Là où d’autres auraient hachuré le récit, Tomas s’en sort magnifiquement bien en réussissant chaque transition sur un crescendo final par chapitre dont il vaut mieux taire la mécanique pour vous préserver la surprise de lecture. Sachez simplement, bien sûr, que l’auteur est loin d’être un manche et qu’il égrène ci et là, dans chaque tranche de vie, par petites touches, les éléments qui vous permette de reconstituer le puzzle de ce récit à tiroirs.
L’inéluctabilité de la progression du récit en fait une machine redoutablement efficace : impossible de poser le bouquin sans être arriver au bout. On fait partie de la bande, pendant toute leur folle équipée. ça sent la poudre, le sang, et la bête humide. Et dès que la nuit tome sur le récit, on frémit à l’idée que les lycanthropes ne sont pas bien loin. Et qu’ils sont nombreux. Difficile d’en dire plus sans spoiler l’histoire. Et vu la nature du récit, très cinématographique et très spectaculaire, il serait vraiment dommage d’en dire trop. Il ne me reste donc qu’à tirer mon chapeau bien bas à ce court roman, lecture coup de poing aussi passionnante qu’effrayante. Un auteur que je m’empresserais de relire, en espérant qu’il est aussi original et sur le fil avec ses autres romans de fantasy.

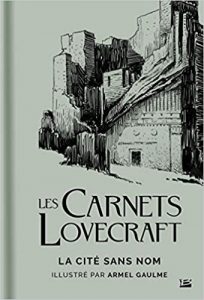 De
De 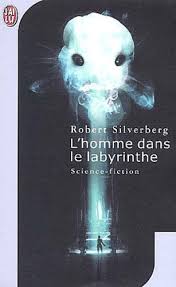 De
De  De
De  De
De