 D’Amélie Nothomb, 2019.
D’Amélie Nothomb, 2019.
La rentrée littéraire est synonyme d’un nouvel opus du plus connu des auteurs belges. Nothomb nous livre donc, avec une régularité confinant au stakhanovisme, ses 125 pages automnales. Les années se suivent et ne se ressemblent pourtant pas : après quelques œuvres relativement mineures, Nothomb bouscule ses habitudes et verse, avec Soif, dans la biographie. Et pas n’importe qui : Jésus. Oui, celui du Nouveau Testament, excusez du peu.
Et pas n’importe quel épisode de la vie du barbu nazaréen. C’est la Passion dudit personnage à laquelle Amélie s’intéresse. Mel Gibson et ses pulsions sanguinolentes n’ont qu’à bien se tenir, Amélie s’est décidée à les affronter sur leur propre terrain. Des pieds de Pilate aux sables du Golgotha, l’auteur nous décrit par le menu le calvaire du fils de Dieu. Et, bizarrement, c’est plutôt réussi. Car appliquer la logique parfois absurde de Nothomb à l’expérience fondatrice du christianisme donne un résultat percutant. Partant du principe que le fils de Dieu est un homme comme les autres, elle l’affuble de faiblesses typiquement humaines. Ainsi, sous la plume de l’auteur, nous apprendrons par exemple que seul le premier miracle accompli par le prophète (le vin aux noces de Cana, pour les deux inattentifs, dans le fond de la classe) a apporté une quelconque joie à son artisan principal. Les autres miracles, attendus par les nécessiteux, promus par ses apôtres, tenant davantage de la relation commerciale que de l’expérience mystique. D’ailleurs le livre s’ouvre sur une le « procès » de Jésus devant Pilate où les miraculés et leurs familles viennent se plaindre l’un après l’autre des conséquences néfastes que ledit miracle a eu sur leur vie. Le paralytique, par exemple, n’avait pas estimé les frais qu’entraînaient l’achat régulier d’une nouvelles paire de chausses…
A travers ses traits d’ironie douce-amère, Nothomb nous trace donc en pointillé la vie compliquée d’un homme simple qui, bien que conscient d’être le fils de Dieu et l’espoir de rédemption de l’Homme, n’en demeure pas moins un homme esclave de ses désirs et passions. Et l’auteur de s’approprier ce qui fit scandale dans le film de Scorese de 88 : Jésus, dans Soif, est bien le compagnon de Marie-Madeleine, même si la question de l’amour chaste n’est jamais réellement tranché.
C’est d’ailleurs par ses passions que Nothomb choisi de traiter la Passion. Naviguant dans la douleur entre les stations du calvaire, Jésus ne peut s’empêcher, par un monologue intérieur, d’évoquer les trois grandes expériences, les « passions » au sens d’une expérience sensorielle, que sont l’amour, la mort et la soif. Cette dernière, obsession de l’Amélie potomane de Biographie de la faim ou experte en champagne de Pétronille ou Barbe bleue donne son titre à cet opus 2019. Elle y défend que le sentiment de la soif, qu’il s’agit de cultiver, tient de l’expérience mystique et donne accès à une jouissance directe lorsqu’on l’assouvi. C’est grâce à cette souffrance, la soif, que Jésus tient sur la croix. La soif efface sa douleur, lui prouve qu’il est encore vivant, qu’il est encore humain. Et c’est précisément l’expérience qui lui sera interdite lorsqu’il reviendra de ses trois jours au caveau, comme le veut le canon de l’Église catholique romaine.
Soif est en résumé un Nothomb étonnant, à contre-courant des farces sociales auxquelles elle nous avait habitué ces dernières années. Plus sérieux par certains aspects, mais aussi plus modeste dans son propos et dans son développement, Soif est un roman qui sortira du lot chez l’habitué de l’auteur. Les fulgurances stylistiques sont certes moins nombreuses, mais c’est au profit d’un discours étonnant sur la religion et, plus fondamentalement, sur l’expérience d’être humain. Un millésime, donc, qui touchera peut-être un public plus large que sa légion de fidèles. L’académie du Goncourt ne s’y est pas trompé en sélectionnant le bouquin dans leur édition 2019, honneur qu’elle n’avait plus connu depuis 1999/2000. Qui vivra verra.

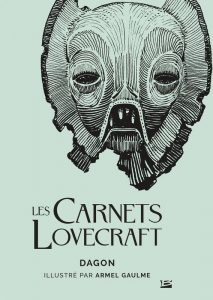 De
De  De
De  Sous la direction d’
Sous la direction d’ De
De