 De Jacques Barbéri, 2016.
De Jacques Barbéri, 2016.
La période des fêtes de fin d’année est tout à fait propice pour une bonne tranche de post-apocalyptique ! Passé les premières pages un poil ésotérique, on entre dans le cœur du roman avec l’histoire de Jack, un informaticien récemment enrôlé dans l’armée en perspective d’un conflit mondial entre les deux grands blocs qui se disputent la Terre (sans doute, ce n’est pas précisé). Le bonhomme n’est pas réellement à l’aise dans la troupe, qui fait furieusement pensée à la bande de jeunes de Starship troopers. Lorsqu’une nouvelle recrue arrive, Jack tombe instantanément amoureux.
Il profite d’une dernière permission pour sortir avec la fille en question dans son quartier d’enfance. Mais, dès le lendemain, la guerre l’appelle : Jack est une ressource essentielle ; il est l’un des maîtres à penser de l’I.A. Guerres et Paix, l’I.A. qui détermine les réponses armées et les tactiques militaires à adopter pour son côté du conflit en devenir. Seulement voilà : l’autre côté aussi à développer une I.A. omnisciente. Et, comme souvent dans la S-F, les I.A. s’entendent pour se liguer contre leur ennemi commun, l’Homme.
Et c’est là qu’on entre réellement dans la partie magistrale de Mondocane : les I.A. provoquent une catastrophe mondiale qui déforme la réalité et altère l’humanité. Jack, par une succession de hasards, s’en sort comme seul survivant de son unité et se réveille après sept ans, d’une hibernation/congélation d’urgence, dans le monde de demain. Monde de demain qui n’est pas spécialement beau à voir, ni sympathique à vivre. Les rares survivant de la catastrophe survivent bon gré mal gré en petites communautés qui se méfient l’une de l’autre. Jack est récupéré à son réveil par deux frères (l’un a un corps à moitié métallique, l’autre n’a plus que la moitié de son visage), la femme de l’aîné (une énorme femme qui compense son malheur avec des barres céréalières), leur fille (née après la catastrophe, elle est l’une des post-humaines, on l’imagine simiesque à souhait) et leur père (le masque à gaz du vieil homme à fusionné avec sa bouche lors de la catastrophe et il se nourrit via un ténia géant qui le parasite -à moins qu’il ne soit devenu le ténia et que son corps ne soit plus qu’une enveloppe ?-).
Et ce ne sont que les premiers survivants que Jack croisera. Et encore, je passe sur la sœur de la famille, corps assimilé à une pyramide humaine de plusieurs centaines de corps fusionnés qui partagent, semble-t-il une seule conscience. Bref, du Mad Max sous acide. Et Jack, dans cette réalité désolante, de se mettre en quête de l’unique amour de sa vie, la fille avec laquelle il a passé sa dernière nuit avant l’attaque des I.A.
Mondocane ne laisse pas son lecteur respirer et l’entraîne dans une sorte de montagne russe de apocalyptique qui se situe quelque part entre Ken le Survivant et l‘Île du Docteur Moreau. Jacques Barbéri, que je ne connaissais absolument pas malgré les nombreux romans qu’il a publié depuis les années 70 chez Fleuve Noir/Anticipation et chez Denoël/Présence du futur, sert admirablement le propos avec une style évocateur et imagé. Plus d’une fois, on pense être devant l’un de ces tableaux de la Renaissance représentant l’enfer : une mélange de répulsion et d’attirance envers cet inconnu glauque et bizarre.
Et c’est effectivement ce que je retiens du bouquin : un vrai trip dans le pays de l’étrange. La S-F sert pour finir d’excuse, de cadre, à la vision que Barbéri a sans doute eu d’une monde où les règles de la physique sont bouleversée par des entités aux motifs inexpliqués. Et s’il y a une tentative d’explication technologique, elle s’oublie bien vite face aux images fortes de ce monde nouveau, laid et beau tout à la fois. Une vraie découverte, qui se lit vite et aisément. Encore un auteur dont j’essaierai sans doute d’autres œuvres à l’avenir, si j’ai le loisir de tomber dessus (histoire d’encore alourdir mal PAL).

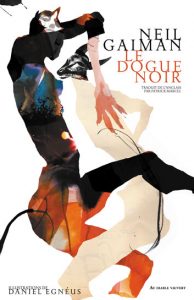 De
De 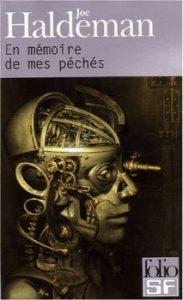 De
De 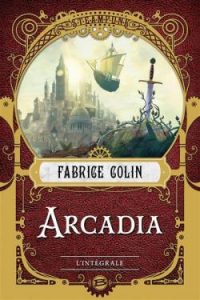 De
De 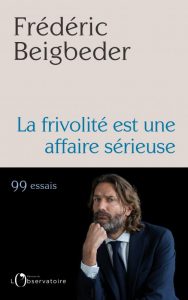 Comment ? Deux Beigbeder dans la même année ? Luxe ultime ! Et… non. Bien essayé. La frivolité est une affaire sérieuse, titre soufflé par l’éditrice de Beigbeder, n’est pas le deuxième texte de fiction de son auteur pour cette année, après l’amusant Une vie sans fin,
Comment ? Deux Beigbeder dans la même année ? Luxe ultime ! Et… non. Bien essayé. La frivolité est une affaire sérieuse, titre soufflé par l’éditrice de Beigbeder, n’est pas le deuxième texte de fiction de son auteur pour cette année, après l’amusant Une vie sans fin,