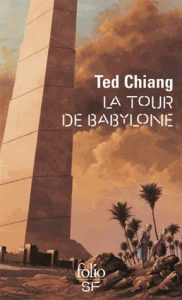 De Ted Chiang, 1991-2002.
De Ted Chiang, 1991-2002.
Phénomène littéraire de la SFFF particulièrement peu prolixe (une quinzaine de nouvelles en presque 20 ans), l’américain Ted Chiang, informaticien de son état, est précédé d’un bouche-à-oreille presque aussi favorable que Ken Liu, commenté ici il y a quelques temps avec sa Ménagerie de papier. La Tour de Babylone regroupe 8 nouvelles de SF, écrites en 1991 et 2002, auréolées des principaux prix littéraires (Locus, Hugo, Nebula, etc.) Justifiés.
Bien sûr, tous les textes n’ont pas une qualité équivalente. Certains sont excellents, d’autres sont plus difficiles. Mais, dans l’ensemble, ce sont des nouvelles de très haut vol qui font de Chiang probablement l’un des meilleurs nouvellistes actuels. Le recueil s’ouvre sur la nouvelle éponyme, formidable fable de la recherche du divin, où le peuple de Babylone construit littéralement la Tour qui l’approche des cieux. Le récit, forcément cyclique, nous livre un monde univers passionnant en une cinquantaines de pages, là où d’autres auteurs auraient besoin de 600 pages pour n’atteindre que la moitié du résultat.
Je fus un peu moins convaincu par Comprend, la seconde nouvelle, qui traite d’une méthode révolutionnaire pour réparer le cerveau après des accidents de circulation et qui créée, par accident, des super-hommes. Si le récit est bien amené, j’ai eu du mal à accrocher au protagoniste principal qui traverse un peu le récit sans un réel développement psychologique intérieur, ce qui est dommage, vu le contexte. La troisième nouvelle, Division par zéro, est une farce de mathématicien. Si elle reste bien écrite, elle est un peu trop « technique » pour être vraiment agréable à lire.
L’Histoire de ta vie, portée à l’écran par Denis Villeneuve avec Premier contact, est à l’inverse un véritable chef-d’œuvre. Bien que très technique à nouveau (mais dans le domaine de la linguistique), la nouvelle met en scène un contact avec une civilisation extraterrestre qui n’a pas le même langage que nous, bien sûr, mais pas non plus les mêmes référents spatio-temporels. Et, en décryptant la langue de l’autre, la linguistique héroïne de la nouvelle accède également à la connaissance du futur dans son ensemble. Y compris l’histoire, forcément dramatique, de ses proches. Alternants les points de vue, cette histoire est d’une délicatesse et d’une poésie absolue. A lire obligatoirement.
Soixante douze lettres nous plonge ensuite dans un mix entre la recherche biologique et la kabbale. Beau texte, à nouveau, mais d’une faconde plus classique bien qu’il mixe des éléments qui, à ma connaissance, n’ont jamais été rapprochés. C’est sans doute la nouvelle la plus « cinématographique » du recueil, puisque Chiang y intègre des courses-poursuites et un véritable crescendo scénaristique là où ses autres nouvelles sont plus contemplatives. Pas dérangeant, mais un peu plus sage. Suit un court texte de deux pages signé par Chiang dans un revue à vocation scientifique pour donner un aperçu de ce que sera la recherche à l’époque des super-cerveaux ayant accès à la connaissance en temps réel. Pessimiste, mais amusant.
L’avant-dernière nouvelle, L’enfer, quand Dieu n’est pas présent, est un superbe texte qui part du postulat que les manifestations divines sont réelles, mais provoque des dégâts collatéraux. Pour un humain sauvé, les anges détruisent la vie de nombre de spectateurs malheureux. La nouvelle traite intelligemment de la crise de foi d’un homme dont la femme a été malheureusement tuée lors de l’apparition d’un ange. Il croisera d’autres « victimes » qui réagissent chacune à leur manière à la manifestation de Dieu sur Terre. Très intelligemment construit et, à nouveau, assez fataliste. Enfin, le dernier texte, Aimer ce que l’on voit pose de manière brillante la question des apparences et de l’amour. Aimons-nous quelqu’un pour ce qu’il est où pour son apparence ? Cette dernière façonne-t-elle le comportement de l’humain ou est-ce l’inverse ? Si la question n’est pas nouvelle, le traitement à travers les atermoiements d’une adolescente et les tentatives de récupération de ces « traitements » par l’industrie est une nouvelle fois amené de manière très maligne.
Vous l’aurez compris, il s’agit d’un recueil de nouvelles de haut vol. Je pinaille volontairement pour trouver à redire sur les quelques textes plus faibles, mais c’est réellement un plaisir de lecture de bout en bout. Finalement, le seul élément de l’écriture de Chiang qui m’a déranger est peut-être sa propension à trop verser dans la fascination technique. Si les sciences explorées (la linguistique, la mathématique, la physique, la doctrine religieuse, etc.) sont des moteurs évidents et utiles de ses nouvelles, il a parfois une tendance au verbiage techniciste qui gâche ça et là quelques pages. Mais bon, il est amplement pardonné au regard de la qualité de ses nouvelles par ailleurs. Chiang est la démonstration, plus encore que Ken Liu, qu’il existe encore toujours bel et bien un art de la nouvelle et qu’il ne faut pas forcément écrire des space opéras en 7 tomes pour toucher le lecteur. Bonne lecture, les amis.

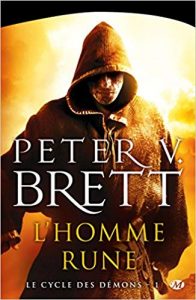 De
De  De J.D. Salinger, 1948-1953.
De J.D. Salinger, 1948-1953. D’
D’ De Martin Scorcese, 2010
De Martin Scorcese, 2010