
De Robert Redford, 1992
Il est amusant de constater que le « formatage » de la course aux oscars évolue avec le temps. Il y a maintenant 25 ans, les critères n’étaient pas les mêmes. Bien sûr, la nécessité d’émouvoir la ménagère de moins de 40 ans était déjà bien présente. Mais le rythme et le contenu étaient bien différents. En lieu et place des drames historiques actuels, l’heure était aux récits intimistes, si possible tournés vers l’Amérique de papa (ou de grand-père). Cela a donné, au fil des années, Légende d’automne, Danse avec les loups ou même, dans une certaine mesure, Le Dernier des Mohicans.
Et au milieu coule une rivière fait partie de cette grande famille. Impeccablement filmé par Robert Redford, véritable hommage aux rivières poissonneuses du Nord-Ouest des États-Unis (et du Montana en particulier), ce drame familial a un rythme lent qui magnifie les fantastiques décors naturels dans lequel il a été tourné. Le film prend également le temps d’installer ses personnages principaux, de l’enfance à l’âge adulte, par des touches successives qui dépeignent en finesse leur choix de vie, leurs faiblesses, leur richesse intérieure.
L’histoire des frères Maclean, fils de pasteur d’une petite communauté du Montana, est une histoire universelle : le citadin contre le campagnard, l’impulsif contre le réfléchi, l’épicurien contre le réservé. On y suit le parcours de Norman, le grand frère, qui deviendra prof de littérature anglaise, alors qu’il revient après ses études dans sa ville natale et sa cellule familiale, stricte, mais ouverte. Et de son petit frère, Paul, la tête brûlée devenu journaliste, qui se plaît à contrevenir à la bienséance et qui noie son alcoolisme dans le jeu. Résumé comme ça, cela semble cousu de fils blancs. Mais Et au milieu coule une rivière a l’intelligence de ne pas se résumer à ces clichés, justement. Norman, pour cultivé qu’il soit, n’est pas non plus maître de ses sentiments. Et s’il est davantage réfléchi que son petit frère, l’appel de nature n’est jamais bien loin. Paul, de son côté, est loin d’être un imbécile. Bonimenteur de première classe, malgré ses faiblesses, il a un sens moral à toute épreuve et on ne peut que lui donner raison quand il prend faits et causes pour son amie indienne (native-américaine ?), même lorsque cela finit en bagarre généralement copieusement arrosée.
Très bien interprété par un Brad Pitt dans sa première jeunesse, le personnage de Paul est certainement le plus intéressant des deux. Norman, joué par Craig Sheffer (dont le seul autre fait d’arme notable est d’avoir joué dans les Frères Scott… !), est plus introverti. Leur père, joué par l’excellent Tom Skerritt, est un pasteur rigoriste, mais doté d’une finesse qui rompt avec le monolithisme que l’on pouvait attendre d’un tel personnage.
Bref, Redford adapte la nouvelle autobiographique de Norman Maclean avec un brio certain au niveau de la mise en scène et de la direction d’acteur. La seule faiblesse, mais elle est importante, du film est pour moi la prévisibilité et la lenteur du développement scénaristique. La fin, longtemps annoncée, n’est certes pas une surprise. Mais elle aurait pu être amenée différemment. De même, certaines pistes qui auraient pu donner du relief aux évènements et une profondeur supplémentaire aux personnages, sont à peine exploitées (comme l’amie amérindienne ou encore le frère imbécile de Jessie, la future épouse de Norman).
Reste un drame intimiste, prévisible mais poétique malgré tout. Certains plans, lorsque les frères Maclean sont occupés à pêcher à la mouche, l’art véritable de ce film, sont très beaux. Mais tout ceci sonne un peu creux si l’on ne se laisse pas emporter par la poésie du moment. A choisir, dans un registre pas si lointain, Stand by me est nettement plus poignant et marquant. Et, si l’on cherche une version moderne de ce drame familial de l’Amérique profonde, je ne peux que conseiller de revoir le magnifique Brokeback Mountain, plus courageux dans son propos et dans sa forme.

 De
De  De
De 
 De Hideaki Anno et Shinji Higuchi, 2016
De Hideaki Anno et Shinji Higuchi, 2016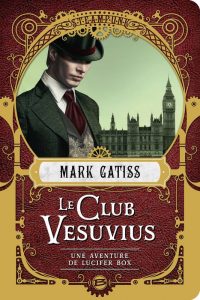 De
De