 De Thomas Day, 2011
De Thomas Day, 2011
Paru initialement sous le nom de Les Cinq derniers contrats de Dæmone Eraser en 2001, Dæmone doit, je pense, être considéré comme un roman différent. Considérablement révisé pour le dixième anniversaire de la sa parution, le texte a été allongé et a gagné, d’après les propos de l’auteur lui-même, en profondeur et en structure.
Thomas Day en a profité, par ailleurs, pour l’intégrer dans son grand œuvre, le monde des Sept Berceaux. Le roman s’ouvre donc avec le personnage d’Alèphe, un Guerrier du temps, sorte d’insecte géant plus ou moins immortel, qui doit prouver à son maître que l’être humain vaut quelque chose, afin d’éviter une éradication totale. Et pour ce faire, l’Alèphe ne trouvera rien de mieux que de tenter de trouver une définition de l’amour.
Assez classique, vous dites-vous. Sauf que, pour trouver cette définition de l’amour, il s’adresse à Dæmone Eraser, David Rosenberg 2.0, un être humain augmenté, mort et ressuscité à partir d’une sauvegarde informatique, gladiateur violent et champion incontesté de l’Aire Humaine, une sorte de survival game quelque part entre Rollerball et Battle Royale, armes technologiques en plus. Ce même Dæmone Eraser qui cherche un sens à sa vie depuis que sa femme est plongée dans un coma sans retour.
L’Alèphe lui proposera donc un marché qu’il ne peut refuser : 5 contrats, en tant que tueur à gage, contre le retour de l’amour de sa vie. Et à partir de là, Dæmone construit un récit en cinq actes, violents, bruts, comme autant de tableaux baroques d’une SF sombre et militaire. La quatrième de couverture, tout comme Thomas Day lui-même, se plaisent à citer Sam Peckinpah comme influence majeure, le western n’étant jamais loin du space-opera. J’y vois personnellement davantage de Gunnm ou même de Shirow dans les influences, avec un propos intelligible en prime.
Le bouquin est court, sens la poudre à canon à toutes les pages et n’hésite pas à tomber dans l’explicite (tant pour l’effet de balles que pour le sexe), comme c’est toujours le cas avec Day. Ce n’est pourtant jamais gratuit. Et l’histoire, le développement des personnages principaux comme secondaires, tiennent de bout en bout. Aux côté de Dæmone, véritable machine à tuer à la limite de la dépression, on découvre une ribambelle de personnages secondaires tous plus « bigger than life » l’un que l’autre. Du garde du corps homme-chat à la compagne bio-mécanique qui tient davantage de l’arme que de la femme (Major Kusanagi, quelqu’un ?), on est, à n’en pas douter, dans du techno-thriller de haut vol.
Alors, bien sûr, on est parfois un peu frustré de ne pas avoir plus d’explications sur le monde qui entoure Dæmone. Bien sûr, on peut regretter que certains personnages sont peu exploités (dans les victimes de Dæmone, le médecin/bourreau repentant avait plein de potentiel), mais c’est le prix à payer pour la force du récit : un véritable coup de poing, bourré d’hémoglobine et de drones ultra-armés. Avec, tout de même, un sens. Au-delà de l’exercice de style, on ne peut qu’être charmé par le brio de Day pour imposer un rythme et un cadre en allant à l’essentiel. Du tout bon.

 De
De 
 De
De  De
De 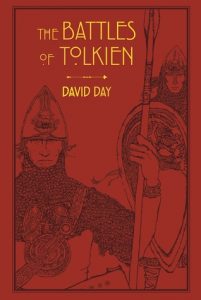 De
De