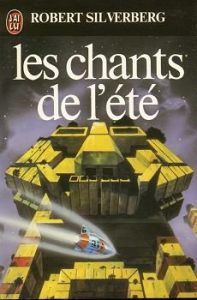
De Robert Silverberg, 1956-1981
Anthologie inédite en anglais, commissionnée par l’inénarrable Jacques Sadoul à l’époque où il régnait en maître sur l’édition SF dans la langue de Molière, Les chants de l’été est une sorte de best of des nouvelles du prolifique Robert Silverberg. Impossible, bien sûr, d’avoir un panel complet du Silverberg nouvelliste, le new-yorkais en ayant écrit plus de 200 dans sa longue carrière. Le principe de ce best of est de présenter des nouvelles rédigées entre 1956 (Silverberg a alors 21 ans) et 1981 (soit 25 ans plus tard), en ordre chronologique, pour y voir, peut-être, une évolution du style.
Pour être honnête, si évolution du style il y a, elle m’a au moins partiellement échappée. C’est peut-être dû à la traduction française de la très discrète Iawa Tate, qui a sans doute uniformisé la progression du style en imprimant sa propre patte aux textes traduits. Mais qu’à cela ne tienne, on lit de toute manière rarement de la SF pour un style particulièrement soutenu. Sur le fond, la progression n’est pas flagrante non plus : Silverberg fait preuve d’une imagination débridée dès le départ. Bien sûr, il y a quelques thèmes connus et balisés dans ces nouvelles, mais vu l’âge des textes, c’est un effet inévitable.
Je regrettais récemment, avec le pourtant très bon recueil La ménagerie de papier de Ken Liu, que les nouvellistes SF actuels pêchent souvent par un certain manque d’audace. Je me rends bien compte que, les années passants, il devient de plus en plus difficile d’imaginer des situations, des progressions ou des chutes inédites. Mais entre ce constat et un certain conformisme, il y a de la marge. Nul question de conformisme, dans cette anthologie. Silverberg fait preuve d’une imagination à toute épreuve dans chacun des 13 courts textes qui constituent ce recueil.
Il serait un peu fastidieux de tenter de tous les résumer. Disons simplement qu’ils vont du drame à la comédie en passant par des textes plus contemplatifs. La nouvelle ouvrant l’anthologie, qui donne son nom au recueil, est un récit de voyage dans le temps classique dans ses prémisses. Un new-yorkais des années 50 se retrouve projeté sur une Terre post-apocalyptique où les rares humains survivants ont opté pour un mode de vie contemplatif basé sur une utilisation modérée des bienfaits de la nature et sur des liens sociaux plus diffus qui favorisent un climat de paix et d’équité entre les individus. C’est évidemment sans compter sur leur visiteur, parfait exemple du capitalisme rugissant des années 50, qui voit dans les doux rêveurs du futur une bande de hippies mous qu’il convient d’exploiter.
Et ça n’est que la première histoire. J’ai particulièrement apprécié également Le Dernier poète, qui nous narre le choix malheureux du dernier poète de l’humanité, misanthrope, de s’expatrier à l’autre bout de la galaxie. Mais aussi La Digue, réflexion étrange sur le dernier choix libre de l’humanité dans un monde robotisé qui se protège d’une nouvelle menace venue des océans. L’Épouse 91 m’a bien fait marrer aussi, comme courte satire des rapports hommes-femmes avec quelques échos de sexualité débridée.
Nous savons qui nous sommes présente également une vision d’une Terre post-apocalyptique, où les survivants craignent les vestiges du passé et où il faudra l’arrivée d’une impromptue voyageuse pour rallumer la curiosité des survivants. Sauve qui peut!, enfin, est une belle réflexion sur la manipulation d’intelligences artificielles par l’homme (ou de l’homme par des intelligences artificielles ?) : un dictateur choisi de s’enfuir vers une étoile lointaine à la veille de son renversement. Il prend pour tout compagnons des cubes mémoriels (des sortes de copies enregistrées, douées de réflexion et de la capacité d’apprentissage) de sa famille proche et de quelques philosophes et écrivains du passé. Et le dictateur tente de se persuader qu’il a fait le bon choix…
Difficile d’en dire plus sans ruiner le plaisir de lecture. Retenons juste qu’il y a au moins trois ou quatre bonnes idées par nouvelles (ce qui, vu leur longueur, est un ratio très élevé !) et que Silverberg parvient, comme les très bon nouvellistes, a intéresser le lecteur au devenir de ses personnages qui ne sont pourtant parfois qu’esquissés en quelques traits. Un tout bon recueil, qui mérite une (re-)découverte, pour autant que vous ne soyez pas allergiques aux histoires qui tiennent en maximum 30 pages. Vu que l’anthologie n’est plus éditée depuis le début des années 90 et que la tendance de l’édition SF est plutôt de pondre des intégrales, il ne vous reste sans doute plus qu’à écumer les bouquinistes (physiques ou virtuels) pour mettre la main sur le volume. Bonne chasse !

 Édité par
Édité par 
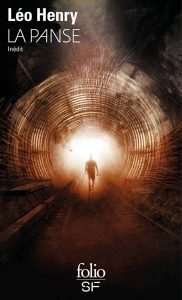 De
De 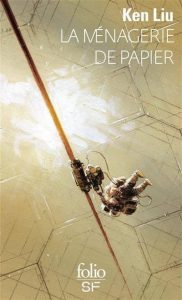 De
De