Anvers, 1er novembre 2017

Une fois n’est pas coutume, parlons un peu musique, spectacle, concert. Bien que de moins en moins friand de festivals et concerts les années passant, je ne résiste pas à l’envie d’aggraver mes acouphènes quand Metallica passe en Belgique. Du coup, le 1er novembre dernier, c’est avec plaisir que je me rendais au SportPaleis d’Anvers pour écouter une nouvelle fois le quatuor trash métal le plus célèbre de la planète. Le concert n’était pourtant pas sans nouveauté pour moi, puisqu’il s’agissait de la première fois que je les voyais dans une salle de concert et non dans leur configuration festival, les ayant jusque là toujours vu sur les plaines flamandes de Werchter. C’était également la première fois que je les voyais assis et non pas debout, beuglant dans le « black pit« , une 50 à six euros (Werchter oblige) à la main.
Et ça fait un drôle d’effet. D’abord et avant tout, ça m’a rappelé que je faisais maintenant partie des vieux, de la génération de ces types qui se « déguisent » en habits noirs, chaussures à clous et t-shirt du Grasspop 1997 pour se rappeler leur adolescence le temps d’une soirée (raison pour laquelle je ne me « déguise » jamais en concert, je ne suis pas nostalgique). Sad but true. Ensuite, oui, ça m’a confirmé que si c’est mieux pour le guiboles, c’est pas pour autant que j’aime les concerts assis. Ça ne m’a pas empêcher d’entamer les « Die, die, by my hand » et autres « Nothing else matters » avec les 20.000 autres spectateurs, mais c’est pas pareil…
Passé cette parenthèse sur mon âge de plus en plus canonique et l’impact d’icelui, passons à Metallica. Sur le concert en tant que tel, rien à redire. Ils assurent le spectacle de bout en bout comme ils le font déjà depuis plus d’une dizaine d’années (sur les 36 ans actifs du groupe). La scène centrale, minimaliste, cache évidemment plein de gadgets de mise en scène impressionnants. Au-delà des traditionnels jets de flammes et feux d’artifice, on notera la superbe utilisation d’une cinquantaine de cubes/écrans suspendus qui participent aux jeux de lumière et d’ambiance, diffusant par exemple les désormais traditionnelles images de soldats de la grande guerre pendant One (débutant, comme toujours, avec des extraits de Johnny got his gun). Autre belle trouvaille, un essaim de drones lumineux pendant Moth into flame (un des nouveaux morceaux extraits de Hardwired… to self destruct) planent au-dessus de Lars Ulrich ; spectacle envoûtant garantit.
Sur la setlist, la place accordée aux derniers albums est évidemment un peu plus grande que dans la disposition festival, mais comme Hardwired est plutôt un bon crû, pas de problème avec ça. On commence toujours avec l’extrait du Bon, de la Brute et du Truand et on termine toujours sur Enter Sandmand, tradition oblige. Pour le reste, on s’enflamme sur les belles représentations de Seek and destroy, From whom the bell tolls ou encore de Maspert of puppets ; les grands classiques, en somme. Le tout, calibré à la minute près, de la mise en scène à l’enchainement des tubes jusqu’aux réactions probables des 4 membres du groupes.
Ce qui m’amène au véritable propos de cet article : où est donc passé la rage de Metallica ? Depuis quand Céline Dion a-t-elle remplacé James Hetfield ? Quelques mots d’explications sont sans doute nécessaire. A un moment de vide, alors que les roadies changent les guitares des uns et des autres, James Hetfield apostrophe un gamin de 13 ans du premier rang. Après lui avoir demandé son nom et si c’était bien ses parents autours de lui, James lui souhaite la bienvenue dans la « grande famille de Metallica« . Applaudissements de la foule, larmes à l’œil des parents, francs sourires des membres du band.. Pardon ? J’ai dû raté une étape. La « famille » Metallica ? What the fuck ? Hetfield, Trujilo et Hammet se succèdent pour arranger la foule à coup de « Metallica loves you« . La dernière fois que j’ai entendu autant de « loves you » dans un concert, c’était en 97 à Ostende. Pour un concert de Michael Jackson.
En fait, j’ai tort de m’étonner. Si Metallica annonce des tournées mondiales, sold out en quelques jours à chaque fois, dans des stades ou des salles de plus de 20.000 places, c’est bien qu’ils ne sont plus du tout alternatifs. Le métal est devenu aussi mainstream que la britpop ou la k-pop, si l’on veut une référence d’un autre coin du monde. Il n’y a plus de risque, plus d’enjeux. La tournée WorldWired est garantie PG13 (Lars Ulrich sauve l’honneur avec un shit et un fuck dans sa seule intervention amplifiée, en toute fin de concert). Je ne suis pas assez idiot que pour mesurer la « rebellitude » à une simple addition de gros mots. Simplement, je constate avec une pointe d’amertume que l’auto-censure disneyenne touche même les groupes de metalleux.
Alors, bien sûr, Metallica n’est pas n’importe quel groupe de metalleux. Ce sont des super-stars. Et c’est un show calibré, formaté et particulièrement bien produit que l’on va voir lorsqu’on sait se payer les 100 balles de la place (familial, mais pas démocratique : qui dit super-star dit un certain train de vie à respecté, que diable !). Le stupéfiant reportage Some kind of Monster, sorti il y a déjà quelques années, contenait les germes de cette « mainstreaming-sation » de Metallica. On y voyait James Hetfield stoppé net une répétition du groupe pour sagement aller chercher sa fille à son cours de danse classique. Où est le rock-&-roll dans tout ça, bordel ? Simple : le marionnettiste tire les ficelles, comme ils le chantent si bien, les ficelles de l’argent facile, de l’image positive, du politiquement correct. Tout est beau et rose dans le monde du business mondial de la musique. Et surtout, surtout pas de polémique. Merci bien, c’est pas/plus vendeur. D’ici à ce qu’ils s’arrêtent de cracher sur scène, il n’y a qu’un pas qui, je n’en doute pas, sera franchi d’ici quelques années car il convient bien sûr de ne jamais adopter un comportement inconvenant… Obey your master.
En résumé : WorldWired ; spectacle garanti, karaoké géant, plein les yeux et les oreilles (enfin, pas tant que ça : les normes de décibel sont tellement drastiques ces dernières années que je n’avais même pas les oreilles qui bourdonnaient en fin de spectacle). Mais, si vous cherchez l’âme du métal, ou du rock en général, cherchez plutôt du côté des groupes de jeunes potes qui se produisent dans des garages dans votre coin…
PS: deux faits de concerts amusants tout de même. D’abord, une reprise improbable de This is rock’n’roll des The Kids confirme que c’est mieux que Trujilo ne chante pas… Et, ensuite, plus ludique, Lars Ulrich qui explique qu’ils ont déjà performé 700 fois à Werchter et que les gens pensent qu’ils sont le « local band« …



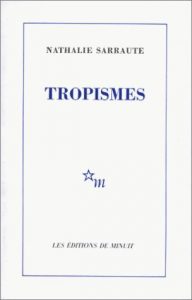 De
De  Collectif, 2017.
Collectif, 2017.