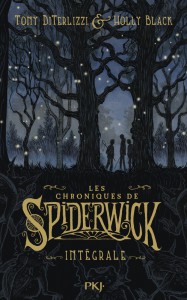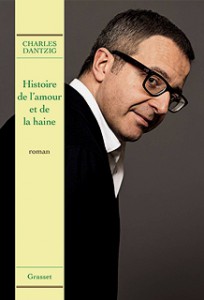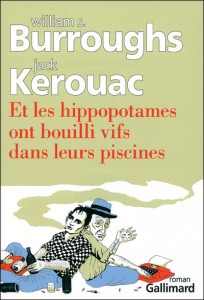De Stefan Brijs, 2005.
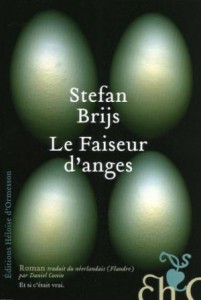 Même lorsque l’on me prête des livres sans réellement connaître mes goûts littéraires, il semble que le fantastique et la science-fiction s’invitent malgré tout au menu. Et c’est le cas dans ce roman flamand : la frontière entre métaphysique et science est tenue, l’anticipation, bien que réaliste, est présente. En parlant de frontières, l’on pourrait même dit que c’est un livre tout entier dédié aux frontières : physique, entre la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne, morale, entre le bien et le mal, religieuse, entre l’acception au 1er degré et la croyance raisonnée, de fond, entre la comédie de mœurs lors Brijs décrit les charmants villageois de la bourgade rurale de Wolfheim, et le récit d’horreur qui se dévoile petit à petit au lecteur et même de forme, les narrateurs s’enchaînant sans qu’aucun d’entre eux ne soit semblable à l’un de ses pairs.
Même lorsque l’on me prête des livres sans réellement connaître mes goûts littéraires, il semble que le fantastique et la science-fiction s’invitent malgré tout au menu. Et c’est le cas dans ce roman flamand : la frontière entre métaphysique et science est tenue, l’anticipation, bien que réaliste, est présente. En parlant de frontières, l’on pourrait même dit que c’est un livre tout entier dédié aux frontières : physique, entre la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne, morale, entre le bien et le mal, religieuse, entre l’acception au 1er degré et la croyance raisonnée, de fond, entre la comédie de mœurs lors Brijs décrit les charmants villageois de la bourgade rurale de Wolfheim, et le récit d’horreur qui se dévoile petit à petit au lecteur et même de forme, les narrateurs s’enchaînant sans qu’aucun d’entre eux ne soit semblable à l’un de ses pairs.
Phénomène d’édition (tiré à 3.000 exemplaires au départ, vendu à plus de 130.000 exemplaires grâce à des critiques dithyrambique et un bon bouche-à-oreille) et pourtant relativement discret, Le Faiseur d’anges est également un petit bijou de construction narrative. Après une première partie descriptive qui tend à multiplier les narrateurs –sans que la voix ne soit donnée au personnage principal, l’inquiétant docteur Victor Hoppe, la seconde partie enchaîne sur des réminiscences croisées entre deux périodes chargées du passé dudit docteur. La troisième partie, qui renoue avec la linéarité du récit, est une véritable escalade vers un final que l’on sent inévitable.
L’histoire est assez simple : le docteur Victor Hoppe, après vingt années d’absence, revient dans son village natal de Wolfheim, accompagné de triplés qu’ils cachent en raison d’une infirmité physique disgracieuse : le bec de lièvre dont il fut lui-même affublé dans son enfance. Les villageois de ce coin tranquille, oublié des cartes et des mémoires, sont en émoi face à ce retour inattendu. Que cache-t-il ? Où est donc la mère de ces triplés ? Ceux-ci, roux, maladifs et repoussants, ne sont-ils pas les envoyés du Diable ? Voilà comment l’on peut résumer les cent premières pages de ce roman étonnant. Mais celles-ci ne laissent en rien présager la suite des évènements qui, au fil des pages, se dessine comme un huis-clos mental d’un désaxé handicapé socialement.
Les Éditions Héloïse d’Ormesson (la fille de) ont été bien inspirées en proposant une traduction âpre du texte de Brijs (mon niveau de flamand ne me permet malheureusement pas de me lancer dans une lecture VO dans la langue de Vondel) : on s’englue au fil de l’intrigue dans un piège qui se referme doucement mais sûrement sur l’esprit du docteur Hoppe, laissant les personnages secondaires disparaître l’un après l’autre sans autre forme de procès ou de sentiment exprimé. Car c’est ce qui caractérise en premier lieu le docteur Hoppe : il est, littéralement, sociopathe. A-sentimental. Et lorsque l’on conjugue ceci avec le fait qu’il souhaite être l’égal de Dieu (d’où le titre) en tant que Créateur, on comprendra aisément que l’intrigue navigue volontiers sur les thématiques du clonage, de l’eugénisme et de la Foi.
Roman surprise –un livre que l’on vous prête vous fait toujours cet effet-là, car on ne peut qu’exprimer de la curiosité quant au pourquoi l’autre vous a prêté justement ce livre-là– à plus d’un titre, je ne peux que vous conseiller d’y jeter un œil. Qu’il s’agisse d’un polar d’anticipation ou d’une réflexion philosophico-macabre sur le créationnisme, l’étiquette importe peu : c’est un bon bouquin, prenant, intelligent et intelligible. Ceux et celles qui ne sont pas encore convaincus peuvent découvrir le premier chapitre en lecture libre sur le site de l’éditeur francophone.