 De Ben Aaronovitch, 2010
De Ben Aaronovitch, 2010
Le dernier apprenti sorcier, tome 1
Comme je suis un incorrigible optimiste, je me lance dans une nouvelle saga fantastique alors que j’en ai au minimum trois ou quatre en court sur ma PAL nocturne. Mais soit, il arrive un moment dans la vie où il est trop tard pour se corriger. Au tour de la saga du dernier apprenti sorcier, savant mélange entre un whodunit traditionnel et de la fantasy à l’humour désopilant pur jus (assez justement décrit par la presse comme la rencontre d’X-Files et Doctor Who, même un Harry Potter vs. Sherlock Holmes marche aussi), à son tour donc de me tomber dans les mains.
Précédé d’une bonne fanbase sur le net qui attend chaque nouvel opus comme le saint-graal, j’anticipais donc une lecture fun et accrochant. De fait, c’est plutôt un succès pour le côté fun. On ne s’ennuie pas une minute en suivant Peter Grant, flic métisse un peu distrait de la capitale londonienne, lorsqu’il se retrouve propulsé dans le domaine de l’étrange en devenant le nouvel assistant de l’Inspecteur Nightingale. Ce dernier lui explique bien vite que chez lui les nouveaux ne sont pas des assistants, mais bien des apprentis. Car Nightingale n’est pas un flic comme les autres : il a la charge de faire respecter la Loi (ou les vieux équilibres et autres pactes ?) dans le monde interlope du surnaturel.
Et, pas de bol, le livre s’ouvre sur un meurtre étrange. Il faudra donc pas mal de tact, de patience et de chance à Peter Grant et son mentor pour démêler le vrai du faux et mettre la main sur le fantomatique coupable de ce qui ressemble chaque jour de plus en plus à une affaire de meurtre en série de l’au-delà. Pour le côté fun, roller-coaster d’émotion, Les rivières de Londres remplissent donc parfaitement leurs promesses. Cependant, pour être honnête, j’ai encore un peu de mal à accrocher aux personnages. Si Grant est l’exemple type de l’ingénu confronté à un monde qu’il ne connait pas et dont il doit assimiler les règles à grande vitesse et Nightingale est l’exemple type du mentor mystérieux qui lâche son savoir au compte-goutte, l’alchimie entre les deux fait encore largement défaut dans ce premier tome.
Je suis également gêné par le fait que même si la magie nous est décrite comme anormale dans le contexte de l’histoire, le secret de son existence semble quand même franchement mis à mal sans que cela ne pose plus de problème que cela. Le nombre de personnages croisés qui acceptent pratiquement sans broncher l’irruption du surnaturel dans leur vie me semble quand même franchement élevé si l’on pense nous faire croire que la magie est un art caché et inconnu du grand public. Et les protagonistes eux-mêmes de ne pas faire beaucoup d’efforts pour cacher leurs pouvoirs et leurs opérations spéciales. Peter lui-même, bien qu’assez cartésien, n’éprouve qu’une demi-surprise lorsqu’il rencontre un fantôme la première fois et ne semble pas plus bouleversé que cela lorsqu’il devient progressivement l’apprenti magicien éponyme de la saga.
Un autre aspect qui m’a fait un peu sortir du bouquin par moment est le fait que les « règles » de ce monde magiques semblent évoluer au fur et à mesure des besoins de l’enquête (et de l’auteur, par ailleurs). Si la pièce débute par quelques règles de magie simple et quelques sorts qui, par cette simplicité directement reconnaissable, donnent la mesure du pouvoir des protagonistes et si l’on reconnait aisément quelques figures du fantastiques (fantômes, vampires, extra lucidité), j’avoue que l’irruption de dieux ou demi-dieux à la manière des American Gods de Gaiman dans le récit noie un peu le poisson. Ceci sans mauvais jeu de mots, considérant que les Dieux en question sont les incarnations des rivières de Londres, qui donnent leur nom à ce premier opus.
Je pinaille probablement sur des détails, mais je suis un peu chagriné de constater qu’après les 400 pages de ce premier tome, la relation des personnages entre eux n’a que peu évolué et que le voile n’a finalement été que très partiellement levé sur un monde qui semble intéressant, mais que l’on découvre réellement par la petite porte. C’est probablement dû au choix du style de récit : l’angle policier nous fait découvrir un univers par sa lie et par ses anecdotes parfois triviales, mais d’autres s’en sortent mieux avec le même postulat de base. Ainsi, Pierre Pevel avec ses Enchantements d’Ambremer parvient à mes yeux à embarquer le lecteur beaucoup plus rapidement dans son monde de fiction.
Les rivières de Londres n’en demeure pas moins un bouquin fort agréable à lire. S’il y a quelques longueurs ici et là (notamment vers la fin, qui piétine un peu), le bouquin est réellement amusant, émaillé ci et là de références geeks judicieusement dispensées et trouve un bon équilibre entre les phases d’apprentissage et les phases plus noires et violentes consacrées à l’affaire qui nous occupe dans ce tome. Si les motivations finales du criminel me laissent un peu dubitatif, la mécanique de l’enquête est assez efficace et la progression de sa résolution assez bien dosée. Reste qu’il s’agit sans doute d’un exercice ingrat de débuter par un premier tome qui a pour difficile tâche de décrire un monde et des personnages nouveaux tout en faisant avancer l’intrigue : cela peut donner de brillantes réussites ou un bouquin un peu bancal où aucune des deux pistes n’est réellement creusée jusqu’au bout. Je situerai ce premier tome dans la deuxième catégorie, malheureusement. Espérons que le second souffre moins d’un placement de décors un peu décevant pour se pencher à fond dans son enquête en étoffant ci et là ses personnages et son lore interne.

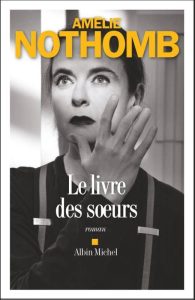 D’Amélie Nothomb, 2022.
D’Amélie Nothomb, 2022. De
De  De
De 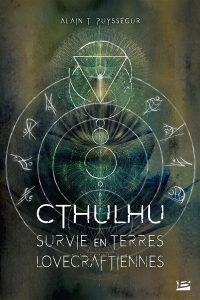 D’
D’