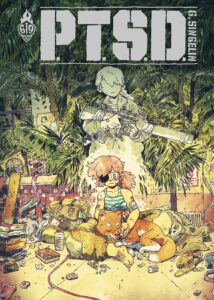 De Guillaume Singelin, 2019.
De Guillaume Singelin, 2019.
Singelin, à l’instar de Bablet, est l’un des poulains des éditions Ankama (et du label 619). Ils se sont par ailleurs croisés dans la série des Doggybags, qui me fait de l’œil depuis un paquet de temps mais pour laquelle je n’ai pas encore craqué… Singelin est surtout connu pour avoir dessiné The Grocery jusqu’à présent et P.T.S.D. était son premier vrai titre, long, en solo. Autant dire que la BD était attendue au tournant à sa sortie. Premier constat : c’est très beau. Certains chroniqueurs déplorent des proportions étranges et un style trop « asiatique » (sachant que l’auteur est un sino-français ayant vécu à Tokyo, le reproche est un poil déplacé), mais je trouve perso le style très agréable à l’œil. On reconnait la parenté avec Bablet dans l’utilisation magnifique de la couleur (et du design dans son ensemble… le même, en plus kawaï !). Si c’est moins monochromatique que chez son compagnon, les planches n’en demeurent pas moins des œuvres d’art à part entière. C’est l’une de ces BD sur lesquelles on peut aisément passer quelques minutes par page pour se plonger dans les infinis détails dont l’artiste nous abreuve.
Côté scénar, et à contrario sans doute de l’univers ultra-coloré et la cité cosmopolitique qui sert de décor principal, ce n’est pas la franche rigolade. Comme le titre le laisse entendre, on parlera ici du syndrome post-traumatique (PTSD en anglais), et plus spécifiquement du PTSD chez les vétérans. Dans un monde futuriste (?), une guerre anonyme a laissé des vétérans anonymes au bord de la misère. Ils vivotent de petits larcins et du système D en marge de la société qui ne souhaite, à de rares exceptions près, pas les voir. Jun, l’une de ces vétérans marginalisés, sera notre personnage principal.
P.T.S.D. nous plonge dans son quotidien d’après-guerre, à la manière du premier Rambo. Réveils en sursaut, culpabilité, rejet des autres, dépendance aux analgésiques… bref, la dèche absolue. Par une série de courts flashbacks disséminés à travers le volume, on en découvrira un peu plus sur elle, son passé de soldat et le choc qui l’amènera au rejet de la société et d’elle-même. Forte femme, elle décide presque par hasard de se lancer dans une guerre contre les dealers locaux qui n’hésitent pas à taxer un max de thunes aux autres vétérans/SDF pour l’accès aux simples médicaments, puisque leur gouvernement, leur pays semble les avoir abandonnés. Jun aura alors le choix entre continuer la guerre (comme Rambo, donc, jamais réellement revenu du Vietnam) ou se chercher un chemin de rédemption…
Dans la postface, Singelin cite lui-même les nombreuses références qui forment le creuset de sa BD. Dans le désordre, on aura Voyage au bout de l’Enfer, Akira, Ghost in the Shell, Jarhead, Apple Seed, Full Metal Jacket, etc. Et ça se sent, ça se voit, ça se vit dans les planches de P.T.S.D. Il a mis tout son cœur dans cette histoire de rédemption (est-ce réellement un spoiler ?), qui nous fait ressentir les affres de la guerre par les ravages qu’elle laisse sur les survivants. C’est en même temps triste, sombre et plein d’espoir. Je n’aurai qu’un reproche, cependant, à formuler : avoir fait le choix de la simplicité, de la trajectoire personnelle dans son scénario ampute la BD d’une partie de son intérêt. Le fait d’avoir rendu le conflit anonyme est malin, puisque toutes les guerres sont finalement pareilles et interchangeables. Mais ne donner aucun élément de contexte vraisemblable (pourquoi l’autorité semble-t-elle totalement absente ? pourquoi la ville dans laquelle Jun survit ressemble-t-elle à un creuset multiculturel sans que cela ne soit à aucun moment un enjeux du récit ? pourquoi avoir choisi de ne pas traiter la culpabilité de tuer l’ennemi mais uniquement celle de ne pas avoir sauver ses alliés ? etc.) ni réellement d’éléments de développement du psyché des personnages (je veux bien qu’un petit geste peut parfois faire la différence, mais l’évolution me semble ici radicale et peu nuancée/réaliste) handicape pour moi le récit.
Je suis du coup un peu passé à côté du message du syndrome post-traumatique, ayant eu l’impression que Singelin hésitait à le traiter de front et préférait naviguer autours de son sujet à l’aide, il est vrai, d’images fortes et de tensions omniprésentes. Reste un superbe objet hybride, qui fait la part belle à l’action et laisse peu de place à la réflexion. C’est un choix, évidemment. Qui entame cependant pour moi le propos de l’ensemble. L’univers graphique de l’auteur, assez différent du dessin peut-être plus naïf de The Grocery, vaut cependant largement le coup de la découverte. Du crayonné aux couleurs en passant par un chara design très marqué, on a là un artiste de la BD qui mérite certainement d’être suivi dans les prochaines décennies.

 De
De 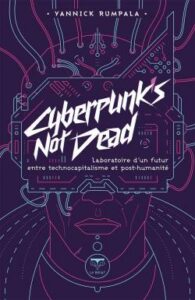 Sous-titré : Laboratoire d’un futur entre technocapitalisme et posthumanité
Sous-titré : Laboratoire d’un futur entre technocapitalisme et posthumanité De
De  De
De