
De Denis Villeneuve, 2017.
Poursuivant ma préparation personnelle au Dune 2020 de Villeneuve, j’ai donc revu récemment le Blade Runner 2049, de ce même Denis Villeneuve, que je n’avais pas revu depuis sa sortie cinéma. Le film m’avait marqué à l’époque comme un paris réussi : faire une suite au mythique classique signé par Ridley Scott en 1982 (faut-il le rappeler, année faste pour la SF au cinéma avec les sorties de E.T., Tron, The Thing, Dark Crystal, Conan et, donc, Blade Runner premier du nom). La suite de Villeneuve réussissait à mes yeux à rendre hommage à l’original tout en proposant quelque chose de neuf, de contemplatif et de spectaculaire, à contrario de ce qui fait le cinéma de SF hollywoodien de cette dernière décennie. Et cette nouvelle vision confirme mon avis d’alors.
Exit les cuts épileptiques, dehors les scènes flashy de destruction du monde : Blade Runner 2049 prend son temps pour nous raconter l’histoire, finalement intimiste, d’un androïde en quête d’identité. On y suit l’agent K (le même que celui du Château de Kafka ? Ou, référence plus subtile mais qui prend tout son sens quand on sait [SPOILER] ce que K fera pour l’agent Deckard [/SPOILER], à celui de Dino Buzzati ?), un réplicant blade runner chargé d’éliminer les derniers réplicants des séries défectueuses qui se rebellèrent contre leurs créateurs humains. Joué par le mutique (et donc parfait pour le rôle) Ryan Gossling, l’agent K (KD6- 1.7, pour être plus précis) est maltraité par ses collègues humains mais poursuit ses missions avec un professionnalisme de machine. Le film s’ouvre d’ailleurs sur l’une d’entre elles, puisque K est chargé de « déclasser » le réplicant Sapper Morton, joué par Dave Bautista (qui prouve ici qu’il est capable de jouer réellement). La mission ne se passe cependant pas tout à fait comme prévu, car K trouve sous la ferme hydroponique de Morton le cadavre d’une femme morte en couche. Femme réplicant. Ce qui pose un sacré problème à la police du Los-Angeles du futur, puisque ce qui sépare les réplicants des humains est justement la capacité à enfanter. Et K de se lancer donc dans la quête de cet enfant/messie, qui le mènera sur les traces d’un ancien blade runner qui a disparu de la circulation voilà maintenant 30 ans…
Et je vais m’arrêter là pour la partie « résumé ». Si vous ne l’avez pas encore vu, arrêtez donc de lire ce blog et filez voir ce petit bijou du 7ème art ! Car le film, en plus de nous proposer une histoire intéressante, prolongeant intelligemment le propos de son aîné en continuant à questionner l’identité, le réel et l’humanité en tant que concept (rappelons-nous que la nouvelle d’origine est signée Philip K. Dick, hein !), Blade Runner 2049 est également une exceptionnelle réussite formelle.
On ne louera en effet jamais assez la superbe réalisation de Denis Villeneuve et l’incroyable œil de Roger Deakins sur la photographie. La très grande majorité des plans sont à couper le souffle. Le Los Angeles du futur, noir et pluvieux, est une version magnifiée de celui du film de 1982, rendu plus ample par la technologie qui soutient le visuel sans jamais être une fin en soi. Mais c’est quand K sort du L.A. claustro-phobique développé par Scott dans le premier opus que Villeneuve et Deakins s’en donnent à cœur joie : les plans dans les banlieues de L.A. ou, plus tard dans le film, dans un Las Vegas post-apocalyptique sont à couper le souffle. Le rouge omniprésent dans le Vegas du futur, couplé aux formes fantomatiques des gigantesques statues qui accueillent alors K, en font un décor inoubliable.
Et ce n’est pas que dans les extérieurs que le film marque des points : le siège de la Wallace Corporation (qui remplace la Tyrell Corporation du premier film comme constructeur des réplicants) est aussi menaçant qu’éthéré. Le « bureau » de l’héritier Wallace (joué par un excellent Jared Leto, qui ferait définitivement mieux de se consacrer à son métier d’acteur au lieu d’amuser les minettes avec 30 seconds to Mars… [ironique d’imaginer que Villeneuve voulait engager David Bowie pour le rôle initialement, du coup !]) et ses reflets multiples est juste jouissif, comme décors de SF.
Et ce qui est particulièrement appréciable est le fait que le film prenne son temps, comme je l’ai déjà mentionné. Ces décors sont donc non seulement présentés (show-off), mais aussi exploités. Et prennent dès lors tout leur sens. Le bureau de Wallace n’est pas simplement un bureau de méchant lambda, c’est aussi une métaphore de la personnalité dérangeante de son occupant. Il est aussi calme, placide et accueillant qu’il peut être froid et mortel. Et cela se reflète dans cette pièce à mi-chemin entre le jardin japonais (pour son côté géométrique et ordonnancé) et la cellule psychiatrique. D’autres décors, plus anodins, comme l’appartement de K, sont aussi l’occasion de montrer qui il est dans la hiérarchie sociale de ce monde de demain, mais aussi de montrer qu’il a une personnalité malgré tout. Son « auxiliaire » personnel, la très belle Joi, marque son appartement de sa présence. Elle l’humanise, même si la distance est toujours présente (jusque dans la scène de sexe, extrêmement triste).
Le casting est, comme je l’ai déjà mentionné, superbement exploité. Même le bougon Harrison Ford, qui n’a plus de rôle à la mesure de son talent depuis de nombreuses années déjà, renoue ici avec bonheur avec le rôle de Deckard. Ce n’est évidemment plus le blade runner de 2019, mais il offre ici une évolution touchante de l’un de ses rôles majeurs (pour un acteur qui en incarne quelques-uns, des rôles majeurs dans l’histoire du cinéma). Loin du Han Solo de la nouvelle trilogie ou de l’Indiana Jones de l’infamant 4e épisode, Ford joue ici un personnage vieillissant, désabusé et seul, qui renoue par un hasard incroyable avec l’espoir. Pas l’espoir de l’humanité, mais simplement un aboutissement personnel.
Et c’est ce qui est sans doute le plus formidable dans Blade Runner 2049. Même si la thématique abordée pourrait bouleversé l’ordre du monde dans lequel l’histoire se situe, cette majestueuse fresque de SF nous raconte en fait des trajectoires très personnelles. K cherche ses origines, son identité. Dès que sa quête commence, le spectateur apprend qu’on lui donne un autre nom, plus humain et pourtant, bien sûr, générique : Joe. C’est Joe qui trouvera Deckard, pas K. C’est Joe qui trouvera la clé du récit, qui ira jusqu’au bout de sa quête, pas K. Et Deckard, enfin, pourra conclure l’histoire qu’il débuta 30 ans avant dans le premier Blade Runner. Il pourra, enfin, répondre aux questions de Rutger Hauer dans l’original : qu’est-ce qui définit finalement l’humanité ?
C’est là, enfin, que le film réussi son dernier tour de force. D’un contexte post-apocalyptique, noir et désolé, le message livre un message d’espoir là où Scott, en bon nihiliste misanthrope qu’il est, finissait sur une note de désespoir. Si Scott avait réalisé lui-même la suite, probablement n’aurions-nous pas eu une conclusion si ouverte à cette saga, mais aurions-nous en lieu et place un message plus sombre et fermé, pessimiste, comme Scott l’a livré avec Prometheus d’une part et Alien: Covenant d’autre part (films largement incompris et sans doute mal jugés – je vous invite à lire le numéro spécial de Rockyrama sur la saga Alien pour plus de détails). Blade Runner 2049 est donc un très très bon film. Sans doute l’un des meilleurs films de SF de ces 20 dernières années pour moi (avec Moon, Ex Machina et Interstellar). Le film est en plus servi par une bande son primitive, assourdissante parfois, qui rend hommage à la musique de Vangelis sur l’original tout en lui apportant une ampleur nouvelle et une variation bienvenue.
S’il faut cependant trouver un défaut au film, c’est sans doute à mes yeux dans le personnage de Luv, jouée par l’actrice néerlandaise Sylvia Hoeks. Je n’ai rien contre l’actrice qui joue là très bien le rôle de l’antagoniste. Je trouve en fait simplement dommage que le film ait eu besoin de ce personnage, ait eu besoin d’un antagoniste. Ses motivations sont compréhensibles, mais son acharnement sadique en font parfois un cliché hollywoodien. Cette seule concession à la trame normale d’un thriller de SF (il faut bien incarner le mal) rend mal dans le film. Les scènes où elle apparait semblent un peu forcées, certainement le combat final entre elle et K/Joe.
Au-delà de cette unique concession à la logique hollywoodienne, Blade Runner 2049 est un superbe film de SF qui développe une identité propre tout en étant cohérent avec son aîné, souvent considéré (et à juste titre) comme un chef-d’œuvre du genre. Denis Villeneuve démontre avec ce film qu’il sait faire un pied-de-nez aux grands studios et réaliser un film intelligent avec des moyens considérables. Bien sûr, le film demandant un peu plus de réflexion pour s’y immerger et pour le comprendre que les blockbusters moyens, le film ne connut qu’un succès en demi-teinte au box-office, malgré une très grande majorité de critiques (professionnelles ou non) positives. Il ne me reste donc plus qu’à espérer que Villeneuve réserve le même traitement intelligent et sans concession au remake/reboot de Dune qu’il signera en fin d’année.
PS: je ne parle pas des trois courts métrages présents en bonus sur le Blu-ray qui prolongent l’expérience à la manière des Animatrix. Je n’en parle pas parce que je n’ai pas grand-chose à en dire. S’ils apportent quelques éléments supplémentaires au récit et qu’ils explicitent un peu ce qui s’est passé entre 2019 et 2049 dans le monde de blade runners, ils sont relativement anecdotiques et ne sont absolument pas nécessaires à la compréhension du film. A regarder si vous avez le temps, mais vous ne ratez rien !
 De Ian McDonald, 2018.
De Ian McDonald, 2018.
 De
De 
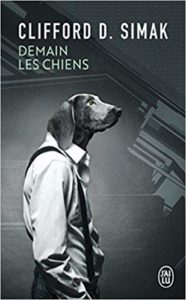 De
De  De
De