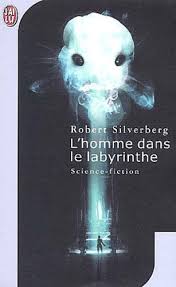 De Robert Silverberg, 1962.
De Robert Silverberg, 1962.
Robert Silveberg est une légende de la SF (et dans une moindre mesure de la fantasy, avec son Cycle de Majipoor). Le new-yorkais a écrit des dizaines d’œuvres qui sont devenus, au fil des décennies, des classiques indémodables. Il fut aussi le maître d’œuvre de la formidable anthologie « Légendes« , regroupant des novellas des plus grands auteurs de fantasy introduisant leur univers particulier (Stephen King avec La Tour Sombre, Georges R.R. Martin avec le Trône de Fer, Terry Pratchett avec les Annales du Disque-Monde, Terry Goodkind avec L’Épée de Vérité, etc.) Bref, en un mot comme en cent, un immanquable de tout bon amateur de SFFF.
L’homme du labyrinthe, publié au début des années 60, marque une transition entre sa première vie éditoriale, où Silverberg publiait énormément de nouvelles et romans de piètre qualité, s’assurant ainsi des revenues alimentaires qui lui étaient nécessaires, et une seconde vie éditoriale où il travailla davantage ses textes et livra de nombreux textes d’exception, souvent oubliés de nos jours. L’homme du labyrinthe est de ceux-là. C’est de la SF de papa, sans fioriture, avec un message fort et un ton assez désabusé/sombre. C’est à cette époque que Silverberg prend exemple sur ses aînés et que l’influence d’Asimov (avec qui il collaborera plus tard pour adapter certaines des nouvelles du maître en romans plus longs) se fait sentir : le récit se recentre sur l’essentiel, les effets de style passent à la trappe et le twist scénaristique devient la clé du développement scénaristique.
Le récit nous emmène sur une planète lointaine où un homme vit seul, reclus au sein d’un labyrinthe aussi ancien que mortel, coupé de l’humanité qu’il fuit autant qu’il méprise. Cet homme est Richard Muller, un aventurier, une légende de l’exploration spatiale, le premier homme a avoir un contact avec une civilisation extraterrestre. Ce contact l’a changé, l’a transformé. Depuis, il ne peut s’approcher de ses semblables pour des raisons que je ne dévoilerais pas ici pour éviter de vous spoiler sur le scénario. Malheureusement pour Muller, l’humanité a besoin de lui. Son ancien compagnon de route, le rusé et sans scrupule Charles Boardmann, dirige donc une mission pour récupérer Muller et le ramener à la civilisation. Pour ça, il faudra que Boardmann et son équipe affrontent les pièges mortels du labyrinthe et parviennent à manipuler Muller, l’un des hommes les plus malins et retord que l’humanité n’a jamais produit…
Avec le dernier paragraphe, je vous ai résumé une bonne partie de l’intrigue de la première moitié du bouquin. Et, il faut l’admettre d’emblée : c’est extrêmement efficace. Comme les nouvelles des pères de la SF contemporaines, L’homme du labyrinthe a cette particularité d’être un page-turner diaboliquement efficace. J’ai avalé les 200 et quelques pages du roman en quelques heures à peine et j’en suis ressorti plus que séduit. Silverberg (dont j’avais surtout lu des nouvelles jusqu’à présent) est très bon dans l’exercice. Ses personnages sont fascinants, son intrigue est retorse à souhait. Le classicisme du fond et de la forme (on parle quand même d’un bouquin du début des années 60) sont contrebalancées par un ton adulte et pessimiste, une ambiance de déliquescence qui fonctionne à merveille.
Le labyrinthe qui donne son titre au roman est un endroit froid, angoissant, maintes fois copiés depuis dans nombres d’œuvres qui n’ont ni le brio ni la tension qui se dégage de ce court opus. Hunger Game, pour prendre un nom connu de tous, fonctionne sur le même principe. Sauf que le labyrinthe de Silverberg est presque hygiénique dans son efficacité. Et beaucoup plus inventif dans ses pièges aussi divers que mortels. Mais plus encore que le labyrinthe en lui-même, ce sont les personnages qui fascinent. Boardmann le manipulateur est largement dépassé par Richard Muller, personnage tragique et pourtant attachant. On comprend rapidement qu’il n’aura pas d’autre possibilité que de se raccrocher à l’humanité, malgré ce que ce renouveau social lui coûte. Il est déjà « plus » qu’humain et cette inhumanité partielle rend ses dilemmes passionnant à lire.
Silverberg se paie en plus le luxe d’équilibrer les passages d’action pure avec des passages d’introspection et de dialogue qui fonctionne. Le sens of wonder, si cher à la SF classique, marche à merveille en enchaînant la décrépitude sans âge du labyrinthe de cette planète éloignée où Muller vit en ermite et des contacts avec des civilisations extraterrestres aussi originales qu’inquiétantes. Vous l’aurez compris à la lecture de cet avis au ton inhabituelle dithyrambique : c’est du très bon. Rapide comme un coup de poing, efficace comme une nouvelle d’Asimov ou d’Arthur C. Clarke, je ne saurais que trop vous conseiller de vous plonger dans ce classique de la SF. Dépaysement et réflexion garantis. Et (re-)découverte d’un auteur majeur du genre à la clé. Bonne lecture !

 De
De 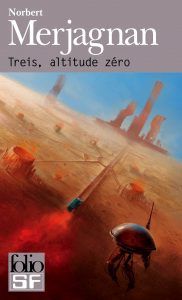 De Norbert Merjagnan, 2011.
De Norbert Merjagnan, 2011. De Norbert Merjagnan, 2008.
De Norbert Merjagnan, 2008.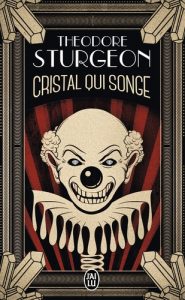 De
De