 De C.S. Lewis, 1945.
De C.S. Lewis, 1945.
Étant jusqu’au-boutiste par nature, j’ai finalement conclu la trilogie cosmique de C.S. Lewis avec ce troisième tome, réputé le moins bon (et le plus long). Vous vous souviendrez peut-être que j’étais resté relativement perplexe sur les deux premiers tomes, Au-delà de la planète silencieuse et Perelandra : ces allégories chrétiennes rédigées à la truelle, dont le message est assené avec la subtilité d’un sumotori dans un concours de danse classique, étaient une curiosité historique dans la longue histoire de la littérature de genre. D’aucun les considère comme des canons du genre de la S-F, au même titre que les romans d’H.G. Wells. D’aucun mais pas moi, ostensiblement.
Pourtant ce troisième tome est fort différent des deux précédents opus. Et la comparaison avec Wells est, du moins dans la première moitié du bouquin, nettement plus adéquate. Pas de réécriture d’un épisode de la Bible, ici. Pas de divinité tutélaire (et forcément chrétienne, pour Lewis, rappelons-le un converti tardif dans un pays qui ne tient pas la chrétienté en odeur de sainteté, sans mauvais jeux de mots… 🙂 ) dans les 250-300 premières pages de Cette hideuse puissance. Ici, pas de trace de Ransom, le professeur universitaire qui était le protagoniste principal des deux premiers tomes. Non, on suit ici les mésaventures de Mark Studdock, un jeune sociologue un peu niais qui veut absolument monter dans la hiérarchie de son petit collège (universitaire, à l’anglaise) de province, quitte à se fourvoyer dans des complots de bas-étages avec la frange iconoclaste, moderniste, de ses collègues.
Et on y suit en parallèle la trajectoire divergente de sa femme, Jane, une femme aux idées féministes que son mari délaisse en raison de ses ambitions professionnelles. Se construit alors un roman très anglais, en cela proche des ambiances du début de La Guerre des Mondes de Wells, avec une ambiance feutrée d’universitaires qui conspirent dans des salons enfumés, un verre de brandy à la main. Petit à petit, le brave Mark se retrouve presque malgré lui embarqué dans une histoire qui met en péril de le devenir même de son université : par des machinations machiavéliques, la frange progressiste est parvenue à vendre les terrains de la vénérable institution à un société moderne (moderniste, à nouveau ?), l’I.N.C.E. (Institut National de Coordination Expérimentale). C’est d’autant plus mystérieux lorsqu’on apprend que les terrains cédés abritaient une forêt enclavée depuis des temps immémoriaux, réputée pour être la dernière demeure du légendaire Merlin.
De son côté, Jane, la jeune mariée délaissée, commence à faire des rêves prophétiques effrayants. Elle y voit l’exécution d’un condamné à mort qui n’a lieu que le lendemain. Elle y voit aussi la mort d’un collègue de Mark, tué alors qu’il tente de quitter l’I.N.C.E. dans lequel son mari vient d’être intégré. Heureusement, un autre collègue de Mark, qui n’est nullement dans la même mouvance, la guide vers une communauté un peu spéciale, installée dans une grande demeure dans la commune proche de Saint-Anne. On y retrouve Ransom, celui des deux précédents bouquins, reconvertit ici en gourou démiurge entouré d’une clique de fidèles, humains et animaux (à la manière de Noé).
Et c’est là que le roman commence à déraper. Si les 250-300 premières pages (le roman en compte un peu plus de 500), bien que lentes, sont amusantes, ça commence à déconner quand Lewis se lance dans la morale. Dommage : l’auteur anglais avait mis en place une galerie de personnages intéressants (le vice-président de l’I.N.C.E. en tête, avec sa formidable façon de ne jamais être tranché ou affirmatif dans ses paroles), des pistes intrigantes et une mécanique de récit efficace. On sentait venir la prise de conscience du naïf Mark. Et on espérait un développement intéressant pour son épouse délaissée, par une utilisation cruciale de ses dons de voyance.
Mais tout tombe à l’eau. Au lieu de prise de conscience, c’est bien sûr l’épiphanie qui sauve Mark. Il trouve Dieu (dont le Nom est assez variable ici, comme dans les volumes précédents) et sait donc instinctivement quels sont les choix à faire pour lutter contre « cette hideuse puissance » (les forces du mal, la tentation, Satan, quoi). Et Jane, c’est encore pire : son don ne sert à rien et le message de Ransom, en gros, est de dire que ses ambitions féministes sont contre-productives et qu’elle se révèlera uniquement à travers son rôle de femme mariée, accueillante et soumise à son mari (ou presque). Aouch. Même replacé dans son contexte de 1945, ça fait mal par où ça passe, tellement c’est passéiste et conservateur.
Alors bien sûr C.S. Lewis n’était pas un grand libertaire, tout comme son ami Tolkien. Mais y’a une marge, quand même. Le Seigneur des Anneaux n’est certes pas moderne et son message est certes très classique, il est tout de même autrement plus riche que celui de cette trilogie cosmique. Les quelques emprunts de Lewis à son ami et collègue (l’île de Numinor -sic- y est citée à plusieurs reprises) n’y changent rien : il n’y a pas de souffle épique, pas de message qui transcende le récit dans la trilogie de Lewis. Elle finit comme les deux premiers tomes : la religion chrétienne est la seule voie, même lorsqu’elle se cache derrière un panthéisme qui ratisse tant du côté des Dieux extraterrestres que de la matière de Bretagne.
Lewis, je le répète convertit tardif, a sans doute développé encore davantage ce prosélytisme agressif en réaction aux horreurs du monde qui l’entourait. Il voyait peut-être la religion chrétienne comme la seule réponse au cancer de la civilisation qu’était (et est toujours) le fascisme. Peut-être. Mais cela survit mal au temps qui passe. La fin apocalyptique (pour les méchants uniquement, of course), d’une violence inspirée par l’Ancien Testament plus que par le Nouveau, est probablement la conclusion fantasmée par Lewis à la seconde guerre mondiale. Mais l’on sait depuis que la vraie happy ending n’arrive jamais. Le monde est gris et non dichotomique comme la lutte du bien contre le mal que Lewis présente ici comme une vérité absolue.
Cette hideuse puissance conclut donc cette trilogie par un roman beaucoup plus long, qui débute de manière beaucoup plus classique mais finit à nouveau dans une forme de salmigondis de morale chrétienne assez verbeuse et souvent déplacée. La traduction révisée de Maurice Le Péchoux pour l’édition Gallimard est sans doute plus proche du texte original que les éditions précédentes, mais il me semble qu’elle ne fait rien pour alléger le style parfois très ampoulé de Lewis lorsqu’il se lance dans la leçon de morale assenée avec des gants de boxe. Amateurs de bonne SF, même vieillotte, passez votre chemin et réservez ces heures de lecture à du Asimov : c’est beaucoup plus amusant et cela a nettement plus marqué l’histoire du genre, de fait.
P.S. : mais vous pouvez malgré tout louer mon courage : je n’ai pas laissé tomber à la moitié du livre pour me consacrer à autre chose. Lorsque je fais de mauvais choix, je les assume jusqu’au bout ! 😉

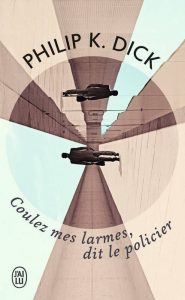 De
De 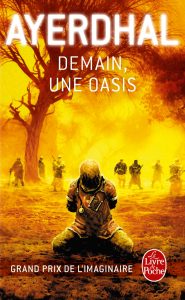 D’
D’ De
De 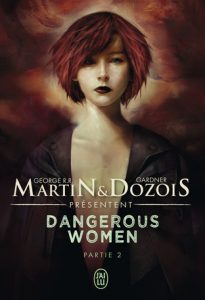 Édité par George R.R. Martin & Gardner Dozois, 2013.
Édité par George R.R. Martin & Gardner Dozois, 2013.