 De Rafael Pinedo, 2002.
De Rafael Pinedo, 2002.
Et plop! dans ta gueule ! Décidément, la SF argentine n’est pas tendre. Quelques mois après Berazachussetts, je m’attaque à un autre (court – 140 pages) roman d’anticipation argentin. Et ça fait mal par où ça passe. Là où Berazachussetts, par son côté grotesque, pouvait faire sourire, ce n’est pas le cas avec Plop. Pas du tout. Du tout du tout du tout.
Plop est le nom du protagoniste principal. Il s’appelle comme ça car quand sa mère a accouché en marchant derrière sa tribu, il est tombé directement dans une flaque de boue. Et ça a fait plop. Pas de chance pour lui, Plop est né dans un univers post-apocalyptique où les rares humains survivants vivent en bande et écument la plaine, invariablement grise et boueuse, à la recherche de quelque chose à manger. Il pleut tout le temps. Heureusement, car seule la pluie est potable, le sol étant rongé par des maux divers et variés.
Heureusement pour Plop, même si sa mère meurt rapidement et est mangée par la tribu, il est recueilli par la vieille. Elle ne fait pas de cadeau, mais se dit qu’on pourrait faire quelque chose de lui et décide de ne pas le « recycler » tout de suite. Du coup Plop grandit. Il se fait quelques amis chez les autres enfants. Puis, il apprend à mentir, à tuer, à abuser des autres. Car Plop est rongé par l’ambition. L’ambition d’être autre chose, d’être quelqu’un d’autre, d’être le chef. Il veut plus. Il veut différemment.
Et rien ne nous sera épargné : cannibalisme, torture, viols, esclavagisme, etc. Le roman est crû, brut, violent et malsain. C’est même d’ailleurs l’un des textes les plus malsains qu’il m’ait été donné de lire. Je n’ai plus eu ce sentiment de dégoût en lisant un bouquin depuis sans doute Rêve de Fer, de l’inénarrable Spinrad (pour d’autres raisons que la violence crue, mais c’est également, dans son genre, un livre très dérangeant).
Pinedo a peu écrit. Mort trop vite, il n’a laissé que trois romans : Plop, Frio (pas encore traduit) et Subte (posthume, pas encore publié). Il semble qu’il ait écrit davantage, dans sa jeunesse, mais il aurait tout brûlé par insatisfaction. S’ils étaient du même tonneau que Plop, je peux imaginer, comme auteur, que l’on se pose des questions, en effet. Quel héritage laisse-t-il ? Un Mad Max sous acide, sans espoir, et nettement moins tout public ?
Mais Plop est aussi un roman de survie. Au-delà du torture porn à la Hostel!, Plop nous raconte la montée en puissance d’un enfant qui ne se laisse pas faire et qui est prêt à tout, y compris le pire, pour dépasser les autres. Pour survivre et régner. Bien sûr, et c’est le propre des conquérants mégalomaniaques, sa propre ambition le perdra. De sa quête initiatique jusqu’à sa quête du pouvoir absolu, Plop sera toujours insatisfait. Il sera toujours déçu par les autres et décevra toujours les autres.
Plop est une expérience ; un formidable et horrible roman à ne certainement pas mettre entre toutes les mains. C’est immonde et fascinant d’assister à la montée en puissance d’un psychopathe, d’un dictateur fou. La perfection de l’horreur. La fascination du laid. Un grand moment de lecture, bien que je sois incapable de dire si c’est un bon livre ou non. Ou même si je devrais le recommander.

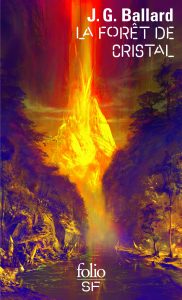 De
De  De Joe Haldeman, 1976.
De Joe Haldeman, 1976. De
De 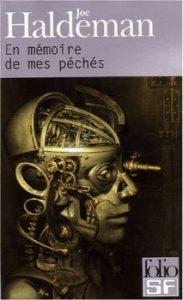 De
De