 D’Orson Scott Card, 1990
D’Orson Scott Card, 1990
Bragelonne fait œuvre utile en republiant une nouvelle fois le désormais classique « guide » rédigé pour tous les apprentis nouvelliste en SFFF par nulle autre qu’Orson Scott Card, l’homme derrière la saga Ender (entre autres choses). Comme tous les blogueurs rédigeant des critiques et avis dans mon antre numérique, je suis bien sûr caressé de temps à autre par la tentation de prendre la plume et tenter de rédiger quelque historiette matinée de fantasy, de fantastique ou de science-fiction (ma préférence l’écriture suivant cet ordre précis). Mais comme tous les procrastinateurs, le taux de publication sur ce blog en témoigne, je remets évidemment toujours cela au lendemain.
Inspirant, donc, sans doute, de se plonger dans un guide sur le « comment faire« . Devenir Asimov ou Howard pour les nuls, en somme. En gros, le court essai de Scott Card débute par sa définition des sous-genre, élément fort important si l’on entend percer sur le très segmenté marché américain (ce qui est moins vrai dans nos contrées où les frontières sont volontiers plus floues). Puis viennent quelques commentaires sur la construction d’un récit de SF ou de fantasy, les diverses thématiques, la manière de les aborder, les questions de points de vue ou encore le niveau de langage. Enfin, Scott Card clôture en parlant de son expérience personnelle d’écrivain de SF et ce que cela signifie dans sa vie privée (faire tenir son couple, gérer son blé, etc.)
Et tout ça est très fluide, ponctué d’anecdotes et de name-droping, un peu ancien, il est vrai. Amusant, d’ailleurs, de se rendre compte au détour d’une phrase que le bouquin à bientôt trente ans : Robin Hobb y est citée comme « une petite jeune dans le domaine, qui vient de sortir son premier roman » ! Scott Card a, en plus, cette faculté commune chez les grands auteurs anglo-saxons « d’écrire sans style« . Je veux dire par là qu’il travaille tellement son texte qu’il semble aller de soi. Le forme ne vient jamais parasité le propos, ce qui requiert de l’auteur un grand travail pour sembler écrire un langage parlé, alors que c’est tout sauf le cas. Asimov, pour le citer une seconde fois, en était le meilleur exemple : un style direct et simple qui soutien à tout moment le fond en prenant le lecteur par la main, comme dans les histoires que nos parents nous lisaient étant jeunes. Et Scott Card d’appliquer cette recette à ce court essai, qui se lit très vite.
Est-ce pour autant un immanquable ? Mon avis est, là, plus mitigé. Car si le livre s’appelle Comment écrire de la fantasy et de la science-fiction, il n’aborde en fait presque pas le « comment écrire ?« . Scott Card renvoie à d’autres livres qui aborde le sujet et se contente de dire que nous (=ses lecteurs en quête de conseils) avons déjà fait nos classes. On voit par ailleurs aux détours de certaines phrases que, pour Card, bien écrire ne s’apprend pas réellement. Soit on l’a en soit, soit on doit le travailler. Mais, même dans la deuxième option, c’est un travail essentiellement introspectif. Il relativise grandement l’intérêt des cours d’écriture ou même des cercles/clubs d’écrivains débutants. Il n’y voit qu’une opportunité, il le concède souvent utile, de tester un texte sur un lectorat témoin. Et une possibilité pour l’écrivain, troglodyte par fonction, de sortir de chez lui et de parler à d’autres êtres humains. Pour le reste, il est relativement muet sur sa propre méthode (que l’on peut cependant deviner à travers le découpage de ses chapitres de conseils) et ouvre des portes plutôt qu’il ne les ferme.
Cet essai, dans cette édition révisée par Bragelonne (plusieurs passages, traitant uniquement du marché de l’édition nord-américain et, par ailleurs, fort datés, ont été supprimé avec l’accord de l’auteur pour être remplacé par des notes en bas de page assez complètes sur le monde de l’édition SFFF francophone actuel) est donc une lecture intéressante, mais insuffisante, pour celui ou celle qui chercherait une véritable méthode. Il est sans doute un bon compagnon à des lectures plus complètes visant à aider les angoissés de la page blanche, comme moi, qu’elle contienne de la SFFF ou non.

 De
De 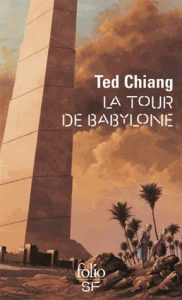 De
De  De
De 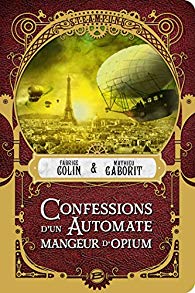 De
De