 De Ron Howard, 2018
De Ron Howard, 2018
Solo a la particularité d’être le premier Star Wars dont personne n’attendait rien. Alors que la troisième trilogie est le sujet de polémique préféré de tous les geeks de la planète (après un épisode VII hommage et un épisode VIII qui casse -souvent maladroitement- les codes) et deux ans après Rogue One qui entamait de façon inattendue mais brillante les spin-offs, Disney/Lucasfilm nous propose donc une « origin story » de celui qui reste pour beaucoup le personnage préféré de la première trilogie.
Et de Solo, il en est beaucoup question dans ce nouveau long métrage. Peut-être même un peu trop. De fait, le film tente tellement d’expliquer toutes les petites allusions à la vie passée d’Han Solo qui émaillaient la première trilogie qu’il ne laisse pratiquement plus aucune zone d’ombre. Sachant que Solo se termine sur un méchant cliffhanger qui ne peut qu’appeler une (ou des?) suite(s), l’on peut raisonnablement se poser la question de ce qu’il restera à développer comme « Star Wars lore » dans le ou les prochains.
Mais, au-delà de ce problème de fanboy, que peut-on retenir de cet opus particulier ? Et bien, en résumé, que c’est un bon divertissement. Bien sûr, ce n’est pas le film du siècle, ni dans la forme, ni dans le fond. Mais ça reste très agréable à regarder et les deux heures du long passent sans longueur aucune. Pourtant, la production du film fut plus que chaotique. Les deux réalisateurs engagés sur le projet, Phil Lord et Christopher Miller, ont gentiment été dégagé du film après 5 mois de tournage. On ne peut qu’imaginer les discussions enfiévrées au board de Buena Vista quand ils ont vu les premiers rushs et qu’ils ont découvert ce qui semblait être, dans son premier montage, une comédie loufoque.
Sans doute Lord et Miller ont-ils tenté le virage Marvel/MCU pris avec, par exemple, Les Gardiens de la Galaxie ou Thor:Ragnarok. Ils ont du se dire : « Hey! Y’a un public pour les comédies de SF loufoques à 180 millions de dollars la prod. Faisons de Solo un produit comique, puisque Han est quand même l’un de seuls personnages drôle/cynique de la série« . Sauf que non, visiblement, ça n’a pas marché. Chat échaudé craint l’eau froide, comme dirait feu ma grand-mère : après le viandage complet des tentatives d’humour de l’épisode VIII, grand-père Lucas veillait au grain et a probablement engueuler la petite Kathleen Kenedy au téléphone pour lui dire qu’elle déconnait plein tube. Du coup, basta les deux petits jeunes. Appelons une valeur sûre d’Hollywood (et, surtout, un très vieux pote de Lucas).
C’est donc le vétéran Ron Howard, que Lucas casta dans son second long, American Grafiti, qui pris les manettes du spin-off cinq mois après le début du « principal photography« , comme disent nos amis anglo-saxons. Sur un tournage probablement prévu en six mois. En dernière minute, donc. Et il ne s’est pas contenté d’adapter à gauche à droite ou de tenter de sauver le film en salle de montage (la bonne vieille technique de Lucas, le monteur qui se rêvait réalisateur mais qui déteste tourner). Howard a retourner entre 70 et 80% du film. Autant dire que c’est son film et qu’il ne reste que des bribes, par-ci par-là, du film initialement tourné (peut-être peut-on considérer le duo de réalisateurs originaux comme les réalisateurs de la seconde équipe ?)
Et, sans surprise, Ron Howard fait du classique. Comme il l’avait fait avec ses honnêtes adaptations du Code Da Vinci et ses suites, Howard ne prend que peu de risques et livre le film qu’on attend de lui : un film de SF avec du fan service, des scènes d’action, quelques blagues par-ci par-là et, bien sûr, de nouvelles planètes et autres extra-terrestres exotiques. La réalisation alterne le correct (la première scène de course-poursuite sur Corellia qui fait penser à du R-Type… sans la vitesse) et le spectaculaire (la scène du vol sur le train est sans doute le pic dramatique du film). Les acteurs ne détonnent pas, même Emilia Clarke, qui avait pourtant livrer une bien piètre interprétation dans son premier grand rôle post-Daenerys Targayen, à savoir Sarah Connor dans le très oubliable dernier opus de la franchise Terminator. Sont-ils pour autant bons ? Pas réellement, en fait. Ils font le boulot. Alden Ehrenreich, en particulier, qui reprend ici sur ses épaules méconnues la veste en cuir mythique d’Harrison Ford, est assez transparent. Même lorsqu’il mime les poses de Ford, on n’y croit qu’à moitié, car le personnage n’a pas encore l’ampleur qu’il aura dans la première trilogie. C’est juste, ici, une petite frappe qui a plein de rêves de noblesse en tête. Du coup, même s’il n’est pas mal joué, il n’a pas non plus l’impact que l’on espérait de lui.
Abordons maintenant le fond (et, donc, alerte SPOILER) : comme je le disais plus haut, Solo remplit le cahier des charges d’un Star Wars. Le jeune Han est un pauvre gamin exploité par un syndicat du crime relativement anonyme sur Corellia. Mais il voit une opportunité de se barrer avec sa copine lorsqu’il double ses propres chefs pour piquer un ressource naturelle rare à son propre compte (le McGuffin du film). Après moult courses poursuites, Solo parvient à s’envoler vers des cieux meilleurs alors que sa copine est bloquée sur Corellia. Il n’aura donc de cesse de réaliser un gros coup pour retourner sur Corellia chercher sa copine. Mais… On le retrouve quelques années plus tard alors qu’il a fait ses classes à l’Académie de l’Empire (si-si, mais, ça, on le savait grâce à l’univers étendu de Star Wars). Bon pilote, il s’est fait réaffecter à la piétaille en raison de son insubordination. Du coup, quand il voit l’occasion de se barrer avec une équipe de voleurs locaux (menée par Woody Harrelson, égal à lui-même), il n’hésite pas. Embarquant au passage un gentil Wookie qui se trouvait là (sans blague!), le voilà intégré dans une petite équipe de pirates de l’espace (le premier qui siffle le générique de Cobra prend un claque sur le pif) avec son side-kick éternel, le poilu Chewie.
Dans cette équipe, il flaire le gros coup : ils vont piquer un wagon complet de ressource naturelle (la même qu’au début, oui, ça fait répétition) et se faire un max de thunes. Mais, pas de bol, ça ne se passe pas comme prévu et les voilà rendus responsables du fiasco. L’équipe de voleurs travaillait en fait pour l’un des trois/quatre grands syndicats du crimes interstellaires, l’Aube Dorée (à ne pas confondre avec le parti d’extrême-droite grec). Comment se racheter devant le potentat local ? Simple, en allant voler une autre quantité de ressources naturelles (toujours la même, ça commence à faire gimmick), non-raffinée, directement dans les mines. Et, par hasard, il se trouve que la copine initiale de Corellia travaille pour le même patron local du crime. Amazing !
Et la joyeuse équipe d’aller piquer le Millenium Falcon à Lando, de faire le Kessel Run en 12 parsec (c’est toujours une unité de distance, pas de vitesse… ^_^;;) et de tirer en premier (car, oui, Han Solo tire en premier). La seule réelle surprise pour moi est d’avoir exploité officiellement dans un film l’univers étendu de Star Wars. De fait, le nouveau méchant, le patron du syndicat du crime, n’est autre que le brave Darth Maul (on insiste d’ailleurs bien sur son double sabre-laser, plan totalement inutile autrement que pour signaler à l’audience inattentive que c’est bien Darth Maul, oui-oui). Les séries TV/animés de Star Wars avaient déjà exploité cet arc, avec Darth Maul, son frère Savage Opress et le chasseur Aura Sing (dont on apprend ici qu’elle a été tué par le mentor de Solo, Woody Harrelson). Mais tout de même, c’est amusant de retrouver un pont avec la prélogie de Lucas, maintenant assumée.
Que retenir de tout ça, me direz vous ? Et bien, un divertissement honnête et sympathique. On rigole, on fait les casse-cous, on se bat au pistolaser (et non au sabre, laser). Le film du siècle ? Certainement pas. Un ajout essentiel à la mythologie Star Wars ? Non plus, malgré que l’équipe ai fait appel au vétéran Lawrence Kasdan, secondé par son propre fils au scénar. Mais un divertissement honnête. Comme je n’en attendais rien de particulier, je n’ai pas été non plus déçu d’une manière ou d’une autre. Au contraire, dans sa simplicité, Solo est finalement assez humble, quand on le compare aux grosses machines du MCU (Marvel Cinematic Universe, pour les inattentifs). Si le film ne se plante pas totalement au box-office (ce qui semble le cas), j’irai certainement voir le second avec plaisir. Ou pas, donc.
 La trilogie cosmique, tome II
La trilogie cosmique, tome II
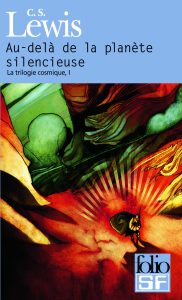 La trilogie cosmique, tome I.
La trilogie cosmique, tome I. Divers, 1950-1970
Divers, 1950-1970 De
De  De
De