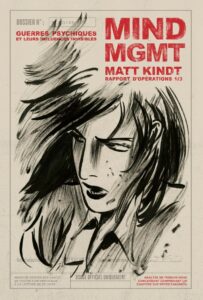 De Matt Kindt, 2012-2015.
De Matt Kindt, 2012-2015.
Il y a bien longtemps en ces lieux, je m’exprimais déjà sur un autre comics indé de Matt Kindt, Du sang sur les mains, également publié aux formidables éditions Monsieur Toussaint Louverture. Prenons d’ailleurs quelques minutes, avant d’entrer dans le vif du sujet, pour une fois encore féliciter en encourager ladite maison d’édition. Née de rien il y a quelques années (de l’amour de l’impression, en fait, et d’un goût certain pour la littérature américaine sous toutes ses formes), l’éditeur a grandi pour s’imposer maintenant avec un catalogue cohérent, intelligent et accessible, tant en romans (avec de belles éditions grand format luxueuse suivie de version semi-poche très abordables) qu’en BD/comics.
Et c’est un véritable travail d’orfèvre qu’ils ont dû réaliser sur l’édition en trois tomes omnibus du roman graphique de Kindt. Moi, ce que j’aime, c’est les monstres d’Emil Ferris était déjà un exploit d’adaptation, justement reconnu à Angoulême. Et bien l’équipe de Toussaint Louverture réédite la performance avec l’adaptation de MIND MGMT. Chaque centimètre carré de chacune des planches est exploité par Kindt qui y glisse volontiers des indices, des explications ou des élucubrations diverses. Et l’adaptation française reprend cela à merveille sans rien entamer de la mise en page très recherchée et parfois carrément déstructurée de Kindt. Graphiquement, l’auteur continue d’exploiter le filon entamé avec Du sang sur les mains et son crayonné tantôt esquissé, tantôt plus travaillé. Le dessin a cependant plus d’ampleur et plus de constance que dans l’œuvre précédente et on sent bien la patte artistique qui se dégage. Au-delà des personnages, de leurs expressions faciales souvent fort bien rendues et dynamisme du trait, on retiendra cependant surtout un travail de mise en page aussi osé que significatif dans le récit.
Et qu’en est-il, de ce récit, justement ? Et bien c’est sans doute mission impossible que de le résumer en lui faisant honneur. En effet, MIND MGMT est un récit à tiroirs, où chaque vérité en cache une autre, progressant de digression en digression et d’époque en époque (évidemment pas dans un ordre linéaire). Le récit s’ouvre sur le quotidien de Meru, une autrice/journaliste en manque d’inspiration qui décide d’enquêter sur l’affaire étrange d’un vol à bord duquel tous les passagers ont perdu la mémoire, à l’exception d’un enfant et d’un passager qui semble avoir disparu à l’atterrissage. Bien vite, elle se lance en quête de ce dernier pour comprendre ce qui est arrivé. Mais avant d’atteindre son but, elle est contactée par des agents du FBI qui semblent s’intéresser très fort à ses recherches et est, parallèlement, poursuivi par deux tueurs que rien ne semble arrêter.
Derrière tout ceci, on comprend vite que se cache une organisation secrète, le Mind Management, qui regroupe des individus divers qui présentent un « don » (influencer les autres, lire l’avenir, persuader par le chant, effacer la mémoire, etc.) Ces « mutants » semblent cependant avoir été abandonné par leur pays, après que l’un d’eux ait causé un massacre ayant emporté la moitié des habitants de Zanzibar une quinzaine d’années plus tôt. Et c’est précisément cet ex-agent en fuite que Meru tente de retrouver sans le savoir…
Complot, espionnage, super-pouvoirs, amnésie, action et réflexion sur la nature humaine sont au programme de ce comics indépendant. Partant d’un postulat courant dans le genre, des mutants à la X-Men, MING MGMT traite son sujet de façon adulte, sombre et souvent mélancolique. S’il y a bien sûr un secret à découvrir, un méchant à affronter, c’est surtout le parcours initiatique de Meru et de ses quelques alliés qui est au cœur de la BD. C’est la véritable force de MIND MGMT : à travers ses indices savamment distillés au fil des planches, c’est un véritable drame humain qui se joue. Les motifs qui animent les personnages les remettent à notre niveau : vengeance, amour, soif de démontrer sa supériorité, faiblesse, abandon. Voilà qui ramène ces super-héros potentiels à ce qu’ils sont fondamentalement : des types comme vous et moi qui n’ont pas forcément choisi ce qui leur arrivait et qui n’ont pas la possibilité de faire machine-arrière, leur mutation les rendant par trop différents. Le parallèle avec X-Men est évident, mais le traitement est réellement différent : beaucoup plus adulte, conscient de soi.
Cependant, je dois bien l’avouer, MING MGMT, auréolé de son statut de perle de la BD américaine indépendante, ne m’a pas convaincu à 100%. Verbeux par moment, parfois un peu fatiguant à lire à tel point les planches peuvent être chargées d’informations parasites (dont on a peur qu’elle nous échappe, nous privant ainsi d’une clé de compréhension essentielle, alors qu’elles sont souvent anecdotiques), j’ai eu un peu de mal à entrer dans le récit et à réellement me sentir concerné par le devenir de Meru. Comprenons-nous bien : c’est de la très bonne BD, intelligente et bien écrite. Mais le scénario est parfois tellement (volontairement) déconstruit, faisant ressembler l’ensemble à une grande poupée gigogne dont on aurait mélangé les morceaux (je sais, c’est impossible, mais je n’ai pas trouvé mieux comme image !), que je me suis un peu paumé de temps à autre et qu’il a fallu faire un effort pour retourner dedans. Or, une lecture ne devrait pas demander d’effort inutile.
Comprenez-moi bien : le propos d’une œuvre peut être complexe et la compréhension malaisée (j’ai essayé de lire Arendt dans le texte plusieurs fois déjà, mais mon petit cerveau n’est malheureusement pas assez développé pour suivre !), ce n’est pas un souci. Là où j’ai du mal, c’est quand l’effort requis devient un gimmick : c’est de la BD intelligente car il faut faire un effort pour comprendre. Non : Shangri-la est de la BD particulièrement maligne et sa lecture est autrement plus fluide (alors que les concepts traités sont tout aussi sérieux, sinon plus). Bref, je crains que Kindt ne se soit un peu perdu dans des circonvolutions très chics, mais qui desservent son propos et, plus globalement, l’œuvre qui nous occupe aujourd’hui. Je passe rapidement également sur le dénouement qui est un ton en deçà des deux premiers tomes et qui semble à contrario un peu facile.
Retenons simplement que MIND MGMT est certainement une bonne BD, dont la patte graphique et la richesse du scénario valent certainement le détour. Je trouve seulement dommage que son auteur ait probablement un peu exagéré le côté « regardez-moi, je fais de la BD underground intellectuelle !« . L’œuvre aurait été un film (je ne le dis pas au hasard, bien sûr, les droits d’adaptation ayant été acheté depuis longtemps), on l’aurait dit calibré pour le Sundance. On a connu pire comme référence. Mais on a aussi connu mieux, comme bilan final.

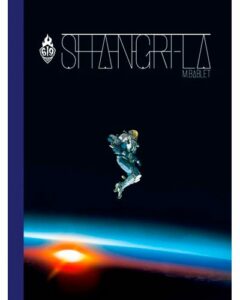 De
De 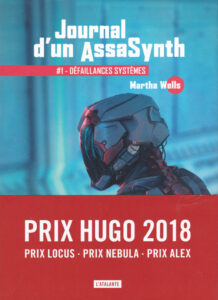 Journal d’un AssaSynth – 1
Journal d’un AssaSynth – 1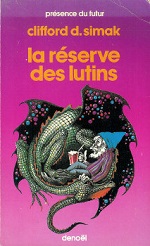 De Clifford D. Simak, 1968.
De Clifford D. Simak, 1968.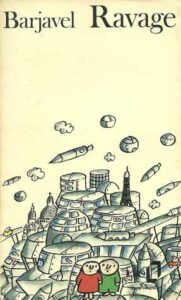 De
De