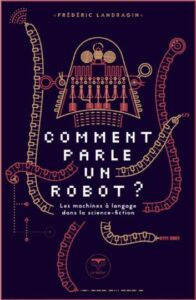 Sous-titré : Les machines à langage dans la science-fiction
Sous-titré : Les machines à langage dans la science-fiction
De Frédéric Landragin, 2020.
J’avais déjà abordé un ouvrage de la collection Parallaxe dans ces colonnes, avec l’excellent Station Métropolis Direction Coruscant. La collection du Bélial’ (qui est définitivement l’une des maisons d’édition de SFFF francophone les plus dynamiques et intéressantes à suivre) a, pour rappel, pour objet de laisser la parole à des universitaires mordus de SF. Ils exposent ainsi leurs thèses, appartenant la plupart du temps au domaine de la futurologie, en les argumentant par des exemples issus de la littérature SF ou du cinéma SF de ce dernier siècle. L’exercice peut sembler illusoire sur le papier, mais cela donne des thèses scientifiques intéressantes à envisager pour le futur, en les raccrochant à ce que la réalité d’aujourd’hui réalise en effet déjà (et ce qui est en développement à court terme).
Le précédent livre chroniqué ici parlait d’architecture et de géographie urbaine. Celui-ci est d’un tout autre domaine. Frédéric Landragin, directeur de recherche au CNRS, est un spécialiste de la linguistique, spécifiquement computationnelle depuis de nombreuses années. Il a d’ailleurs déjà signé un autre titre dans la même collection, consacré quant à lui au dialogue avec les potentielles intelligences extraterrestres.
Et Landragin de développer, de manière très didactique, ce qu’est la capacité de parole, de dialogue d’un robot. L’illustrant par des cas aussi célèbres que le T-800 ou HAL, Landragin scinde bien les différents types d’interlocuteurs machines auxquels nous pourrions avoir (ou avons déjà) affaire. Il distingue ainsi les chatbox évolués, les assistants personnels du type d’Alexa ou Siri des véritables robots parlant. La clé, comme souvent, est la capacité de l’IA. Ou, plus précisément, la présence d’un IA véritable, basée sur du machine learning, ou d’une IA à capacité réduite comme le sont les chatbox précités. Cependant, même dans le cas du machine learning, Landragin s’évertue à nous démontrer que le langage est une chose complexe et, à travers de exemples célèbres et historiques (en linguistique), nous pointe les pièges que seul la connaissance du contexte d’une conversation peut éviter. Et c’est précisément sur ceci que les machines achoppent, quel que soit leur degré de complexité et de raffinement.
De fait, si les quiproquos et les malentendus sont légions dans le dialogue humain-humain, il ne peut en être autrement dans le cas du dialogue humain-machine. Ce n’est pas demain, donc, que nous pourrons dialoguer avec un véritable C3PO. Ou même avec le Robby de Forbidden planet. Même l’illusion d’un véritable babelfish, formidable invention de Douglas Adams dans le The Hitchhicker’s Guide to the Galaxy (reprise bien des années plus tard par l’un des ancêtres de Google, AltaVista) est encore un doux rêve. Si DeepL donne de meilleurs résultats que Google Translate, il n’en demeure pas moins que les résultats des traductions automatiques sont et resteront encore pour longtemps fort limités.
Comment parle un robot ? est donc un livre assez savant qui, de manière je le répète fort didactique, prend son lecteur par la main pour lui ouvrir les portes de la linguistique computationnelle. J’ai pourtant eu un peu de mal à finir le livre : emporté par son sujet, Landragin se lance dans des démonstrations parfois assez longues et assez techniques qui m’ont, je l’avoue, lassé. Si le domaine m’intéresse, je suis trop néophyte que pour suivre aisément une conversation d’expert comme il nous propose ici. Et si les exemples issus de la SF grand publics émaillent en effet le bouquin, ils sont finalement assez accessoires par rapport au propos, intéressé davantage par l’état de l’art d’une discipline actuelle que réellement tourné vers un avenir moins proche de nous. Peut-être est-ce ici la frustration de me dire que je ne dialoguerais pas de manière soutenue avec un robot de mon vivant, ce que le livre démontre très bien, qui terni pour moi l’expérience de lecture ? C’est sans doute le cas et il ne faut donc pas tenir compte de mon relatif ressentiment envers l’auteur. Le fait qu’il m’ait un peu « gâché mon plaisir » (!) n’enlève en rien l’intérêt de son essai. Son côté très technique, cependant, lui fermera sans doute les portes d’un public plus large. Ce n’est évidemment pas l’ambition de la collection Parallaxe, mais je n’ai pas ressenti ça à la lecture de l’autre livre. La mayonnaise n’a donc pas tout à fait pris pour moi sur cet essai en particulier…

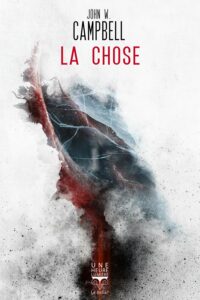 De
De 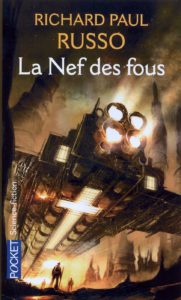 De
De 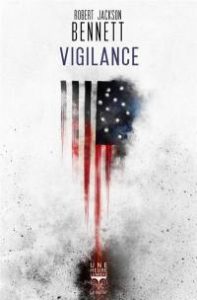 De
De 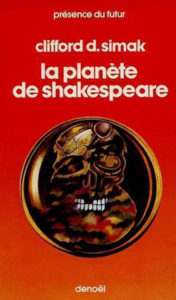 De
De