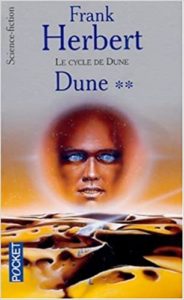 De Frank Herbert, 1965.
De Frank Herbert, 1965.
Comme je l’avais annoncé il y a quelques mois déjà, lors de l’avis sur la version « longue » du Dune de Lynch j’avais prévu de lire le roman d’Herbert pour me préparer à la nouvelle adaptation de Villeneuve toujours prévue pour la fin de l’année (2020). C’est désormais chose faite. Le roman de Dune et moi avons une longue histoire en commun. J’avais déjà essayé, dans mon adolescence, lors de ma première période de lecture de SFFF (un jour, je reviendrai sur ceci, mais ce n’est sans doute ni le lieu ni l’instant pour le faire), de m’attaquer au classique d’Herbert. Celui qui fut considéré comme le Seigneur des Anneaux de la SF par la génération du papy-boom m’était alors tombé des mains après une centaine de pages. Je ne sais si c’était la traduction parfois volontairement archaïque ou le rythme très particulier du roman qui était en cause, mais le fait est là : alors que j’éprouvais déjà une fascination un peu incompréhensible pour l’adaptation de Lynch, je restais hermétique à l’original.
Maintenant que je suis sans doute un lecteur plus sage ou, à tout le moins, plus endurant et ayant derrière moins nombre de classiques plus archaïques et difficiles d’accès, il me fallait à nouveau m’attaquer au monstre. Bilan de l’opération et pour ne rien vous cacher, je suis assez mitigé maintenant que ces 600/700 pages (divisées en deux tomes, stratégie commerciale bien connue de Pocket à l’époque et encore largement pratiquée par J’ai Lu actuellement) sont derrière moi. Pour tout un tas de raisons que je vais essayer de vous exposer ci-après.
D’abord et en premier lieu, ce qui me frappe est que l’adaptation de Lynch que je croyais assez foutraque est en fait très proche du roman. A tel point que nombre de dialogues du film, surtout dans sa première moitié, sont directement repris du roman (en ce compris les monologues intérieurs des nombreux personnages). Ce qui signifie que le gentil bordel de la seconde moitié (en gros, à partir du moment où Paul Atréides est exilé dans le désert) du film correspond aussi à un gentil bordel dans le roman. Pas avec le même but, cependant : là où le film développe Paul/Muad’Dib pour en faire un leader politique de la résistance fremen (en plus d’accomplir sa vengeance personnelle), le roman en fait un véritable messie. Voir un dieu. Avec ce que cela comporte de mystique et d’ambiguïté scénaristique.
Car si le film prend des libertés avec le roman (les fameux et un peu ridicules modules étranges, armes répondant à la voix de son porteur, n’existent simplement pas dans le roman ; nombre de personnages secondaires ont une importance beaucoup plus grande dans le roman, etc.), on ne peut réellement le lui reprocher : c’est le lot de toutes les adaptations. Résumer 650 pages en 2h30 implique de faire des choix. Même lorsque l’équipe a plus de 12h, des choix sont également faits (n’est-ce pas, Peter Jackson ?). Simplement parce qu’un film n’est pas un livre et que certains éléments qui marchent dans l’un ne peuvent pas marcher dans l’autre. J’en veux pour preuve la scène épique du roman où Paul chevauche un vers géant pour la première fois qui est, il faut bien l’avouer, assez ridicule dans le film.
Mais nous ne sommes pas là pour parler du film, même si l’on peut s’en servir comme contrepoint intéressant pour mettre en lumière d’éventuels défauts du roman. Pour faire simple, Dune, le roman, a un défaut assez clair : il est trop long. Je n’ai rien contre les romans longs. Lire 1000 pages quand elles sont passionnantes ne me rebutent pas. Mais Hebert, pour une raison que j’ignore, use et abuse de la redite dans son titre phare. Peut-être le caractère épisodique de la publication originale (Dune fut en effet publié en huit parties dans la revue de SF Analog entre 1963 et 1965 avant d’être réunies en un seul et même volume la même année) a-t-elle forcée Herbert à ces redites, ces re-contextualisations successives dans les diverses parties du roman, histoire de ne pas perdre le lecteur du « feuilleton » original ? A bien y réfléchir, c’est sans doute moins une question de longueur que de rythme… Quoi qu’il en soit, le roman piétine beaucoup dans sa seconde partie lorsque Paul est initié à la vie fremen dans toutes ses coutumes et ses tabous. On s’enlise. Ou, pour être plus précis, on s’ensable.
Et c’est peut-être là l’essence du deuxième point qui me gêne : si la première partie est très marquée SF, la seconde s’oriente bien davantage vers la fantasy. Bien sûr, ce n’est pas le seul « planet-fantasy » qui existe (Star Wars quelqu’un ?), mais cela me trouble quand on sait que Dune est consacré comme LE classique de la SF aux côtés du Fondation d’Asimov. Or, la technologie est finalement très accessoire dans le roman, ne servant que de cadre général nous expliquant dans les grandes lignes pourquoi les humains vivent sur diverses planètes. Le cœur du roman est et reste ce qui fut peut-être l’ambition de Herbert : écrire un Laurence d’Arabie de l’espace. A tel point que Herbert prêtera même dans sa bibliographie imaginaire de Paul Atréides/Muad’Dib un écrit dont le nom est très proche des fameux Les Sept Piliers de la sagesse de l’officier anglais. C’est une grille de lecture très simple du roman : Paul Atréides est T.H. Lawrence. Il est l’officier qui prendra la tête d’une révolte d’hommes du désert contre l’occupant étranger, mimant en cela le grand mouvement de décolonisation débuté aux débuts des années 60 tant en Afrique qu’en Asie.
S’arrêter à cette parabole aurait fait de Dune un grand roman d’aventure, accessoirement de science-fiction. Qui aurait sans doute été oublié, comme nombre de ses pairs. Mais Herbert est allé plus loin. Il ne s’est pas contenté d’adapter un salmigondis d’imagerie arabisante à une peuplade locale sur une planète inhospitalière. Il a également inventé des castes, des religions et des intérêts divergents qui précèdent la venue d’une véritable nouvelle religion. Car, en effet, quel est l’intérêt du Bene Gesserit si ce n’est de valider l’approche du surhomme dans la fiction ? L’eugénisme du Bene Gesserit et le fait que Paul prenne effectivement la tête d’une peuplade « sauvage » fait d’ailleurs assez froid dans le dos, quand on y réfléchit. Paul, sa mère, sa demi-sœur et quelques-uns de ses alliés ne sont en fait pas des héros.
A nouveau, je n’aurais pas de problème avec cette ambivalence (les personnages sont toujours plus intéressants quand ils sont gris que quand ils sont blancs ou noirs) si l’on ne nous présentait pas Paul comme réellement héroïque. Qu’il ait des doutes sur le tard sur son l’étendue de son pouvoir et sur l’usage que l’humanité pourrait en faire joue en sa faveur (il explique en effet, plusieurs fois, vouloir à tout prix éviter le djihad qu’il pressent lors de ses rêves éveillés), avant pourtant de renoncer à voie et d’embrasser définitivement la révolte par les armes et son statut de démiurge. Paul, en effet, est un personnage antipathique. Dès la mort de son père, Paul ne ressent finalement pratiquement plus d’émotion pour les gens qui l’entoure ou les situations qu’il vit. Cela rend l’attachement au récit compliqué pour le lecteur qui cherche quelqu’un à qui s’identifier.
J’en viens d’ailleurs à me poser la question : Hebrert considérait-il Dune comme un simple roman ou voulait-il en faire autre chose ? Un véhicule philosophique, moral ou religieux à destination d’une jeunesse alors hédoniste ? Mystère, puisque Hebert s’est finalement assez peu exprimé sur les intentions de son livre. Ces remarques et réserves sont surtout vraies pour les livres II et III de Dune, lorsque Paul découvre progressivement qui il est réellement. Et cela tranche d’autant plus avec le livre I qui semble être un space-opéra plus classique avec un Empire galactique, des familles qui s’affrontent et un McGuffin quelconque (l’épice, ici). Tellement classique même que les premiers chapitres sont finalement très linéaires, chacun d’entre eux nous présentant tour à tour l’un des protagonistes de l’intrigue, selon son point de vue personnel. Hebert prend même le parti étonnant de casser l’une des clés du suspens en laissant entendre dès les premières pages que le Duc Leto sera tué et que le traitre sera le Docteur Yueh (là où le film laisse planer le doute pendant quelques temps). Comme si, pour Hebert, dès cette première partie, le récit classique de SF n’avait finalement que peu d’importance.
Même l’affreux baron Harkonen, personnage marquant de l’adaptation filmique s’il en est, est nettement plus accessoire dans le roman. Ses affres ne nous sont pas épargnées, mais il semble nettement moins menaçant que dans l’adaptation. Ses intrigues de palais n’ont finalement que peu de poids par rapport au destin de Paul/Muad’Dib, ce qui crée là aussi une petite frustration pour un lecteur comme moi qui aime un bon antagoniste. Fey, le na-baron (le personnage joué par Sting chez Lynch), malgré le fait qu’il soit présenté comme le quasi-égal de Paul, est lui aussi finalement très accessoire. On comprends mieux la nature de son lien avec Paul –puisque le credo Bene Gesserit est nettement plus développé dans le bouquin-, mais il reste peu exploité et est rapidement oublié.
Dune est par ailleurs remplis à ras-bord d’un vocable neuf et assez abscons. A tel point qu’une assez longue annexe est nécessaire, en fin de volume, pour s’y retrouver. Contrairement à d’autres œuvres de SF, il n’est pas question ici d’un vocabulaire techniciste moderne, mais bien d’un lexique relatif aux mots et expression de l’Empire, du Bene Gesserit, des Fremens ou encore du Landsraad (c’est à dire l’assemblée des familles nobles, les maisons, qui règnent en contre-pouvoir sur l’univers connu, aux côtés de l’Empereur). De nouveau, le concept en soi ne me dérange pas outre mesure et il s’explique facilement : chaque culture a des mots qui lui sont propres pour parler d’un phénomène en particulier. Mais, sans que je sache réellement l’expliquer, cela sonne très peu naturel dans le texte. Comme dans le cas de Tolkien, l’ambition d’Herbert était certainement de montrer qu’il nous présentait un monde complexe, doté d’une riche histoire et de cultures aussi diverses que réalistes. Cependant, là où ce sentiment d’historicité ne gêne en aucun cas la lecture du Seigneur des Anneaux (les allusions au passé sont nombreuses mais non essentielles, laissant en cela le choix au lecteur curieux de se plonger dans les annexes ou dans les publications tierces pour développer le mythos), ces références plombent le texte d’Herbert et sont autant d’obstacles qui risquent de faire sortir le lecteur un peu inattentif du fil de l’histoire.
C’est d’ailleurs sans doute du à la relative modestie, finalement, du roman. En termes de pages, j’entends. Si Dune est un livre-monde comme le Seigneur des Anneaux, alors il est très rushé dans ses moments de développement mythopoïétique. Paradoxalement, le livre gagnerait à être à la fois plus court sur l’initiation laborieuse de Paul à son nouveau rôle de messie/dieu et plus long pour installer son environnement. J’ai par exemple trouvé très éclairantes les autres annexes du roman, consacrées à l’écologie de Dune et aux activités du Bene Gesserit. Insérer d’une manière ou d’une autre les informations qu’elles contiennent au cœur du récit en aurait probablement facilité sa prise en main. J’avoue d’ailleurs que j’étais bien content d’avoir vu et revu le film pour bien ancrer en moi qui était quel personnage dans la litanie de personnages nouveaux qui nous sont présentés à la chaîne dans les premiers chapitres, des personnages centraux aux personnages secondaires amenés à jouer un rôle plus importants ou légèrement différents ici.
Je comprends cependant l’attrait que le roman a pu avoir et a toujours sur nombre de ses lecteurs. Si le roman demande un effort particulier à son lecteur, nettement plus à mes yeux que la prose déjà exigeante de J.R.R. Tolkien et pour d’autres raisons, comme nous l’avons vu, le roman n’en offre pas moins une fenêtre sur un monde fascinant. Herbert a pensé et recherché son œuvre, il n’est pas permis d’en douter. Dune, Arrakis, est un décor que l’on n’oublie pas. Les Fremens sont un peuple fier et atypique dans la littérature SFFF souvent plus inspirée par l’européocentrisme que par une certaine forme d’attrait pour l’Islam. J’ai lu en grande partie le livre avec une compilation d’oud dans le casque et la bande son s’est avérée adéquate en grande majorité. Herbert était attiré par l’orient et il en a livré ici une version beaucoup plus moderne, construite et complexe que la vision très limitée que l’orientalisme dans la littérature de genre européanocentrée à l’habitude de développer. Et c’est cette profondeur, cette richesse ici entraperçue qui a sans doute séduit un large lectorat.
Le roman, le monde de Dune, a donc d’indéniables qualités. Mais il souffre aussi d’un personnage principal finalement antipathique et d’un jargon pseudo-religieux qui brouille la compréhension d’une intrigue tortueuse où nombre d’intérêts se croisent en s’ignorant la plupart du temps. Je sais parfaitement que Dune n’est que le premier tome d’une série et que la lecture des suites devrait sans doute répondre à ma frustration du mande de développement de certains concepts, mais j’essaie ici d’analyser froidement et honnêtement Dune comme un livre unique, avec un début, un développement et une fin. Et je sais également que je suis probablement nettement plus critique qu’à l’accoutumée. Mais c’est toujours le cas lorsque je m’attaque à ce qui est reconnu comme un « chef d’œuvre« . Signer un chef d’œuvre certainement dans la littérature de genre, ne reflète malheureusement souvent qu’un jugement à l’emporte-pièce d’un lectorat plus large attiré vers un texte par le fruit du hasard ou d’un marketing heureux à un moment ou un autre. Je ne dis pas que c’est ce qui s’est passé dans le cas de Dune, je dis simplement qu’à l’épreuve du temps qui passe, ce qui fut peut-être à juste titre considéré comme un chef d’œuvre révolutionnant un genre il y a 55 ans de cela maintenant a largement été dépassé depuis. D’autres ne seront pas du tout d’accord avec moi, bien sûr, et continue à placer Dune dans une position particulière dans leur vie de lecteur. C’est parfaitement sain et normal. Je ne peux que conclure en disant que l’alchimie qui fait une grande expérience de lecture pour l’amateur éclairé que je suis n’a pas que modérément pris. Je lirai certainement les suites, car le monde m’attire, mais je ne peux pas dire que le livre sera une étape marquante dans ma vie de lecteur. Dommage pour moi, sans doute.

 De
De  De
De  De
De  Sous-titré Comsic fric-frac
Sous-titré Comsic fric-frac