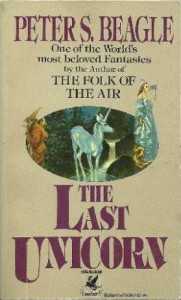De Catherine L. Moore, 1934 à 1939.
De Catherine L. Moore, 1934 à 1939.
Les six nouvelles composants ce volume ont été publiées pendant l’âge d’or de la littérature « pulp », dans la revue la plus connue du genre, le fameux Weird Tales (connu pour avoir publié Howard Philip Lovecraft et Robert E. Howard). Catherine L. Moore, bien que correspondante visiblement régulière de Lovecraft, n’a cependant pas le génie de ses pairs précités.
La comparaison est injuste, cependant. En effet, Jirel de Joiry compte et conte des récits qui sont les parfaits exemples de la beauté et des limites des histoires pulp. Les aventures extraordinaires de cette pseudo-baronne-guerrière d’un moyen-âge français fantasmé sont en même temps très fun et très prévisibles. Le pulp n’a pour unique vocation que divertir un public assez jeune en mal de sensation dans l’Amérique des années 20 et 30. Ce sont des revues imprimées sur du mauvais papier, vendues pas cher à une classe populaire en manque de sensations fortes, en manque d’évasion.
Lovecraft l’a suffisamment reproché à Howard dans leur longue correspondance : un récit de Weird Tales obéit à un cahier de charge prévisible, à des impératifs de genre et de style que le public attend et pour lequel il paye. Nombre de ces textes ont donc, avant tout, une vocation commerciale. Le reclus de Providence lui-même, malgré l’indépendance dont il s’est toujours revendiqué, n’hésita pas à « améliorer » les textes de certains de ses collègues contre monnaie sonnante et trébuchante. Sa plus belle commande, au regard de ses finances personnelles, n’est autre que « Prisonnier des Pharaons », texte perclus de clichés et prévisible à souhait, qu’il rédigea comme nègre pour nul autre qu’Harry Houdini.
Il est dès lors injuste de vouloir comparer Catherine L. Moore aux quelques noms connus de la littérature pulp qui ont traversés les décennies pour toujours avoir quelque chose à apporter aux lecteurs d’aujourd’hui. Lovecraft, Howard, Clark Ashton Smith, Fritz Leiber et quelques autres sont les exceptions que l’on retient dans les dizaines d’auteurs qui ont nourris les pages de Weird Tales, d’Astounding Stories, de Thrilling Detective. Catherine L. Moore était, quant à elle, plus dans le « moule » des auteurs qui faisaient ce qu’on attendait d’eux : rédiger des histoires « bigger than life » avec de l’aventure, du frisson et, pourquoi pas ?, un peu d’érotisme soft.
Mais pourquoi l’avoir réédité en français des années après le coup de projecteur original de Jacques Sadoul dans les années 60/70, dans ce cas ? Probablement parce que C.L. Moore se prénomme Catherine : c’est une femme. Et Jirel est une héroïne, pas un héros. Cela peut sembler anodin de nos jours, mais les héroïnes de pulp n’étaient pas légion dans l’Amérique des années folles. Que du contraire. Le phénotype est plutôt le barbare musclé à la Conan/Kull, ou l’aventurier malin et cabot qui donnera quelques années plus tard Indiana Jones ou Han Solo.
Jirel, elle, est une femme forte, qui dirige ses hommes d’une main de fer et qui ne laisse que peu de place aux sentiments. Quelques années avant la Sonia la Rousse (d’Howard, également) et quelques décennies avant la Princesse Leia, on a, avec Jirel, l’ancêtre d’un personnage féminin de fiction fort, à qui l’on attribue les traits généralement masculins du courage, de la force, du jusqu’au-boutisme, etc. De là à dire qu’il y a une démarche volontaire de Catherine L. Moore, contemporaine des suffragettes, il n’y a qu’un pas. Pas que je ne me permettrais pas de franchir : je doute fort que le médium en question, un pulp d’aventure à la frontière entre le fantastique, la fantasy et la SF (pour la dernière nouvelle), soit le véhicule rêvé pour faire passer un message.
Mais cela reste une curiosité historique, fortement soulignée par Patrick Marcel dans son introduction à la réédition chez Folio SF. Et une curiosité qui colore le texte de manière plaisante pour un lecteur habitué de la littérature pulp et qui n’y cherche pas un message profond qui ne s’y trouve certainement pas.
Reste les nouvelles en elles-mêmes et leur qualité intrinsèque. Comme le dit à nouveau Patrick Marcel, il n’est pas forcément souhaitable de lire le tome d’une traite : la répétition du schéma narratif et de certaines ficelles scénaristiques éculées rend une lecture intensive légèrement pénible. Prises indépendamment, cependant, les premières nouvelles sont des textes fantastiques, influencés par les tics de langage lovecraftiens (l’utilisation de l’adjectif « indicible » ne trompe généralement pas… J), plus que correct. D’autres nouvelles appartiennent plus clairement à la fantasy et sont toujours de bonne facture. Seule la dernière nouvelle, cross-over entre Jirel de Joiry et l’autre héros récurrent de C.L. Moore, Northwest Smith, m’a laissé un peu froid. Le côté tête-à-claque cliché de Smith n’y est pas pour rien et le cross-over, mal amené et peu exploité, tombe un peu comme un cheveu dans la soupe.
Bref, tout ceci pour dire qu’il s’agit là d’un recueil honnête, forcément daté et ancré dans un courant qui brille davantage par ses mécanismes bien huilés que par sa grande originalité. Ce n’est évidemment pas un immanquable, mais, outre l’aspect historique, cela reste une lecture agréable pour ses changer les idées, façon blockbuster hollywoodien, qui ne mérite pas les quelques (rares) critiques acerbes que l’on peut trouver ici et là sur Internet.