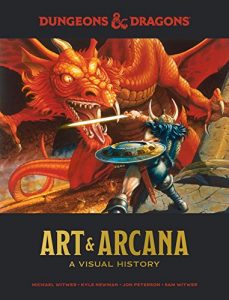 Sous-titré : A Visual History
Sous-titré : A Visual History
De Michael Witwer, Kyle Newman, Jon Peterson et Sam Witwer, 2018.
La période des fêtes fut riche en lectures diverses, mais je n’ai pas réellement eu le temps de les chroniquer ici-bas. S’occuper de gamins est chronophages ! Mais bon, trêves d’excuses. Débutons donc ces chroniques en retard par celle d’un joli cadeau reçu pour ce Noël 2019 : le très luxueux (et très pesant) Art & Arcana, une formidable déclaration d’amour de quatre geeks au roi des RPG papier, Dungeons & Dragons. Je ne peux croire, si vous lisez ces lignes régulièrement, que vous ignoriez ce qu’est Donjons et Dragons, cette pierre angulaire de la fantasy depuis les années 70 et jusqu’à nos jours. Je ne vais donc pas développer. Retenons simplement que, comme toutes les belles histoires qui débutent dans la décennie des papys-geeks (IBM, Micorsoft, Apple, etc.), celle de D&D débute dans un garage. Ou dans une cave plus précisément.
Cette somme historique, finaliste dans la catégorie « essai » du Hugo et du Locus 2018, nous emmène dès ses premières pages dans la vie d’un petit vendeur d’assurance du fin fond des États-Unis, qui a une passion certaine pour le wargaming et les pulps des années 30. Ce bonhomme, c’est Gary Gygax. Comme tous les self-made men, ce-dernier a un coup de génie au début des années 70 quand il « sent » le succès de Tolkien chez ses concitoyens et qu’il constate parallèlement qu’il est devenu honorable pour des adultes (ou de grands ados) de continuer à jouer avec ses petits soldats de plomb. Du coup, il ratisse ses fonds de tiroirs, fait appel à sa famille et à ses potes et parviens à produire une petite boîte en carton contenant trois fascicules de quelques dizaines de pages. Le premier « boxed set » de D&D était créé. Le tout tiré à 1000 exemplaires et vendu la modique somme de 10 dollars. L’un des auteurs de Art & Arcana s’amuse dans la conclusion de l’ouvrage à revenir sur le prix atteint par la vente de l’une de ces boîtes, pourtant utilisée, en 2008 sur eBay : la modique somme de 20.000 dollars (ici, une troisième édition à +4.000 € !)
Car oui, D&D, pour les intimes, est devenu très hype. Référencé dans à peu près tous les grands show mainstreams des dernières années (de Stranger Things à Big Bang Theory), D&D a quitté les caves de ses premiers utilisateurs pour devenir un gimmick culturel. Est-ce tant mieux ? Et bien le bouquin hésite, justement. Et bizarrement. C’est en cela qu’il s’agit sans doute d’un essai sincère, si l’on ne tient pas compte du dernier chapitre, véritable panégyrique en faveur de la 5eme (et dernière, à ce jour) édition du célèbre jeu de rôle. Entre les débuts modestes et l’expansion folle de la seconde édition, le livre s’attarde tant sur les bonnes idées de TSR que sur ses ambitions folles et ses échecs successifs (la série animée, par exemple). Art & Arcana résume bien l’incapacité des quelques geeks qui ont développé le produit original à maitriser et gérer l’industrie qu’il était devenu à la fin des années 80. Et comme dans le cas d’Apple, le parallèle est intéressant, cela s’est traduit par l’écartement pur et simple du concepteur original, dégagé par un board qui n’a pourtant pas su améliorer la balance financière de l’entreprise après coup.
En effet, si la deuxième édition d’AD&D (pour Advanced Dungeons & Dragons) est sans doute la meilleure et la plus diversifiée (pensez donc, ils éditèrent en l’espace de seulement quelques années les campagnes Forgotten Realms, Spelljammer, Dark Sun, Ravenloft ou encore Planescape !), elle fut aussi le synonyme pour la maison-mère d’une folie des grandeurs qui segmenta le marché à tel point qu’ils devinrent leur propre concurrent. Avec autant de lignes de produits en parallèle, les joueurs et leurs fameux maîtres du jeux ne savaient plus où investir leurs pièces de bronze, d’argent ou d’or. Bref, leurs deniers. Et, ce, d’autant plus que les nouveaux concurrents n’étaient pas bien loin : c’est à cette époque que Vampire: The Masquerade s’envole. Ou encore GURPS. Pire : leur public s’éloigne début 90 pour se diriger vers une autre expérience de jeu amenée à devenir un modèle pour les années qui suivirent: Magic The Gathering, par nul autre que Wizard of the Coast (loisir qui coûte un bras, par ailleurs).
L’ironie voulant qu’à peine quelques années plus tard, c’est ce même Wizard of the Coast, responsable des derniers clous dans le cercueil de D&D old-school, qui racheta la licence avec tout son back-catalogue. WotC produira alors une troisième édition qui mélangera le très bon (le système D20 en licence libre, qui verra de nombreux petits acteurs du monde de la fantasy se lancer dans des produits compatibles avec les règles de base D&D) et le moins bon (la volonté affichée d’en faire un jeu de figurines avec la vente, selon le modèle de MTG, de boosters très chers avec des figurines pré-peintes, mais forcément moins courues que l’inaltérable Warhammer, déjà bien installé dans le segment « wargames » à l’époque). Du coup, cette hésitation entre le RPG de papa, avec feuilles blanches, crayons et dés et le wargame à la Warhammer en fit un produit vite dépassé par ses concurrents profitant de la licence ouverte. Et, pas de bol, WotC réagira en produisant quelques années plus tard une quatrième édition décriée par les aficionados pour son côté excessif. Exit le jeu de rôle réaliste et bienvenue à la mode MMORPG avec cette quatrième édition, où les XP caps ont disparus au profit d’une course au loot divin et aux arbres de compétences complexes et sans fin. Seulement, pas de bol, là où D&D première et seconde éditions donnèrent un modèle à suivre, les troisième et quatrième éditions s’efforçaient de copier la concurrence pour rattraper les joueurs perdus, symptôme d’un manque de vision flagrant de WotC sur le bébé qu’ils avaient dans les mains en rachetant la licence. Heureusement, cette sombre période vu aussi l’éclosion des jeux vidéo mythiques que sont les Baldur’s Gate et les Neverwinter Nights qui sauvèrent largement le nom de la marque auprès des amateurs de fantasy lambda.
D’après les auteurs, la cinquième édition, la plus récente (2014 à nos jours) reviendrait aux fondamentaux. Je ne la connais pas (m’étant personnellement surtout concentré sur la seconde, à l’époque), mais je doute de l’honnêteté intellectuelle des fan-boys ayant écrit le bouquin, sachant que rien n’est aussi vendeur qu’une belle histoire de rédemption (sauf que WotC n’est pas un paladin déchu repentant ; c’est juste une entreprise commerciale qui essaye de faire du profit). On notera également que le bouquin insiste aussi beaucoup sur le succès du trans-média : quand TSR comprit à l’époque des balbutiements du merchandising à outrance de Star Wars qu’il était aussi intéressant commercialement parlant de diversifier les produits, ils s’y sont donnés à cœur joie. Romans, comics, jeux vidéo, jeux de plateau, dessin animé mais aussi (et pourquoi pas ?) jeu de carte à collectionner, bonbons et serviettes de plage (je n’invente pas). On retiendra de cet « univers étendu » un nombre considérable de romans qui, bien qu’ils ne soient souvent pas des chefs d’œuvre, apporte une profondeur aux mondes créés par la marque. À tel point qu’il devinrent, avec les années, des mondes de fantasy à part entière qui réussirent à se détacher de leurs inspirations originales (le Seigneur des Anneaux, Conan ou encore le Cycle des Épées de Fritz Leiber).
Enfin, il me reste à parler du côté visuel de l’objet. En effet, le bouquin ne s’appelle pas « A Visual History » pour rien. L’histoire de la marque, intéressante en soi, ne serait rien sans le développement de son visuel. Et, là aussi, le parallèle avec Star Wars fonctionne à merveille : de débuts très amateurs où les livres de règle de la première édition étaient illustrés par des gamins du quartier ou de gentils bénévoles de la famille étendue de Gygax, il est frappant de voir à quel point l’évolution de l’illustration sert aussi la marque. Si les images étaient, dans un premier temps, informatives (le plan du donjon devait permettre au maître du jeu de s’y retrouver, le première Bestiaire monstrueux devait lui permettre de se faire une image mentale d’un mindflyer, d’un ettercap ou d’un owlbear), elles devinrent bien vite évocatrices. Voire épiques. Et si la quatrième édition fut malheureusement marquée par un virement très Marvel/WOW-like, la cinquième semble revenir à une certaine modestie. On voit aussi clairement à travers ces 45 ans d’illustrations que le concept visuel même de la fantasy a évolué : l’adaptation cinématographique du SdA et la série télé de GoT sont passées par là. On peut désormais être un véritable artiste peintre, certains proche du photoréalisme, en se limitant pourtant à illustrer des mondes imaginaires.
En résumé, Art & Arcana est un très bon « beau livre » pour les amateurs de D&D. Les textes fourmillent de détails qui mettent en lumière l’histoire d’un jeu de rôle qui, bien que dépassé par d’autres RPG plus matures et plus modernes, n’en reste pas moins l’alpha et l’oméga du genre. Le modèle sur lequel tous les concurrents se sont construits et continue à se construire. Le tout est magnifiquement illustré par des images issues des multiples extensions des différentes éditions, de photos des produits dérivés issus de collections privées ou encore d’archives inédites et de dessins de production de TSR. Mon seul bémol restera la conclusion probablement trop optimiste pour être honnête. Mais on pardonnera volontiers ce biais à la brochette d’auteurs qui ne pouvaient sans doute être objectifs jusqu’au bout avec ce qui constitua certainement une partie dorée de leur enfance. Faites un jet de test d’honnêteté intellectuelle -4 si vous ne me croyez pas ! 🙂
PS: J’ai lu et je chronique ici la version originale du livre, mais un version française est également disponible chez Huginn & Muninn.Vu l’éditeur, j’imagine qu’elle est certainement de très bonne facture également.
 De Fritz Leiber, 1976.
De Fritz Leiber, 1976.
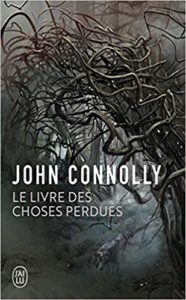 De
De  De
De  De
De 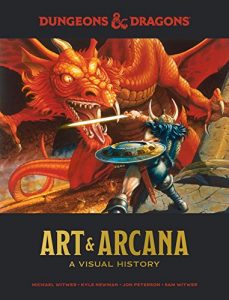 Sous-titré : A Visual History
Sous-titré : A Visual History