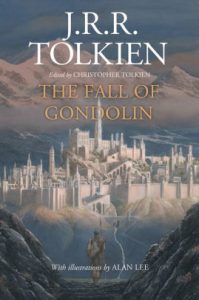 De J.R.R. Tolkien, 2018.
De J.R.R. Tolkien, 2018.
45 ans après sa mort, Tolkien parvient encore à nous sortir un inédit ! Enfin, un inédit, tout est relatif. La Chute de Gondolin, le conte original écrit dans sa première version vers 1916-1917, fut déjà publiée dans le Second Livre des Contes perdus, édité lui aussi à titre posthume par le troisième fils de J.R.R., Christopher Tolkien. Et c’est ce même Christopher, âgé tout de même de 94 ans cette année, qui édite à nouveau ce même conte dans un écrin qui lui est entièrement consacré.
En fait, Christopher conclut avec ce livre la longue série des publications posthumes de son père, débutée avec le Silmarillion dans les années 70 (*) et terminée, donc, cette année, avec The Fall of Gondolin. Car, si Christopher avait déjà annoncé en 2017 que son Beren & Lúthien était son dernier ouvrage, il n’a pu résister à compléter sa trilogie des grands récits du premier âge, débuté en 2007 avec The Children of Hurin. Et ce Fall of Gondolin suit exactement la même logique : au-delà de l’histoire proprement dite de la chute du royaume elfique enclavé et secret de Gondolin, c’est bien un livre sur l’évolution des écrits de son père que l’on a entre le mains. Chritopher, exécuteur testamentaire littéraire des œuvres de son père, regroupe ici plusieurs versions successives du la Chute, qu’il commente ensuite quand à leur différences de construction, de contenu et de style.
La première version contenue dans ce recueil, la version originale pensée et rédigée dans les tranchées de Passchendaele par Tolkien père, est la seule version réellement complète de l’histoire et fait un petit 80 pages. C’est également la seule version qui conte en effet la chute de la cité de Gondolin et qui détaille, par le menu, les différents affrontements qui émaillèrent sa prise. Les troupes de Morgoth/Melkor, constituées de Balrog, d’orcs et de dragons mécaniques (étrange !), malgré les lourdes pertes qu’elles essuient, finiront dans cette version par défaire les habitants de cette cité légendaire. C’est également la version la plus archaïque dans son style, proche parfois de la chanson de geste, alors que Tolkien rédigeait à cette époque nombre d’épopées versifiées inspirées par les légendes nordiques et anglo-saxonnes.
La seconde version, nettement plus courte, est une forme de résumé destiné à être intégrée dans le Silmarillion. Si elle est factuelle et complète, elle manque évidemment, par sa forme, de corps pour être réellement agréable. La troisième et dernière version, la plus romanesque et littéraire, est également la plus ancienne. Elle fut rédigée dans les années 50, alors que Tolkien (J.R.R., pour le coup) peinait à trouver un éditeur pour son Seigneur des Anneaux. Elle retrace par le menu les origines de Tuor, l’humain qui fut chargé par le Vala Ulmo, de prévenir le Roi Turgon de la menace qui pèse sur sa cité-état de Gondolin. Cette version, la plus travaillée et la plus agréable à lire (et aussi celle dont je me souvenais le mieux pour l’avoir lu dans le Silmarillion ou dans Le Livre des Contes perdus) a cependant l’énorme désavantage d’avoir été abandonné par son auteur à mi-chemin.
En effet, le texte s’arrête alors que Tuor a passé les portes successives du Royaume caché et découvre pour la première fois les tours blanches de Gondolin au loin dans cette vallée enclavée. On ne peut donc qu’imaginer ce que le texte final aurait donné, si J.R.R. Tolkien avait eu le loisir de terminer cette version avant sa mort. Le lecteur actuel, maintenant que The Fall of Gondolin est publié, pourra se faire une idée sur l’évolution du texte et devra se reporter sur le Livre des Contes perdus pour y lire une version complète, « bricolée » par Christopher Tolkien plusieurs années après le décès de son père à partir de ces diverses versions, ici publiée avec très peu de modifications (si ce n’est l’inévitable uniformisation des noms propres utilisés au sein d’une même version du récit, que Tolkien père avait la fâcheuse tendance de modifier plusieurs fois au sein d’une même épreuve, au gré de ses inspirations linguistiques).
Mais que penser de ce The Fall of Gondolin, allez-vous me dire ? Et bien, du bon, bien sûr. Mais pas de l’exceptionnel non plus. Je m’explique : si la verve de Tolkien est toujours agréable à lire (à titre accessoire, je ne la lis qu’en Anglais dans le texte, ne supportant pas le ton très compassé de la traduction française de chez Christian Bourgeois -et je sais bien que la version originale est aussi très archaïque, mais, allez savoir pourquoi, ça passe mieux en anglais!-), j’ai un peu de mal avec la démarche de son fils Christopher. Beren & Lúthien, annoncé comme un opus majeur en 2017, m’avait par exemple fort lassé au-delà de la première itération du texte (où Melkor était … un chat maléfique !) Si j’ai dans ma bibliothèque l’intégrale de The History of Middle-Earth qui attends que j’ai quelques mois devant moi pour m’y plonger, je ne peux ôter de mon esprit qu’il y a là une vilaine démarche commerciale de la part du fils prodigue et de Harper & Collins, l’éditeur historique de Tolkien, de vouloir continuer à faire du profit avec des versions de travail de contes et textes déjà publiés par ailleurs.
Sur l’histoire en elle-même maintenant, là aussi, je suis un poil réservé. Tuor, comme Beren, d’ailleurs, a le défaut d’être assez lisse. Il est invariablement bel et bon, comme les chevaliers des chansons de geste (voir encore davantage, les chevaliers arthuriens commettant des erreurs et des trahisons, ce qui ne serait pas envisageable pour Tuor ou Beren). Et… cela manque du coup un peu d’aspérités. A titre de comparaison, j’ai toujours préféré Túrin Turambar, le personnage principal des Children of Hurin. Lui commet des erreurs. Et agit sous le coup de la colère. Et connait un destin tragique. Il en est d’autant plus intéressant et humain. Enfin, je pinaille : The Fall of Gondolin reste de la très bonne fantasy et détaille par le menu l’un des épisodes essentiels du premier âge et la dernière défaite importante des efles noldori face à Melko/Morgoth.
Il me reste à toucher un mot sur le livre en tant qu’objet : j’ai pris la version hardback de chez Harper & Collins, illustrée par l’inévitable Alan Lee. Le livre est bien sûr de très bonne facture, bien qu’un peu rigide en raison d’un grammage très élevé de son papier. Les illustrations sont formidables, comme de bien entendu. Alan Lee, après toutes ces années, est l’un des quelques illustrateurs qui ont forgé l’image que l’on a tous de la Terre du Milieu. Même si l’image que j’ai en tête de la Chute de Gondolin restera toujours l’image qui orne la couverture de mon exemplaire poche du Silmarillion qui est signée, si mes souvenirs sont bons, par nul autre que John Howe. Comme quoi.
Résumons mon avis en quelques mots si d’aventure le texte qui précédait n’était pas clair : The Fall of Gondolin est bien sûr un immanquable pour tous les fans de Tolkien (ce que je suis). Pour le lecteur épisodique qui n’aurait lu que le Hobbit et/ou le Seigneur des Anneaux, l’ouvrage est probablement plus accessoire.
(*) Ce qui n’est pas tout à fait juste : en effet, sortait en 1975, soit deux ans avant le Silmarillion, Sir Gawain and the Green Knight, réécriture versifiée d’une partie des légendes arthurienne par Tolkien seulement deux ans après sa mort et, déjà, édité par fils Christopher. Mais j’ai choisi de l’ignorer, sachant que ce texte ne porte pas sur les Terres du Milieu et les légendes y afférentes.

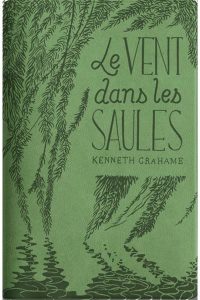 De
De 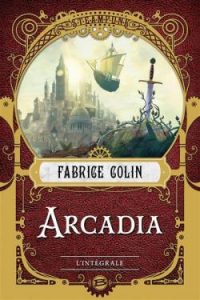 De
De 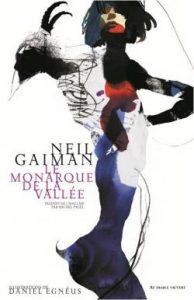
 Édité par
Édité par