 De Hideaki Anno et Shinji Higuchi, 2016
De Hideaki Anno et Shinji Higuchi, 2016
Après son incartade américaine, spectaculaire mais finalement assez convenue, le lézard géant est de retour sur les terres de sa genèse. Après de (trop?) nombreux épisodes relativement passables où le dinosaure nucléaire s’érigeait en justicier intergalactique, sauvant les bambins nippons des affres d’autres monstres géants dignes de sentaïs peu inspirés, parfois secondé par inénarrable Mothra, la mite géante, l’idée de ce reboot était de retourner au matériau original, le Godzilla de 1954.
Et ce retour aux sources l’est à plus d’un titre. Non seulement Godzilla est à nouveau joué par un acteur en costume (bien que largement aidé par des effets spéciaux de bonnes factures qui parviennent à lui éviter le ridicule), mais il est également à nouveau le méchant. Enfin, le méchant.. Si l’on considère qu’un phénomène naturelle peut être méchant, bien sûr. Et surtout, au-delà de cet antagonisme narratif classique, c’est aussi le retour du nucléaire. Là où le film de Gareth Edwards de 2014 mentionnait dans son prologue les essais nucléaires comme possible genèse au lézard géant, ce Shin Godzilla est relativement explicite. Si la version de 1954 était une parabole de la bombe H, cette version de 2016 sera la réification de la catastrophe de Fukushima.
Les motivations de Godzilla ne sont à aucun moment discutées ou évoquées dans ce reboot. Celui de 2014 se réveillait pour se nourrir des autres kaijus libérés. Celui de 2016 se réveille et traverse simplement, en droite ligne, le pays où il émerge. D’ailleurs il ne se montrera réellement violent que lorsqu’on l’attaquera. Avant ça, il se contentera d’avancer, tel un typhon, devant lui, causant ravages et destructions.
Mais, finalement, tout ceci n’est pas le réel propos du film. Hideaki Anno, l’inventeur/réalisateur d’Evangelion il y a maintenant plus de 20 ans, profite de l’occasion, en tant que co-réalisateur, pour filmer ses lubies habituelles : Shin Godzilla est un film sur le pouvoir, sur la politique, sur l’administration, avant d’être un film de monstres géants. La quintessence du kaiju, le bien nommé Godzilla, n’est en fait qu’un prétexte pour se lancer dans une critique du monde politico-administratif japonais actuel. Figé dans l’inaction, disposant de moyens dérisoires face à la menace, les politiques et hauts fonctionnaires qui se succèdent à l’écran sont autant d’échos à la gestion gouvernementale catastrophique du Japon dans les premières heures et les premiers jours qui suivirent l’incident de Fukushima.
Confronté à l’inefficacité de leur pseudo-armée, à un interventionnisme autoritaire progressif du grand frère américain, les protagonistes passent finalement leur temps à créer des alliances, faire des paris politiques improbables et à se démarquer pour s’assurer une place de première vue dans l’après-crise. Le sort de leurs concitoyens ne les inquiètent que très peu ; on pourrait même penser que Godzilla n’est finalement qu’un obstacle (et une opportunité?) dans leur gestion de carrière.
Cette déshumanisation de la catastrophe, représentée par de très longues scènes de dialogues et de réunions entre armée, experts, scientifiques, politiques et hauts fonctionnaires, contrastent violemment avec les images de destruction pure (certainement dans la seconde moitié du film) lorsque la caméra s’attarde sur le dieu lézard.
Anno et son coréalisateur Shinji Higuchi (scénariste d’Evangelion, qui s’était déjà frotter à du live-action avec quelques réalisations plutôt confidentielles hors-Japon) nous livrent donc un reboot totalement à contre-courant de ce que l’on pouvait raisonnablement attendre. La star du film, dans un design plus effrayant que jamais, n’est en rien plus froid que la brochette d’acteurs principaux, d’Hiroki Hasegawa l’idéaliste à Yutaka Takenouchi, le manipulateur. A l’instar du Gendo d’Evangelion, chaque personnage développe son propre agenda en dépit de (ou grâce à?) la crise.
Et ils maîtrisent assez bien la caméra pour en faire une réussite formelle, par la même occasion. Disposant d’un budget restreint (15 millions de dollars US, soit exactement 10 fois moins que son prédécesseur américain), ils sont cependant parvenu à tourner un film catastrophe réaliste, sobre, avec un aspect réaliste très prononcé pour démontrer qu’il ne s’agit presque pas d’une fiction. Ils ont par ailleurs globalement bien casté les divers rôles, à l’exception sans doute de la très énervante Satomi Ishihara à l’accent anglais simplement risible (le personnage qu’elle joue étant sensé résider aux USA). On ne peut que regretté qu’ils n’aient bénéficier que de deux heures pour développer leur récit, mettant de côté de nombreux personnages annexes qu’ils auraient sans doute épaissis dans un format plus long. Je pense en particulier à la bande de scientifiques marginaux, tous plus excessifs les uns que les autres. En somme : un regard neuf sur le kaiju movie qui mérite certainement une vision pour peu que l’on accepte aussi de réfléchir, entre deux séances de destructions d’immeubles.
PS: [SPOILER] Et si quelqu’un peut m’éclairer sur les dernières images du film, sur les espèces d’étranges humanoïdes naissant de la queue de Godzilla, je suis preneur… [/SPOILER]

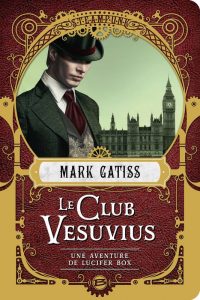 De
De 
 Collectif, 2017.
Collectif, 2017. De Catherine L. Moore, 1934 à 1939.
De Catherine L. Moore, 1934 à 1939.