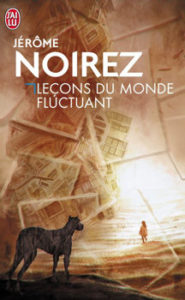 De Jérôme Noirez, 2007.
De Jérôme Noirez, 2007.
J’ai rarement été plus mal à l’aise à prendre ma plume pour chroniquer une lecture qu’aujourd’hui. Il me semble pouvoir affirmer sans beaucoup de doutes que la dernière fois fut sans doute lorsque je commentais ici Voyage au bout de la nuit de Louis Ferdinand Céline. Et c’est, malheureusement, pour les mêmes raisons. Sans vouloir faire de parallèle entre les deux œuvres (Voyage étant à ranger au rayon des chefs-d’œuvre de la littérature mondiale, les Leçons qui nous occupe aujourd’hui à celui de la fantasy intelligente), elles posent toutes deux la question de distinguer l’œuvre de son auteur. Si d’un point de vue purement judiciaire, le crime de l’aîné est probablement pire que ceux de notre contemporain, si l’on se place au niveau moral, il me semble vain de vouloir établir une quelconque gradation.
Car Noirez, jeune auteur de la scène fantastique française il y a encore quelques années, est désormais persona non grata. Ses éditeurs, s’ils n’ont pas retiré ses livres de la vente, se font très discrets sur l’homme. Noirez, en effet, est blacklisté. Et pour une très bonne raison. Il a été condamné en 2016 pour possession et diffusion d’images à caractère pédopornographique. Les sites traditionnels de la SFFF francophone, à l’image de l’entrefilet d’Elbakin, n’ont que relayé l’information de manière assez éludée, sans doute dans l’intention de ne pas choquer l’éventuel jeune lecteur. Car Noirez, au-delà de sa production adulte, fut également un auteur pour la jeunesse, ce qui nous fait tous, j’imagine, encore plus froid dans le dos.
En cherchant un peu sur l’Internet, on retrouve cependant quelques archives qui démontrent bien l’existence du vice, la noirceur de l’individu, l’horreur de son crime. Je n’ai, c’est évident, aucune forme de pitié pour cela. Un article assez intéressant de Marianne revient sur l’histoire compliquée que la littérature et certains de ses auteurs respectables (Gide, Montherlant, Tournier et quelques autres) entretiennent avec la pédophilie. L’article, bien construit, démontre comment l’histoire des mœurs a évolué au long du XXeme pour transformer ce qui fut une lubie malvenue mais tolérée comme une tare d’artiste en ce qu’elle est vraiment : un crime inacceptable. Étant de la génération des jeunes ados de l’affaire Dutroux, j’ai comme tous mes contemporains été confronté à cette triste réalité de manière frontale par cette affaire surmédiatisée. Elle eut le mérite, s’il faut en trouver un, de nous ouvrir les yeux.
L’article de Marianne, cependant, se trompe. Je le cite : « Jérome Noirez, auteur de science-fiction, condamné pour diffusion de matériel pédopornographique en 2016, a vu son éditeur retirer de la vente tous ses livres, pourtant totalement exempts d’allusions pédophiles. » C’est peut-être vrai pour sa production jeunesse, que je ne connais pas, mais ce n’est pas le cas pour sa production adulte.
Leçons du monde fluctuant, dont il est question ici, en contient en effet de nombreuses. Ce qui rend cet article d’autant plus compliqué à écrire et le jugement sur l’œuvre d’autant plus trouble. Noirez, dans ce roman fantastique et largement absurde, nous plonge dans une Londres alternative de la fin du XIXeme. Ce Londres est sous l’hégémonie de la Grande Reine Victoria qui dirige son empire sur le principe de l’éducation. C’est l’éducation et uniquement elle qui doit sortir les peuples de l’ignorance, qui doit vaincre la pauvreté. Le programme est joli, la réalité nettement moindre : sous ce principe se cache une société totalitaire, extrêmement conservatrice qui n’hésite pas à pratiquer le châtiment corporel sur ceux qui n’apprennent pas (assez vite, assez bien), enfants ou adultes sans distinction. Le savoir est érigé en principe fondateur jusqu’à l’absurde. Et c’est sans ce monde que Noirez nous introduit à son personnage principal : Charles Lutwidge Dodgson. Qui, dans le monde réel, le nôtre, finit par prendre un pseudonyme pour sa carrière d’auteur fantaisiste : Lewis Carroll.
Et vous saisissez maintenant pourquoi le livre est extrêmement ambigu. L’auteur d’Alice au pays des merveilles a en effet lui-même une histoire personnelle qui sent le soufre. Si son livre phare a traversé les décennies, soutenu par le fait qu’il fut définitivement absous en étant adapté en classique par nul autre que Disney, cela n’empêche de très nombreuses voix modernes de se questionner sur les troubles penchants de l’auteur anglais. L’autre personnage principal du roman est un (très) jeune fille du nom de Kematia, une indigène d’une île lointaine ressemblant à une Madagascar fantasmagorique. Elle est morte au début du récit, des suites de ce que l’on apprendra plus tard être une excision s’étant mal passée. Elle se réveille alors dans un purgatoire local et n’aura de cesse de comprendre ce qui lui sera arrivé, pourquoi cela lui est arrivé et comment faire pour réparer cette injustice, même dans l’autre monde.
Le bouquin, construit sur des chapitres mettant en scène alternativement les mésaventures de Dodgson, chassé de son université pour ses penchants inavouables et envoyés aux confins de l’Empire car cela arrange bien tout le monde, et la quête de Kematia, le bouquin, disais-je, est plutôt bon. Noirez a des facilités d’écriture évidentes et maîtrise déjà une construction relativement complexe. Il développe des personnages intéressants, troubles, gris et invente une version « adulte » du délire de Lewis Carroll avec, il faut bien l’avouer, un certain brio. Le bouquin, en somme, est original et, finalement, agréable à lire.
C’est d’autant plus troublant pour le lecteur quand on se rend compte que Noirez use de ce trouble, de cette zone grise, pour finalement rester lui-même très flou sur certains aspects du récit qui prennent une tout autre dimension quand on connait la face cachée de l’auteur. La critique parue dans un Bifrost de l’époque expliquait ceci : « Charles Dodgson et Kematia nous apparaissent donc comme des victimes de leurs sociétés respectives : lui, condamné sans preuves par une société où il n’a jamais pu trouver sa place (Noirez évite de se prononcer sur la véracité des penchants pédophiles de son héros, là n’est pas son propos), elle, morte à cause d’une vieille tradition inhumaine. » La parenthèse du texte, que je ne reproche bien sûr pas à l’auteur de la critique rédigée in tempore non suspecto, fait maintenant réfléchir.
Il me semble évident que Noirez, personnage malade et dangereux pour la société comme cela est désormais démontré par la justice, s’est projeté dans ce double imaginaire de Carroll. Il le dépeint largement comme couard, faible, hésitant et honteux de ses pulsions. Mais Dodgson est, malgré lui peut-être, le héros de Leçons du monde fluctuant. Il s’en sort, contrairement à tous les autres personnages. Il est, dans une certaine mesure, triomphant. Sans, comme le précise Bifrost, avoir été confronté en une quelconque manière à ses penchants inexcusables et horribles. C’est donc en même temps un très bon roman de SFFF et un livre à mettre à l’index, définitivement, tout comme son auteur.
Si vous vous demandez pourquoi je l’ai lu, c’est assez simple : je ne savais rien de Jérôme Noirez avant de lire le bouquin et ce n’est qu’en faisant quelques recherches sur le net pour rédiger cette critique que j’ai compris réellement ce que je venais de lire/ce que j’avais entre les mains. La conclusion de ce long article est plus simple à écrire, cependant, que dans l’article sur Voyage au bout de la nuit. Leçons d’un monde fluctuant est sans doute aucun un bon livre fantastique ; cela ne fait cependant pas de lui un monument de la littérature. L’antisémitisme de Céline est, à nouveau sans gradation dans le mal, aussi inexcusable et condamnable que la pédophilie de Noirez. Mais son œuvre, à Céline, est bien autre chose. Et le débat mérite donc d’être mené. Dans le cas de Noirez, ce n’est pas le cas. Passez votre chemin et laissons l’histoire oublier jusqu’à l’existence de ce pauvre être humain. Il y a bien d’autres livres à lire et bien d’autres auteurs à découvrir. Noirez ne sera qu’un secret honteux de la SFFF française que l’on aura oublié d’ici quelques années. Et c’est tant mieux.

 De
De 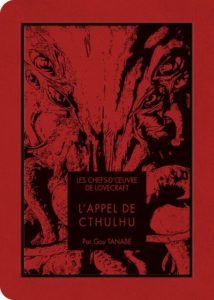 De
De 
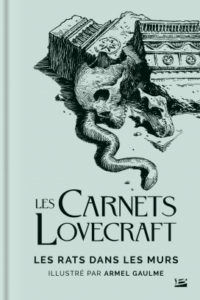 De
De