 De Richard Stanley, 2019.
De Richard Stanley, 2019.
Une adaptation cinéma de H.P. Lovecraft ? Beaucoup s’y sont essayés. Peu sont arrivés jusqu’au bout. Et parmi eux, encore moins sont ceux qui livrèrent en définitive quelque chose de regardable. On attend par exemple toujours des nouvelles de la fameuse adaptation des Montagnes hallucinées par Guillermo del Toro, bloquée depuis des années dans ce qu’Hollywood aime appelé le « development hell« . Je fus donc surpris il y a quelques mois que je suis tombé sur la bande d’annonce de The Color out of Space. Encore plus en voyant que l’acteur qui portait le projet était Nicolas Cage, acteur fantasque par essence qui enchaîne les tournages pour des productions ZZ, entrecoupés de quelques coups d’éclat et de cures de désintoxication. L’exemple même de la star sur le retour qui joue dans n’importe quoi pour un cachet (comme John Travolta ces dernières années ou, dans une certaine mesure, Bruce Willis).
Et la bande d’annonce était très limite : il y avait de bonnes idées visuelles, mais aussi un faux rythme assez étrange. Sans compter que déplacer l’histoire originale au monde actuel m’inquiétait beaucoup. Moderniser Lovecraft semblait en effet un oxymoron. S’il y a bien un auteur de SF que je ne vois pas dans le monde moderne, c’est bien Lovecraft (quoi que, d’une certaine manière, l’amour de la technologie et des sciences nouvelles qu’il décrit dans certains de ces textes tendrait en fait à démontrer l’inverse). Bref, j’avais beaucoup, beaucoup de doutes.
Et quel meilleur moyen de confirmer ou d’infirmer ces doutes qu’en se lançant dans le visionnage ? C’est désormais chose faite. Et… C’est plutôt une bonne surprise, finalement ! Richard Stanley, réalisateur dont le nom même ne m’évoquait rien, mais qui est doté d’un look formidable, a mis tout son cœur dans la réalisation de cette adaptation aussi inattendue qu’inespérée. Le bonhomme n’avait plus rien réalisé depuis plus de 20 ans, depuis qu’il avait été viré du plateau de son précédent long métrage (L’île du docteur Moreau, on constate déjà un certain attrait pour le fantastique). L’idée d’adapter Lovecraft lui était venu en 2013 alors qu’il adaptait en court métrage une nouvelle de Clark Ashton Smith, l’un des bons amis du reclus de Providence et auteur très inspiré de pulp en son temps (cf. critique ici même).
Et pour réaliser son rêve, il a ratissé large et est aller chercher des sous chez une série de boîtes de production mineures et assez confidentielles : SpectreVision, ACE Pictures Entertainment et XYZ Films. Encore une fois, tout ceci sent la série B un peu fauchée qui n’aura pas les moyens de ses ambitions et ne pourra donc pas rendre justice, une fois encore, au génie créatif de Howard Philip Lovecraft. Et pourtant. Et pourtant Richard Stanley, avec un petit budget, est parvenu à réaliser un petit miracle. Le film est loin d’être parfait, mais il regorge de bonnes intentions. En résumé, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec la nouvelle d’origine, The Color out of Space nous raconte la réelle descente aux enfers de la famille Gardner. Habitant dans un recoin assez isolé, la vie quotidienne de la famille est bouleversée lorsqu’une météorite à quelques dizaines de mètres de leur porte d’entrée. Et quand la météorite se révèle est le vaisseau organique d’une « couleur » venant littéralement du ciel. Sans avoir particulièrement de bonnes intentions…
L’histoire nous est contée, comme toujours avec du Lovecraft, par un personnage secondaire, un jeune scientifique envoyé dans le coin pour étudier les nappes phréatiques dans le cadre d’un projet de construction d’un barrage local. Un scientifique répondant au patronyme de Ward Phillips. Et le brave homme correspond parfaitement au cahier des charges du héros lovecraftien : il est totalement passif et ne sert à rien d’autre qu’à introduire et conclure l’histoire. Au moins ne tombe-t-il pas dans les pommes, c’est déjà ça. Elliot Knight fait le boulot, avec un beau pied-de-nez au racisme latent des textes originaux du Maître de Providence, puisque Stanley a eu la bonne idée de caster un afro-américain pour jouer le rôle. On lui prête aussi un intérêt charnel envers la fille Gardner, jouée par une très bonne Madeleine Arthur (plus habituée aux séries télé qu’aux longs métrages, mais qui tire réellement son épingle du jeu en adolescente gothique et rebelle. D’ailleurs, le cast s’en sort généralement très bien : Joely Richardson campe très bien une mère Gardner modernisée mais à la limite de la crise de nerf, comme dans la nouvelle d’origine. Brendan Meyer et Jordan Hilliard font aussi du bon boulot dans le rôle des deux jeunes frères de la famille maudite. Même Cage ne s’en sort pas trop mal : il y a bien sûr ses explosions de folie qui sont devenues, au fil des ans, sa marque de fabrique, mais cela colle plutôt bien avec la progressive perte de contrôle du père/chef de famille.
Richard Stanley a également eu l’intelligence d’éviter certains passages de la nouvelle originale qui auraient mal rendus à l’écran. Il n’insiste donc pas sur la création d’une faune et d’une flore géante et corrompue. Il remplace ceci par des touches plus subtiles de flore inquiétante en second plan sur les plans larges qui englobent la nature proche de la villa des Gardner. Et c’est tant mieux, puisque l’un des seuls animaux « étranges » filmé en gros plan (une mante religieuse rose/mauve avec tentacules, bien sûr !) révèle que le film a en effet des moyens limités en termes d’effets spéciaux. Pour compenser ceci, Stanley utilise intelligemment des lumières roses directes ou indirectes et des effets de saturation sur la pellicule qui tentent de rendre « l’indicible » couleur venue de l’espace. De même, il use et abuse des vieux trucs de films d’horreur fauchés : les « monstres » y sont filmés dans la pénombre, en insistant sur certains éléments (les plus réussis) des props et maquillages sanguinolents. Et ses monstres font effectivement froid dans le dos.
The Color out of Space est-il pour autant un bon film ? Eh bien c’est surtout un bon divertissement et une honnête série B d’horreur. Le film n’est pas du tout exempt de défaut (comme scénariste, j’aurais volontiers éliminé certains éléments qui n’apportent pas grand-chose au film, comme le subplot sur les intentions du maire de la ville d’Arkham ou encore le fait que la mère Gardner soit en réminiscence d’un cancer). Le film respecte également certains poncifs hollywoodiens avec le portrait d’une famille américaine dysfonctionnelle où les femmes sont finalement plus fortes que les hommes (ce qui n’aurait sans doute pas été du goût de Lovecraft). The Witch, il y a quelques années, avait par exemple fait moins de compromis. Mais, en résumé, le film est très sympathique et est un bon essai d’adaptation de Lovecraft. On n’y est pas encore, bien sûr, mais je me demande si un réalisateur parviendra un jour à rendre effectivement l’ambiance si particulière, tellement Nouvelle-Angleterre du début du XXème.


 De Neil Gaiman, 2008.
De Neil Gaiman, 2008.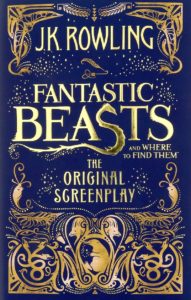 De
De  De
De