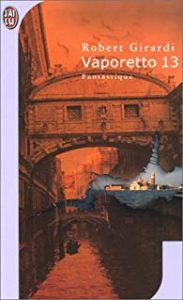 De Robert Girardi, 1997.
De Robert Girardi, 1997.
Il y a quelque chose dans la Sérénissime qui attire les écrivains et les emporte dans une sorte de mélancolie contemplative, hésitant entre le fantastique macabre et l’amour maudit. J’avais déjà rédigé quelques pensées sur La forteresse de coton de Philippe Curval dans ces colonnes. 30 ans avant Vaporetto 13, l’auteur français se servait déjà de Venise comme d’un décors à une histoire d’amour hors du temps et hors du commun. Cependant, Robert Girardi est nettement plus terre à terre que son collègue français : c’est un auteur américain qui place le récit devant le style.
Auteur ayant connu quelques années de gloire à la fin de années 90, après dix ans de galères éditoriale et avant de replonger dans l’anonymat à l’aube des années 2000, Robert Girardi était pour moi, je l’avoue volontiers, un parfait inconnu. Mais comme je garde un très bon souvenir de Venise et que la quatrième de couverture me plaisait, je me suis quand même lancé dans son intriguant Vaporetto 13.
En quelques mots, on y suit l’histoire de Jack Squire, un trader américain qui n’aime pas beaucoup sa vie de golden boy, coincé avec une jolie femme qu’il n’aime pas non plus et qui fréquente ses « amis » professionnels qu’il n’aime définitivement pas. La banque pour laquelle il travaille, pour une raison assez obscure (véritable opportunité ? mise au placard ?) l’envoie dans la vieille Europe pour y surveiller les marchés locaux de l’intérieur. Et, plus précisément, dans une succursale italienne du conglomérat bancaire qui l’emploi, à Venise. Là-bas, Jack se sent mal. Sa vie lui échappe et il sombre dans une insomnie causée tant par ses propres remords que par la ville elle-même, aussi repoussante qu’elle peut être attirante. Le Venise touristique est en effet également une ville qui sombre, une ville morte, une ville musée. Où la décrépitude se bat avec le pourrissement. Où les odeurs de moisi se disputent l’air ambiant avec le gasoil puant des bateaux-moteur, beaucoup plus nombreuses que leurs innocentes parentes, les gondoles.
C’est en fin de nuit, à l’heure où la ville dort, qu’il rencontre par hasard lors d’une de ses promenades d’insomniaque désespéré une femme étrange qui nourrit les chats errants de la cité des Doges. Il apprend alors progressivement à la connaître, alors qu’elle l’entraîne dans une ville interlope, méconnue, comme hors du temps. Et sa vie s’effiloche encore davantage, perdue dans les bras de cette amante aussi froide que mystérieuse.
Voilà un roman aussi classique qu’insolite ! Classique, car il ronronne souvent sur du facile. La vie de trader de Jack, les épisodes en flashback nous éclairant sur son histoire et la progression finalement très mécanique du récit ne relèvent pas d’une grande inventivité. De même, certaines « ficelles » d’écrivain transparaissent un peu trop dans les lignes de Girardi. Sans compte une certaine forme de naïveté très année 90 sur les milieux financiers, sur les femmes et sur la rédemption par l’amour.
Pourtant, le bouquin est aussi insolite. De manière assez efficace, le livre est marqué d’une connaissance visiblement documentaire de la Sérénissime, de son histoire et de ses légendes. De manière plus incongrue peut-être, on y découvre un portrait politique de l’Italie moderne alors en pleine transition (je ne m’attendais pas à lire dans un bouquin fantastique plusieurs pages sur le conflit Prodi/Berlusconi). Et ce mélange des genres fonctionne, bizarrement, assez bien. L’amour que l’auteur porte pour Venise, certainement plus que pour son personnage principal qui est finalement assez médiocre, et pour une certaine idée de la décadence italienne sont les véritables forces du roman.
Vaporetto 13 est donc un roman assez inégal, mais qui se lit pourtant avec passion jusqu’à sa conclusion. Si Girardi était davantage sorti des sentiers battus et avait franchi le pas pour verser réellement dans le fantastique, le bouquin en serait probablement sorti grandi. Mais cette hésitation entre les genres, tout comme l’indécision de son héros, qui passe les trois quarts du livre dans un état second par manque de sommeil, rende l’atmosphère de l’œuvre pesante et séductrice tout à la fois. Ce mélange de répulsion et d’admiration force le lecteur à suivre Girardi jusqu’au bout de sa pensée, jusqu’à une fin en demi-teinte, prévisible et pourtant inévitable.
Conclusion : je vous conseille Vaporetto 13 si vous voulez vous perdre quelques heures dans le dédale des impasses et des canaux vénitiens. Vous y trouverez le charme déliquescent si particulier de cette ville. Vous y découvrirez les spécialités culinaires (autre obsession de l’auteur, visiblement). Vos sens seront requis pour suivre Jack dans sa fuite en avant. Vous rappellerez-vous les détails du récit d’ici quelques semaines ? Non, sans doute pas. Mais d’une impression fugace : une décrépitude fascinante. Ce n’est déjà pas si mal.

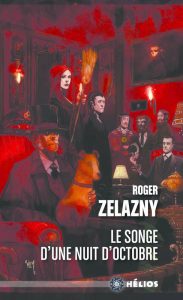 De
De 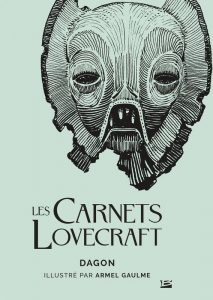 De
De 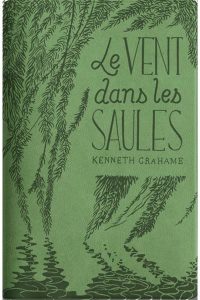 De
De 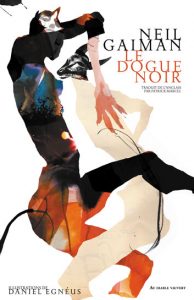 De
De