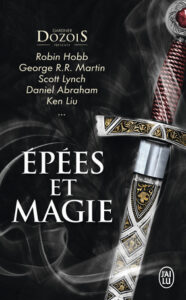 Édité par Gardner Dozois, 2017.
Édité par Gardner Dozois, 2017.
Publié une petite année avant la mort de l’anthologiste, Épées et Magie est donc l’un des derniers pavés de fantasy rassemblé par Gardner Dozois. Si l’homme est un auteur de fantasy et de SF peu prolifique, ses qualités d’éditeur/d’anthologiste ne sont plus à démontrer. Souvent associé à son vieux compère George R.R. Martin, Dozois a signé nombres d’ouvrages primés, allant du Hugo au Locus en passant par le World Fantasy Award. Au-delà de ces prix, il a surtout, des années 90 aux années 2010 contribué à découvrir et mettre en valeur nombre d’auteurs (exclusivement nord-américains, il est vrai) de qualité dans la fantasy et le SF. Attentif aux évolutions des genre, il a très tôt repéré, par exemple, le virage dark fantasy que le genre a pris à l’aube des années 2000. Dans ces colonnes, nous avions déjà abordé l’anthologie Dangerous Women, cosignée par R.R. Martin, qui recélait autant de textes excellents que des nouvelles plus anecdotiques. Et qu’en est-il de ce volume Épées et magie (dont le titre anglais, The Book of Sword, est nettement plus cohérent avec son contenu…) ?
Après une courte introduction de l’anthologiste sur les épées légendaires que l’histoire à retenu, le bouquin s’ouvre sur Que le meilleur gagne, de K. J. Parker. Une histoire sombre, brute, qui sent le métal et le sang. Je ne connaissais pas l’auteur, mais la nouvelle est clairement une entrée en la matière qui colle parfaitement au sujet et qui augure de bonnes choses. Un vieux militaire, reconverti en forgeron, accueille un jeune homme faussement naïf qui lui demande de forger la meilleure épée jamais forgée. Si la fin de la nouvelle est prévisible, son inéluctabilité n’en fait pas moins texte fort et marquant.
Le deuxième texte, L’Épée de son père, est signée de la main de Robin Hobb, aka Megan Lindholm. La nouvelle, qui ne s’encombre que très peu d’explications, se déroule dans l’univers de l’Assassin royal, saga fleuve qui a propulsée son auteure au panthéon de la fantasy mondiale. Le texte suit une jeune femme confrontée, dans son village de pêcheur, à l’attaque des pirates rouges et des terribles forgisés. Triste, glaçant, le texte se conclut en fin ouverte qui ne peut que pousser le lecteur à découvrir la saga fleuve s’il ne l’a pas encore fait (et je ne l’ai pas encore fait, pour être honnête !)
La troisième nouvelle est signée par la superstar Ken Liu, le chouchou de la planète SFFF depuis quelques années maintenant. Dans la veine des nouvelles de La ménagerie de papier, le texte qui nous est proposé ici, La Fille cachée, est effectivement un petit bijou de construction et un véritable plaisir de lecture. On y découvre une jeune fille enlevée par une ascète tueuse à gage pendant sa première véritable mission dans une Chine médiévale aussi inspirée que fantasmagorique. Très poétique et très spectaculaire. Du tout bon, même si la thématique de l’épée qui dimensionne à l’anthologie passe ici au second plan.
Le texte suivant, L’Épée de la Destinée, est signé de la main Matthew Hughes. Visiblement peu traduit en français, le nom ne me disait rien. Il signe pourtant ici un texte fort amusant, plein de rebondissements et de péripéties. S’il est moins sérieux que les textes qui le précèdent, il ne détonne cependant pas du tout dans une anthologie de fantasy : l’assistant d’un mage est occupé à voler une épée légendaire quand l’opération tourne au vinaigre. Obligé de fuir, il décide de quitter le pays pour éviter le courroux de son maître. Mais, comme de juste, il tombera sur un second mage encore pire que le premier qui est, lui aussi, fort intéressé par l’épée légendaire pour une toute autre raison. Mages sournois (et ridicules), gargouilles serviles, démons aussi terribles que philosophes sont au rendez-vous de cette parenthèse amusée. Du bon, encore !
La cinquième nouvelle est également signée par une autrice qui n’est que très peu, jusqu’à présent, traduite sous nos latitudes. Kate Elliott, pourtant, a du potentiel. J’imagine que ses séries, si elles sont à la hauteur de « Je suis bel homme », dit Apollon Freux, connaitrait un succès mérité. Le texte nous introduit intelligemment auprès d’Apollon Freux, un voleur mystérieux qui se révèle bien vite avoir des pouvoirs autres qu’un charme et une morgue à toute épreuve. On sent un univers qui se dévoile dans ce quelques pages, univers que l’on a hâte de parcourir plus avant. Dommage que le texte soit si court. Le texte suivant, de Walter Jon Williams (dont je ne connaissais que le Sept jours pour expier, publié chez Folio SF – un des rares titres de weird west publié en français !), est quant à lui plus anecdotique. Le triomphe de la vertu nous fait découvrir un aimable aristocrate désargenté qui joue les enquêteurs. Pas grand-chose de plus à dire que cela, si ce n’est qu’à nouveau le lien avec les épées du titre de l’anthologie est pour le moins tenu. Un texte plaisant, mais mineur et rapidement oublié.
Au contraire du texte suivant, signé de la main de Daniel Abraham. Et si le nom ne vous est pas familier, le pseudonyme qu’il utilise lorsqu’il écrit avec son collègue Ty Franck vous l’est sans doute davantage : il s’agit de James S.A. Correy, l’auteur de The Expanse et, par ailleurs, d’un proche collaborateur de George R.R. Martin pendant de nombreuses années. La Tour moqueuse est une nouvelle qui part d’un postulat classique : un voleur s’introduit dans une ville de campagne pour y retrouver un complice déjà dans la place et tenter de dérober une épée légendaire dans un tour magique à proximité. Cependant, les apparences sont trompeuses, à plus d’un titre. Et ce qui est espéré comme une libération n’est souvent qu’une illusion décevante. Un texte adulte, dramatique et puissant, encore un.
La nouvelle suivant a été pour moi l’occasion de lire pour la première fois du C.J. Cherryh, grand nom de la SF avec ses sagas L’Univers étranger et le Cycle de Chanur, entre autres. Hrunting, qu’elle nous présente ici, se plait à imaginer ce qu’il advient quelques années après les évènements décrits dans Beowulf. Froid, sombre, dans la thématique de l’anthologie, la nouvelle fait certainement le taf. Dommage qu’elle n’ait pas ce je-ne-sais-quoi en plus qui en fait un texte dont on se rappelle des années plus tard. La prochaine nouvelle, Une piste longue et froide, est une plongée dans l’imagination de l’Australien Garth Nix, publié uniquement en jeunesse en français grâce à sa série Les sept clés du pouvoir. On y suit Sir Hereward, le fils illégitime d’une sorcière et son acolyte Monsieur Fitz, un pantin de bois et maître du premier, dans leur traque d’un Dieu armé de bien mauvaises intentions. Amusant, bourré d’action, mais probablement un peu plus faible que la majorité des nouvelles de l’anthologie.
Alors que j’attendais à apprécier particulièrement la nouvelle suivante, Quand j’étais bandit de grand chemin, de l’excellente Ellen Kushner (dont j’avais particulièrement aimé Thomas le Rimeur), j’avoue n’avoir que des souvenirs très épars du texte maintenant que j’ai fini l’anthologie il y a quelques jours. Et ce n’est généralement pas un bon signe. Peut-être l’aurais-je aimé davantage si j’avais lu A la pointe de l’épée, avec lequel cette nouvelle partage le cadre, mais comme ce n’est pas le cas, le texte n’a tout simplement pas marché sur moi. Dommage, sans doute. Au contraire de la prochaine nouvelle. La fumée de l’or est la gloire laisse rend parfaitement hommage à la gouaille si particulièrement de Scott Lynch. On retrouve ici un petit voleur, à la façon de son désormais célèbre Locke Lamora, embarqué dans une chasse au dragon légendaire. On pardonnera à Lynch de n’avoir pas placé l’épée au centre de son récit mais de s’être davantage orienté sur ce que c’est réellement d’être un aventurier dans une histoire de fantasy où, ostensiblement, on n’a pas le niveau des ennemis en face. Du tout bon.
Le texte suivant, L’Énigme Colgrid, est également un peu hors sujet. Point d’épée comme argument principal de la nouvelle, ici. Mais Rich Larson, encore un auteur qui n’est que très peu traduit, livre du bon boulot. Deux voleurs (c’est une constante, on aime bien les voleurs dans la fantasy moderne !) se retrouve bien malgré eux dans un décor qui hésite entre le steampunk et le post-apocalyptique pour faire ouvrir un coffre à la serrure complexe qu’ils viennent de délester à son précédent propriétaire. Pour tout paiement, l’experte qu’ils espèrent voir ouvrir leur larcin réclame leur aide pour se venger d’un baron local de la drogue. Noir, bourré d’action et de plans machiavéliques, la nouvelle fonctionne à merveille même si elle repose sur des mécanismes classiques du pulp (ici très intelligemment mis à jour).
Le Mal du roi, d’Elizabeth Bear -que je découvre ici-, est également une bonne surprise. Dans un monde oriental que l’on ne fait ici qu’esquisser, on suit ici la recherche d’une femme, porte-voix d’un empereur statufié, aidé de deux gardes du corps, un homme métallique et un aventurier des sables, sur une île inhospitalière. Elle vient y chercher l’or des empereurs du passé pour permettre à son peuple de survivre. Construit comme une aventure d’Indiana Jones mêlée de fantastique, la nouvelle livre aussi quelques considérations intéressantes sur la famille, la filiation et le sens de la vie. Pas mal, pour un texte de 50 pages.
L’antépénultième nouvelle de l’anthologie, La Cascade, une nouvelle de flingues et sorcellerie, est atypique. Point d’épée ici, puisqu’on y suit une aventure d’un pistolero toxicomane et chasseur de prime. Violent, agressif, le texte de l’israélien Lavie Tidhar est une belle entrée en la matière pour découvrir cet auteur malheureusement pas encore traduit chez nous. Et l’avant-dernière, L’Épée Tyraste, est également une belle découverte. Cecelia Holland, surtout connue pour ses romans historiques, rédige ici une histoire de vengeance sombre et froide à la cour d’un roitelet viking fourbe. Plus classique dans son approche et dans son thème, l’utilisation intelligente de l’épée, au cœur de l’anthologie, offre un twist attendu mais satisfaisant en conclusion de sa nouvelle.
Et l’anthologie se conclut finalement sur nul autre que sur George R.R. Martin. A l’instar du dernier texte de la première partie de Dangerous Women, l’auteur nous plonge une nouvelle fois ici en plein Westeros. Les Fils du Dragon nous parle, il fallait s’y attendre, des conflits dans une fratrie targayenne. Qu’est-ce qu’on rigole avec les Targayens ! Toujours une bonne occasion de s’en mettre plein la tronche en emportant la moitié des Sept Royaumes dans leur folie atavique. A nouveau, R.R. Martin dresse ici, en un peu plus de 60 pages, une véritable page d’histoire de son monde fictif, situé quelques centaines d’années avant les évènements du Trône de Fer. Condensé en ces quelques pages, on y suit des évènements sur deux générations avec nombre de morts, de trahisons et de coups bas. Presque autant que dans la saga fleuve qui fit les beaux jours d’HBO jusqu’à la honnie huitième saison. Que dire ? C’est davantage une chronique historique qu’une nouvelle, mais c’est évidemment efficace, comme toujours avec R.R. Martin. Petit regret cependant : les évènements et les noms s’enchaînent tellement vite qu’il est malaisé de bien saisir les jeux de pouvoir qui lient les uns aux autres, sachant que les alliances et inimités ne sont évidemment pas les mêmes que celles que l’on découvre au temps de sa descendante, Denaerys Targayen, la Mère des Dragons.
Vous l’aurez saisi, Épées et Magie est une très très bonne anthologie qui offre un véritable best off de ce que la fantasy anglo-saxonne a de meilleur à proposer ces 10 dernières années. Là où j’avais beaucoup plus de doute sur la qualité de certains textes de Dangerous Women, je n’ai que très peu de réserve sur celui-ci. S’il y a bien une ou deux nouvelles plus passe-partout, la qualité de l’ensemble est tellement haute qu’il serait vraiment dommage de passer votre tour. A la condition, bien sûr, que vous aimiez la fantasy et que les textes plus sombres ne vous effraient pas.

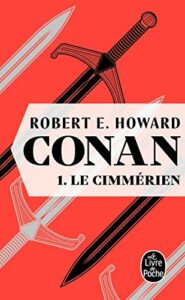 De
De 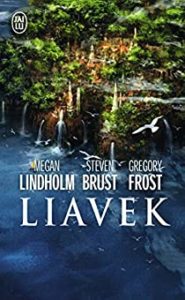 De
De 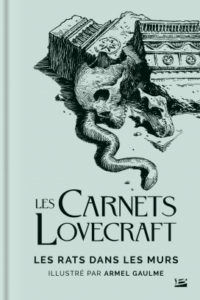 De
De 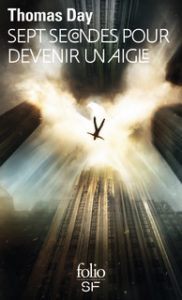 De
De