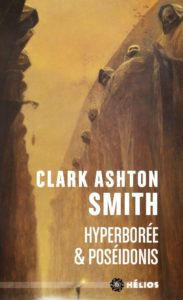 De Clark Ashton Smith, 1929-1957.
De Clark Ashton Smith, 1929-1957.
Troisième et dernier tome de l’intégrale des nouvelles de fantasy de Clark Ashton Smith, après Zothique et Averoigne, Hyperborée & Poséidonis nous plonge une nouvelle fois dans l’exquise plume de son auteur. Il se plait, comme dans les recueils précédents, à peindre des mondes imaginaires et déliquescent où la magie et la mort tiennent les rôles principaux. Ce dernier tome, que l’on doit toujours à l’inspiration éclairée des éditions Mnémos et aux contributeurs généreux du projet Ulule, verse plus volontiers encore que les deux précédents opus dans le sombre, l’horreur et le désespoir.
Passé une préface assez laborieuse de Scott Connors, le recueil de nouvelles s’ouvre donc sur les textes consacrés à l’Hyperborée, ce continent mythique situé dans l’actuel Arctique. Les savants du début du XXème y voyait le creuset de l’humanité, à une époque où une jungle luxuriante remplaçait alors les glaces éternelles. Le confrère de Smith, Robert E. Howard fut lui aussi très inspiré par ses textes scientifiques aussi imaginatifs qu’évocateurs et y plaça nombre de ses récits fantastiques lui-aussi. Cependant, Smith ne choisit pas de nous conter les premiers pas de l’Homme dans des récits protohistorique. Non, alternativement, il nous conte des épisodes de l’Hyperborée au temps de sa gloire, lorsque la civilisation humaine y atteignit son apogée et que ses représentants frayaient volontiers avec des dieux anciens, incarnés et impies, puis Smith nous offre également des histoires nettement plus tardives qui prennent place lorsque l’Hyperborée verte cède inexorablement sa place à un désert de glace, lui aussi proie à de sombres secrets et à des cultes aussi oubliés que périlleux.
Comme je l’expliquais dans les deux précédentes critiques concernant cette trilogie de recueils, les nouvelles de Smith ne respirent en rien la joie de vivre. Encore moins dans ce troisième opus que dans les deux premiers, peut-être. Là où les sirènes du pulp permettait à Smith de céder à quelques facilités dans Averoigne, notamment, avec quelques scènes érotiques propres à attirer le chaland, il n’en est rien dans Hyperborée & Poséidonis. A l’instar de Zothique, je vous mets au défi de trouver la moindre nouvelle se concluant positivement. Si certaines, notamment celles consacrées aux voleurs, sont plus légères, la très grande majorité de la grosse vingtaine de nouvelles du recueil nous plongent plus volontiers dans le désespoir que l’héroïsme. La seconde partie, consacrée à Poséidonis, l’île constituée des dernières émergées de la légendaire Atlantide, ne font même que renforcer ce trait.
Car, plus encore qu’en Hyperborée, les protagonistes de Poséidonis ont ancré dans leur âme la notion même de finitude, d’échec, de labeur inutile. Leur île est destinée à disparaitre et leurs efforts n’y feront rien. Les plus puissants nécromants qui l’habitent sont logés à la même enseigne que la populace : les contrats impies qui les lient aux engeances du mal ne les sauveront pas plus de la fin de leur histoire.
La plume de Smith, admirablement traduite par Vincent Basset, poétique, triste, désespérée par moment, sert parfaitement son propos. L’abus d’épithètes propre à une certaine époque, qui pourrait rendre le texte ampoulé et indigeste, permet au contraire au lecteur de se faire une idée des horreurs que croisent les narrateurs des diverses nouvelles qui composent le recueil. Plus explicite que son ami Lovecraft, Smith n’hésite pas à décrire par le menu les entités abyssales, les dieux oubliés qui émaillent ses récits. Et l’horreur, comme dans toute bonne histoire pulp qui se respecte, est au rendez-vous.
Le recueil se conclut par une postface de l’érudit S.T. Joshi, sans doute le plus grand spécialiste vivant de Lovecraft, qui nous livre une analyse pertinente et argumentée des textes présentés ici. Je me permettrais seulement de ne pas partager son point de vue quant à la satire qu’il lit dans ces nouvelles. Il me semble évident, en effet, que Smith était en complet décalage avec son époque, qu’elle soit littéraire ou simplement sociétale. Mais je ne vois pas réellement de satire dans ses textes. J’y vois surtout l’expression d’un mal-être profond que seul l’écriture a pu, même si ce n’est que partiellement, soigner. C’est probablement le meilleur des trois recueils, même s’ils sont tous les trois très bons, puisque s’exprime ici encore plus librement et complètement l’idée de la chute, de la perte, de l’inévitable fin de l’être. Je l’ai dit et répété : sans doute ce que l’on fait de mieux en pulp, aux côtés de ses pairs, H.P. Lovecraft et Robert E. Howard.

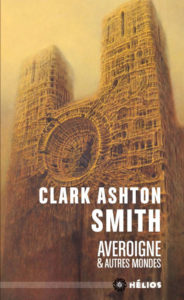 De Clark Ashton Smith, 1930-1951.
De Clark Ashton Smith, 1930-1951. Suivi de Je répare tout.
Suivi de Je répare tout. De
De 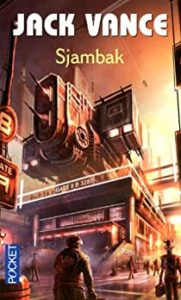 De
De