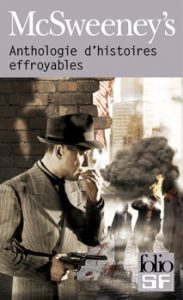 Édité par Michael Chabon, 2002.
Édité par Michael Chabon, 2002.
Réédition partielle (des nouvelles imaginaires uniquement) de McSweeney’s Méga-anthologie d’histoires effroyables, paru chez Gallimard (collection « Du monde entier« ) en 2008.
Michael Chabon n’est pas un anthologiste fort connu dans le monde de la SFFF. Et c’est assez logique, car ce n’est pas son/ses genre(s) de prédilection. De fait, la McSweeney’s Anthologie d’histoires effroyables n’est qu’un extrait d’une anthologie plus vaste, datant de 2002 et publiée en 2008 dans la collection Du monde entier de Gallimard (la petite cousine de la Blanche, consacrée aux textes étrangers). Dans cette réédition partielle en poche chez Folio SF en 2011 ne sont donc repris que les textes à vocation imaginaire (au sens large). Et c’est assez dommage de se priver de quelques textes de littérature blanche qui faisaient partie de la méga-anthologie (remarquez l’usage subtil du superlatif) d’origine. On se passe donc de textes signés entre autres par Kelly Link, Neil Gaiman, Stephen King ou encore Michael Crichton. De signatures que l’on associerait pourtant volontiers aux littératures de l’imaginaire. Mais soit, n’ergotons pas sur les choix éditoriaux bizarres de Gallimard (puisque Folio-SF est la collection poche de genre de Gallimard, bien sûr).
Avant d’entrer dans le corps du bouquin en tant que tel, encore quelques mots de contexte. D’abord, ne vous laissez pas rebuter par la très moche couverture : ces zombies s’attaquant à un détective de pulp ne correspondent à aucune nouvelle de l’anthologie. Quitte à choisir une illustration au hasard, j’en aurai pris une plus jolie. Soit. Plus intéressant sans doute : mais qu’est-ce donc que le McSweeney ? Eh bien, je n’en savais rien avant d’ouvrir ce recueil. McSweeney est en fait une tentative américaine de faire revivre la revue de nouvelles. L’argument éditorial est que l’art de la nouvelle se perd alors même qu’il s’agissait d’un format prisé par nombre de grandes plumes américaine du début du XXème. Chabon, l’éditeur de cette anthologie en particulier, est l’une des chevilles ouvrières de ce renouveau en faisant jouer son carnet d’adresse visiblement bien remplis pour convaincre ses collègues écrivains de se (re-)lancer dans l’exercice. Et comme vous connaissez sans doute mon amour pour le format en question, vous vous doutez que je ne peux qu’applaudir à deux mains (vous avez déjà essayé avec une, juste pour voir ?). Le site web McSweeney, la publication en question, est un vrai trésor d’imagination et on y découvrira une volonté probablement un peu « arty » de remettre la nouvelle (mais aussi d’autres expressions artistiques) sur le devant de la scène. Quand on voit le prix de certains anciens numéros épuisés sur leur boutique en ligne, on imagine aussi facilement que la revue a un certain succès auprès d’un public d’initiés qui dépensent sans compter. Bref, tout ceci nous éloigne du contenu.
Parlons-en, du contenu. Après une brève intro où Chabon nous explique son intention et les échos positifs des écrivains qu’il a su convaincre de participer, on se lancer dans un premier texte : Les abeilles, de Dan Chaon. Inconnu au bataillon. Mais texte très dérangeant. Il y est question d’un homme rangé que les démons du passé viennent menacer. La mécanique du récit, inéluctable, nous entraîne vers une conclusion sordide, horrible, que l’on voit venir et que l’on espère éviter. Le texte est particulièrement dur à lire si vous êtes vous-mêmes parent d’un enfant en bas âge. Je ne croyais pas être touché par le phénomène (le fait d’avoir un petit gamin ne m’empêche pas de voir le premier Ça, par exemple), mais, en fait, si. Cette première nouvelle, qui touche davantage à l’horreur qu’au fantastique, m’a laissé un goût de cendre dans la bouche…
Le deuxième texte, Le Général, de Carol Emshwiller, est plus classique. Il y est question d’un grand soldat qui fuit le pays qui l’a élevé après avoir massacré sa famille. Sa fuite l’amènera à sympathiser avec de pauvres paysans dans les montagnes qui servent de frontière naturelle entre son pays d’origine et son pays d’adoption. La vengeance, la solitude, la haine et la rédemption sont au menu de ce court texte. C’est bien écrit, mais, comme dit en attaque de ce paragraphe : c’est assez classique.
Sinon, le chaos, de Nick Hornby est la troisième nouvelle de l’anthologie et la première appartenant réellement au domaine du fantastique. L’auteur, pas familier avec le genre, est surtout connu pour son excellent High Fidelity. Le texte est une sorte d’hommage à L’Attrape-Cœurs, malgré le fait qu’il insiste explicitement sur le fait de ne pas l’être, justement. On y suit un ado qui nous raconte sa première expérience sexuelle. Ou, plus exactement, les circonstances qui l’on amené à ça. Il y sera question de déménagement, de cours de musique, de relations monoparentales et… de l’apocalypse, bien sûr. Le texte est très bien écrit, dans le style de la confession d’ado chaotique, allant même jusqu’à se payer le luxe d’être un méta-texte (puisqu’il s’auto-commente volontiers). Exercice périlleux, mais amplement réussi.
La quatrième participation est due à Chris Offutt, autre auteur dont le nom ne me disait (et ne me dit toujours) rien du tout. Le Seau de Chuck penche lui aussi du côté de la SF pure et dure. On y suit un écrivain, Offutt lui-même, qui est en panne d’inspiration alors que Michael Chabon lui a demandé un nouvelle pour son anthologie. Il a peur de ne pas y arriver. De ne pas faire mieux que son père, grand écrivain et grand rival d’Harlan Ellison en son temps (qui est également au programme de l’anthologie, par ailleurs). Son mariage bat de l’aile, sa bagnole est cassée et il a l’impression qu’un fantôme le hante dans ses nuits blanches. Heureusement, un ami scientifique le sortira de cette voie sans issue en lui proposant un voyage dans le temps et/ou dans les univers parallèles. Mais… ce n’est pas sans risque, bien sûr. Amusant, construit tel des poupées russes, le texte est efficace a défaut d’être vraiment marquant.
Le cinquième auteur, Michael Moorcock est un nom nettement plus familier à l’oreille du lecteur de SFFF. L’auteur d’Elric signe ici un texte plus tardif, mineur, qui appartient à une autre série de l’écrivain, à savoir Le Pacte Von Beck. Ou, plus certainement, l’une de ses nombreuses incarnations dans les temps multiples que parcourt la figure tutélaire du Champion Éternel, chère à Moorcock. On y suit l’enquête chronique d’un flegmatique britannique et son assistant dans le Berlin des années 30. La maîtresse d’Hitler est retrouvée morte et l’entourage proche du leader nazi fait appel au Sherlock Holmes local pour résoudre l’affaire. Ce-dernier, aidé par son meilleur ennemi Von Beck, sera face à un choix : résoudre l’affaire, innocenter le monstre ou en profiter pour sauver la paix mondiale ? Farce steampunk, L’affaire du canari nazi est un bel hommage à Conan Doyle et/ou à Maurice Leblanc. C’est drôle, bien écrit, bien mené et dans le ton de l’anthologie. Ce n’est pas ce que l’auteur a signé de mieux, mais c’est très efficace.
La Danse des esprits de Sherman Alexie est une nouvelle âpre sur le racisme ordinaire aux États-Unis. Deux flics tuent deux indiens injustement arrêtés. Sur les lieux de la bataille de Little Big Horn. Pas de chances pour les représentants de la loi, cela réveille le 7ème régiment de cavalerie du Général Custers qui est enterré là depuis des siècles. Et ces braves zombies ont faim. Et ils ne font pas la distinction entre les flics rednecks racistes du fin fond des states ou le premier passant venu. Une véritable tornade de massacre où le message semble être : la violence entraîne la violence. Bien mené, mais la conclusion et le message m’échappent un peu.
Le texte suivant est signé par l’autre grand nom de l’anthologie, à savoir Harlan Ellison, dont la carrière est aussi longue qu’inspirante pour tout amateur de littérature de genre (ou de littérature tout court). Avec Derniers adieux, Ellison signe a son tour une farce sur les gens qui cherchent toute leur vie un sens profond aux choses, un message caché qui leur permette d’atteindre le nirvana. Quid si au lieu d’atteindre le Shangri-La sur l’un des sommets inatteignable de la chaîne de l’Himalaya, notre héros tombait sur… un fast-food cosmique ? Je ne sais pas si ce texte date d’avant l’épisode où Homer visite le premier Kwik-e-mart sur un sommet indien, mais on est dans le même genre de délire. Amusant.
L’avant-dernier texte, Notes sous Albertine, est celui qui se rapproche le plus du cyberpunk. C’est le texte le plus long et le plus ardu de l’anthologie. Rick Moody, son auteur, dont il s’agit ici du seul réel texte de SF traduit en français, signe un récit d’une centaine de page sur un journaliste qui essaie de comprendre d’où provient une nouvelle drogue qui ravage la société américaine depuis la disparition d’une grande partie de New-York dans un attentat ravageur (rappelons-le, l’anthologie date de 2002 dans sa version originale). Cette drogue a pour effet de faire revivre au consommateur ses souvenirs. Pas de se les rappeler ; de les revivre. Et les survivants de s’enfermer dans un monde onirique où il semble possible d’interagir dans une certaine mesure avec les évènements, ajoutant tout une couche de paradoxes temporels au marasme sociétal ambiant. Ça m’a fait penser à un croisement étrange entre Inception et Las Vegas Parano, le côté drôle en moins. Sans doute la meilleure nouvelle de l’anthologie, mais pas la plus simple à prendre en main.
Le dernier texte, signé par Michael Chabon lui-même, nous emmène dans la vie de deux gamins qui sont séparés de leurs parents par la guerre civile américaine et qui sont récupérés par leur oncle à bord d’un dirigeable géant qui fleure bon le steampunk. C’est pas mal du tout, mais c’est très frustrant : L’Agent martien, roman d’aventures planétaire est la première partie d’un diptyque qui a trouvé sa suite dans une autre anthologie McSweeney inédite sous nos latitudes. Et l’histoire développée ne se suffisant pas en elle-même, c’est un peu bizarre de l’avoir inclus.
Que penser, pour finir, de cette anthologie ? Eh bien, au risque de me répéter pour ce genre de publication, du bon et du moins bon. Si tous les textes ne sont pas de grands textes, ils ont tous une qualité minimale suffisante pour retenir notre attention. Notes sous Albertine en particulier promet de belles choses pour son auteur (qui est cependant resté relativement anonyme dans nos contrées). Les nouvelles et ce genre d’anthologie restent de bonnes portes d’entrée dans des imaginaires nouveaux, osant parfois des mélanges de genre ou des développements que des romans classiques n’osent pas. McSweeney’s Anthologie d’histoire effroyables (elles ne le sont pas toutes !) est exactement dans cette tradition : une main tendue vers des auteurs méconnus, épaulés par des noms bien établis qui se lâchent (j’imagine que Moorcock a rarement utilisé Hitler comme personnage dans ses récits !). Une belle surprise à découvrir sans modération. Et on regretta de n’avoir qu’une édition partielle avec cette version Folio SF. Si vous trouvez l’édition intégrale, préférez-la !
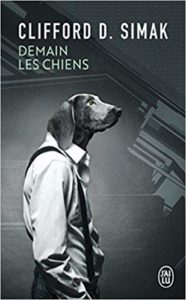 De Clifford D. Simak, 1944-1973.
De Clifford D. Simak, 1944-1973.
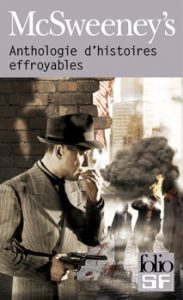 Édité par
Édité par 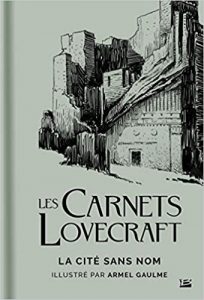 De
De 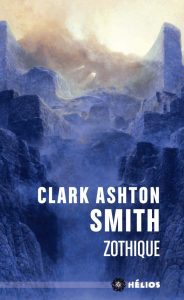 De
De 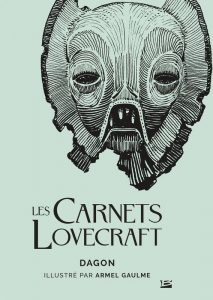 De
De