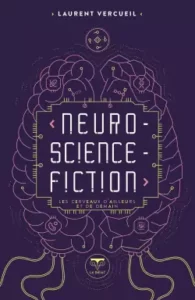 De Laurent Vercueil, 2022.
De Laurent Vercueil, 2022.
Sous-titré : Les cerveaux d’ailleurs et de demain
Un nouveau Parallaxe ? Je prends ! La collection spécialisée dans la rencontre entre sciences et science-fiction du Bélial a déjà nourri cette tribune, avec du bon, du très bon et du moins bon. Difficile de prédire le bilan à la vue de la toujours très élégante couverture de ce septième opus, mais qu’importe. Qu’importe car au-delà du livre en lui-même, l’intention de la collection et des auteurs qui la nourrissent suffit à faire de chacun de ces livres une bulle inespérée d’intelligence, d’érudition et, il faut l’admettre, de fun, dans un monde où accorder une place à la science devient chaque jour plus compliqué.
Prenons donc quelques heures pour explorer ensemble ce grand inconnu qui loge dans notre crâne, tout en haut de notre corps. Le cerveau, lieu de l’âme pour les uns, lieux de tous les possibles pour d’autres. C’est donc avec un médecin, du CHU de Grenoble, apparent spécialiste de l’épilepsie et des autres malaises d’origine neurologique, que nous avec rendez-vous pour être un peu plus intelligent après un peu plus de 250 pages. Intelligent, dites-vous ? Encore faut-il que l’on se mette déjà d’accord sur le concept. Concept sur lequel le Dr. Laurent Vercueil, car c’est de lui qu’il s’agit, a déjà de nombreuses choses à nous enseigner.
Comme pour les autres titres de la collection Parallaxe, l’enjeux du livre est de vulgariser les neurosciences à travers de nombreux exemples issus de classiques de la science-fiction. Des blockbusters aux classiques américains en passant par des noms moins courus de la SF française des 50 dernières années, il est évident que l’auteur a, comme les autres auteurs de la collection, une passion pour la SF, un violon d’Ingres qu’il met ici au profit du lecteur curieux. Cela se ressent dans la construction de son ouvrage. Sa première partie, consacrée au cerveau extra-terrestre, doit sa structure même à la définition de l’intellect martien par H.G. Wells dans son grand classique, La guerre des mondes. Vaste, calme et impitoyable, voilà les trois adjectifs qui seront autant de sous-chapitre qui démontreront par A+B que si les extra-terrestres, martiens façon pulp ou Alien à la Ridley Scott, ont réellement un cerveau caractérisé uniquement par ces trois traits, alors ils seront presque immanquablement moins aptes que l’être humain. Et c’est là que l’on revient à la définition de l’intelligence. Si celle-ci n’est que le reflet d’une réussite technologique, alors nous sommes sans doute en retard. L’auteur de s’amuser du fait que le paradoxe de Fermi qui semble nous condamner à être seul dans l’univers est en fait dû à la longueur exceptionnelle de la domination des dinosaures sur notre petite planète bleue, règle qui nous aura en effet couter quelques millions d’années d’évolution perdue…
La seconde partie de l’essai, intitulée « Que faire de son cerveau ? » envisage diverses hypothèses fréquemment rencontrées dans des œuvres de SF et tente d’argumenter ou de contre-argumenter pour atteindre une sorte de vérité scientifique. Y passeront l’extension des capacités de notre cerveau, l’abolition ou l’exploitation du sommeil ou encore l’exploration des rêves et la télékinésie. Le Dr. Verceuil, en plus de placer justement ses hypothèses à partir de classiques de la SF, en profite pour jouer les hoax-busters et tue quelques légendes urbaines. Non, nous n’utilisons pas que 10% de notre cerveau : ce sont juste nos actions provoquées par le conscient (et mesurées par des IRM ou des PETscan) qui utilisent 10% de notre masse cérébrale. Les 90% restant sont également utilisés, mais de manière moins glorieuse : ils sont mobilisés pour faire tourner la machinerie, il est vrai assez complexe, de notre corps. Autre exemple : non, notre temps de rêve ne se limite pas aux dernières secondes qui précèdent notre réveil ou aux quelques secondes qui suivent notre endormissement. Nous rêvons bien toute la nuit, à des fréquences et des durées variables, cependant. De là à savoir précisément comment nos rêves fonctionnent et si l’on peut réellement les utiliser pour FAIRE quelque chose, c’est une autre paire de manches…
Bref, Neuro-Science-Fiction est une pierre de plus dans l’édifice d’une collection brillante de la part du Bélial. Sans tomber dans les excès un peu pesant de Landragin dans son Comment parle un robot ? il y a cependant quelques passages plus ardus dans cet opus-ci également. Passage obligé dans ce type d’essai, l’auteur nous donne en accéléré un bagage théorique et techniques qui nous permet de deviner l’assise scientifique de son propos. Ces passages, forcément moins illustrés par des exemples de fiction, peuvent faire sortir le lecteur peu attentif de sa lecture. Pourtant, même si les concepts sont parfois complexes et le vocabulaire hermétique, le Dr. Vercueil s’évertue à rendre sa démonstration compréhensible. Même si le principe biologique reste incompris dans son détail, il est assez aisé de saisir la démonstration et on ne perd donc pas le fil du chapitre en question. Bien sûr, je ne garantis pas que je retiendrais 100% de ce qui est démontrer dans le bouquin, mais il est clair que c’est une porte d’entrée ludique, intelligemment référencée, dans le domaine assez obscur des neurosciences. Un grand bravo pour cet ouvrage qui m’aura tant donné l’envie de découvrir davantage le fonctionnement de notre cerveau que de me replonger dans certaines références de la SF avec un regard neuf.

 De
De  De
De 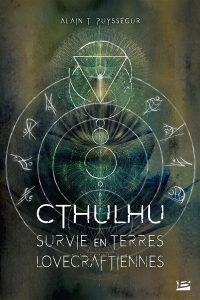 D’
D’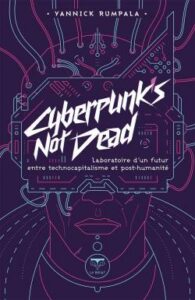 Sous-titré : Laboratoire d’un futur entre technocapitalisme et posthumanité
Sous-titré : Laboratoire d’un futur entre technocapitalisme et posthumanité