 De Roland Lehoucq & Jean-Sébastien Steyer, 2018.
De Roland Lehoucq & Jean-Sébastien Steyer, 2018.
Le premier volume de la collection Parallaxe m’avait, pour une raison x ou y, échappé il y a quelques années lors de sa parution originale. Pourtant, le programme est alléchant : des scientifiques qui s’attaquent à la représentation de la science-fiction au cinéma. Considérant que je regarde majoritairement des films de SF ou des films fantastique et que le principe même du « mythbuster« , popularisé par le programme télé de Discovery Channel du même nom, me séduit, le livre était fait pour moi. C’est d’autant plus agréable de constater que Lehoucq et Steyer, malgré leurs cursus universitaires impressionnants, ne se prennent pas au sérieux. Ils manient en effet avec brio l’humour pour porter leur propos.
En résumé, la mécanique du bouquin est assez simple à saisir : les auteurs analysent scientifiquement la véracité/crédibilité de ce que l’on nous montre à l’écran dans quelques grands films de science-fiction des 30 dernières années. Et, évidemment, ça coince à tous les étages. Je ne vais pas faire l’exercice de citer l’ensemble des films qui passent au gril, mais pour donner une idée du contenu, je ne peux m’empêcher de donner deux exemples qui m’ont frappé particulièrement (attention, ça va forcément spoiler !). Le premier concerne le Gravity de Cuaron. Le film, qui se veut réaliste, mésestime un élément important auquel je n’avais jamais réfléchi : il est impossible que les débris du satellite qui viennent frapper la station au début du film reviennent la frapper une seconde fois, en fait. Simplement parce que l’orbite des débris n’est pas stable et que ceux-ci s’éloigneront invariablement de l’orbite de la station, de l’ordre de quelques degrés (ce qui donne tout de suite quelques kilomètres de différences, hein) soit vers la Terre, soit vers l’espace. Du coup, le compte à rebours auquel Clooney et Bullock font face n’est simplement pas réaliste.
Deuxième exemple, toujours dans un film qui se veut réaliste (jusqu’à un certain point) : le trou noir de l’Interstellar de Nolan. Malgré le fait que le réalisateur se soit adjoint les services d’un spécialiste mondialement reconnu en la matière, la liste des incohérences et des imprécisions (dans la représentation graphique comme dans les effets du trou noir sur les objets stellaires qui l’entourent, humains compris) est en fait trop longue pour être détaillée. Et ce ne sont que deux exemples parmi les dizaines de films qui sont passés au crible par nos deux compères. Citons entre autres Prometheus, Seul sur Mars, Godzilla, The Thing ou encore Ant-man et Pacific Rim. Il y a là des problèmes que l’on connait ‘instinctivement‘ (non, un être biologique de la taille de Godzilla ou d’un kaiju ne peut en fait pas vivre sur Terre ; l’apesanteur et la pression atmosphérique leur rendraient tous mouvements simplement mortels, sans parler de l’impossibilité de leur régime alimentaire ! Et, dans le même registre, la quantité d’énergie, même nucléaire, qui serait nécessaire à faire fonctionner des robots géants de la taille de ceux de Pacific Rim est tellement ridiculement élevé qu’il serait tout bonnement impossible de les faire bouger !) et d’autres que l’on ne soupçonne pas si l’on ne se pose pas deux minutes pour y réfléchir (Interstellar, donc, mais aussi l’anthropomorphisme désespérant dont l’écrasante majorité des représentations d’aliens, qui ne colle pourtant pas avec le développement de vie intelligente ‘alternative‘).
Et Lehoucq et Steyer de nous faire remarquer tout cela avec un amour certain pour le matériau de base. Si leur but est réellement de réfléchir « comme des scientifiques« , ils n’en demeurent pas moins des spectateurs qui sont conscient qu’il existe quelque chose appelé la suspension de l’incrédulité lorsqu’on se prend un paquet de pop-corn dans une salle obscure. Si leurs démonstrations cassent un peu la magie de certains films, ils sont aussi bien conscient qu’un film comme Pacific Rim n’entends aucunement être réaliste et que ce n’est donc pas son propos. Mais quel petit garçon (ou petite fille, soyons inclusif !) ne s’est jamais rêvé à la tête d’un robot géant pour défendre l’humanité contre des extra-terrestres démoniaques arrivés d’une autre dimension ! Simplement, Lehoucq et Steyer nous disent que le robot géant ressemblera plus probablement à un tank (ou à des petits drones, c’est encore plus efficace) et que ces monstres géants, s’ils ont cette taille, feraient mieux de rester dans l’eau (et, si possible, pas dans la fosse des Mariannes, comme Pacific Rim nous le fait croire, car ils imploseraient tout simplement sous l’effet de la pression sous-marine… :-))
Lehoucq et Steyer sont aussi des amateurs de cinéma et, à ce titre, n’hésitent pas à tacler les films qu’ils apprécient moins, pour utiliser un euphémisme. La grande victime de leur bouquin n’est autre que Prometheus, dont ils critiquent à peu près tout, de la réalisation, au design en passant par le scénario et le jeu des acteurs. On sent bien qu’Alien fut un film important pour eux dans la construction de leur passion pour le cinéma et la science et qu’ils ont assez mal vécu l’élucubration délirante d’un Ridley Scott sur le retour (bien que d’autres critiques crient au génie devant Prometheus, qui m’a personnellement laissé franchement indifférent, tout comme sa suite). Mais ces écarts plus critiques ne sont pas légions. Lehoucq et Steyer restent la plupart du temps sur leur cahier de charge : débusquer ce qui est vrai, ce qui est approximatif et ce qui est totalement à côté de la plaque scientifiquement parlant dans les blockbusters de SF récents et moins récents. Et, comme vous l’aurez compris : ça marche. C’est ludique, intéressant, documenté sans prétendre à la thèse de doctorat. Moins magistral que les autres bouquins de la collection, ce premier Parallaxe ouvrait, il y a trois ans déjà, la voie à une collection qui parlent aux amateurs de la littérature (et du cinéma) de genre et qui a pour ambition de les (nous ?) rendre plus intelligents. Je cautionne à 100% !

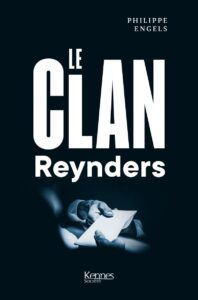 De
De 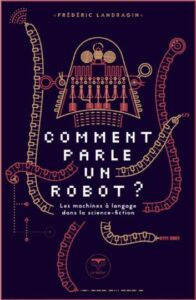 Sous-titré : Les machines à langage dans la science-fiction
Sous-titré : Les machines à langage dans la science-fiction De
De 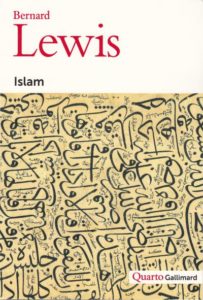 De
De