 D’Anne Besson, 2007.
D’Anne Besson, 2007.
Pour tous lecteurs de fantasy, Anne Besson est depuis près de vingt ans maintenant un nom incontournable. Elle fut l’une des premières universitaires françaises, officiant bien sûr dans une fac de lettres, à consacrer une large majorité de ses travaux à la fantasy. Aidée en cela par les maisons d’édition spécialisées (Bragelonne en premier, dont on retrouve ici le côté passionné, puisque publié des textes et autres actes de colloque de type universitaire n’est certainement pas une opération financièrement viable, mais aussi Vendémiaire pour sa référence, le Dictionnaire de la Fantasy), elle a contribué avec brio a faire de ce genre particulier un objet d’étude au même titre que les autres littératures.
Comprenez-moi bien : je ne suis pas un militant qui a voué sa vie à promouvoir la littérature de genre ou à considérer que celles-ci (car elles sont multiples) valent mieux que les autres courants littéraires. Mais j’aime simplement lire des essais et je suis toujours heureux d’en apprendre plus sur mes propres passions. Et c’est exactement ce que permet de faire ce brillant texte de l’universitaire artoise. Publié ici dans une collection dite des « 50 questions« , elle rédige long essai organisé selon, de fait, un découpage en 50 questions qu’elle estime essentielle pour aborder et développer le genre.
Une grande partie des premières questions est liée à la définition même du genre et à la différence des frontières d’icelui entre le monde anglo-saxon et la francophonie. Après ces longs prolégomènes épistémologiques, l’essai aborde finalement les caractéristiques fondamentales du genre et s’interroge sur ses grands auteurs, ses grands traits et sa pérennité. Au-delà des inévitables encarts sur Tolkien et Howard, Besson aborde également les précurseurs (C.S. Lewis, Mervin Peake, William Morris ou encore Lord Dunsany). Elle aborde également les développements plus tardifs du genre dans le domaine du jeu (de plateau, de carte, vidéo, en lige, etc.) et au cinéma (d’abord Conan puis, bien sûr, l’inévitable Seigneur des Anneaux, entrecoupé d’une décennie magique où l’on trouvait Excalibur, Legend, Willow et d’autres titres qui ont moins bien survécut au temps).
Et Besson de se poser la question (et d’apporter quelques éléments de réponses, bien sûr) sur l’incroyable succès éditorial de ce genre qui, à l’orée des années 2000/2010 semblait devoir remplacer la SF dans le paysage déjà saturé de la littérature de genre. Elle concluait en disant que le genre, par ses traits, ses thématiques et ses développements, semblait être là pour durer. Sa thèse, en effet, est que la fantasy n’est que le développement syncrétique du roman d’aventure, intégrant cependant une dimension du merveilleux qui est bien plus ancienne. Et si elle regarde d’un œil parfois navré les sous-genres qu’elle considère plus comme des modes passagères que de véritables avancées (l’urban fantasy, la detective fantasy, la bit-lit, etc.), elle estime que la vigueur du genre et sa prédominance réponde non seulement à un phénomène de société créé par l’engouement autour de l’adaptation ciné du SdA et de la saga Harry Potter, mais également à un besoin plus profond de la société moderne d’un « retour aux sources« , d’un « retour en enfance » qui n’est pourtant pas synonyme de replis sur soi ou d’infantilisation.
Force est de constater, plus de dix ans plus tard, que la fantasy est toujours bien là. Et qu’elle s’est effectivement développée dans une pléiade de sous-genre qui semble eux-aussi être là pour durer. La bit-lit a remplacé le roman à l’eau de rose pour nombre de jeunes femmes. La Dark Fantasy a remplacé les collections horreur pour nombre de lecteurs (adieu les tranches noires, bonjour les tranches argentées ou brunes de la fantasy). Même le steam-punk semble se créer une identité propre, dans la droite filiation des uchronies qui ne datent pas d’hier. Et ne parlons pas des dystopies (elles aussi, beaucoup plus vieilles qu’il n’y parait) qui inondent nos petits et nos grands écrans.
Le texte n’est pas prophétique pour autant et Anne Besson n’est pas un pythie des temps modernes. Elle nous offre simplement un regard d’une acuité rare sur un genre encore en plein développement. Du haut de sa courte histoire de quelques décennies, la fantasy comme genre littéraire commercial nous a déjà apporté de belles choses. Et un immense océan de titres médiocres et répétitifs, faut-il le rappeler. Il ne s’agit pourtant pas là d’une particularité relative du genre : tous les styles et genres produisent une majorité de titres commerciaux, sans intérêt, tablant vaguement sur une répétition d’une formule à succès. Il en va, pour la fantasy, simplement de même. Et c’est sans doute plus visible que dans d’autres genres (le lecteur habitué de mangas ne sera cependant pas perdu : il n’y a rien qui ressemble plus à un shônen qu’un autre shônen ! Et la big-selling-fantasy ne fonctionne pas différemment. Sous des autours différents, L’Epée de Vérité est en fait la même chose que La Roue du Temps ou que Shanara : des imitations plus ou moins heureuses du SdA).
Besson ajoute à cette analyse à l’emporte-pièce une caution universitaire et toute une série de références bien utiles et savantes aux étudiants en lettres qui se lanceraient dans le domaine. Le texte est érudit, agréable à lire sans être passionnant comme peuvent l’être certains historiens. Un néophyte sera rapidement perdu mais un assidu du genre y découvrira des réflexions intéressantes et des pistes à explorer. La forme des 50 questions imposent bien sûr quelques questions tartes à la crème, mais, dans l’ensemble, l’essai est vraiment intelligent en restant intelligible. Une bonne référence pour tout ceux que la réflexion critique autours de l’une de leur passion intéresse.

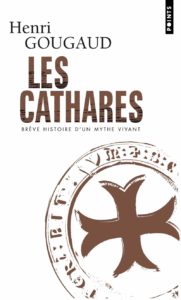 Sous-titré : Brève histoire d’un mythe vivant
Sous-titré : Brève histoire d’un mythe vivant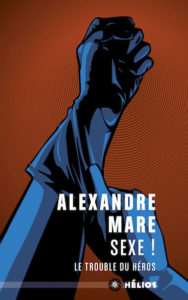 Sous-titré : Le trouble du héros
Sous-titré : Le trouble du héros Sous-titré : ville, science-fiction et sciences sociales
Sous-titré : ville, science-fiction et sciences sociales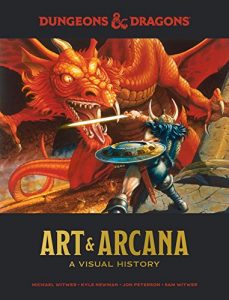 Sous-titré : A Visual History
Sous-titré : A Visual History