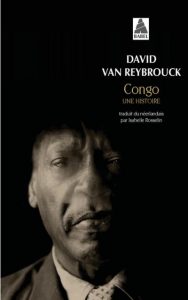 De David Van Reybrouck, 2010.
De David Van Reybrouck, 2010.
Repéré il y a déjà plusieurs années, je me suis décidé il y a une grosse semaine à me lancer dans cette somme consacrée au Congé, signée par l’historien et dramaturge flamand, David Van Reybrouck. Son court essai Contre les élections, au-delà de son titre un poil racoleur, m’avait beaucoup amusé en plus de poser un certain nombre de questions et de proposer certaines réponses utiles et intéressantes dans un contexte de crise de la démocratie participative. Mais Contre les élections est un pamphlet, en comparaison de cette bonne petite brique qu’est Congo. Une histoire.
Publié chez Acte Sud en français deux ans après sa parution originale aux Pays-Bas, je commente ici la version poche de l’ouvrage, issu de la collection Babel d’Acte Sud.
Je ne sais pas s’il faut parler d’œuvre, d’essai ou, probablement plus justement, de fresque. Van Reybrouck s’évertue, au fil de ces 700 et quelques pages, de nous dresser un tableau vivant de ce monstre tentaculaire que fut, qu’est et que sera sans doute le Congo (colonial ou indépendant), le Zaïre ou la RDC. Ce qui n’est pas réellement un pays, Van Reybrouck choisi de le décrire par le témoignage de ses habitants et de ses acteurs anonyme. Il choisit, contrairement à d’autres historiens plus classiques, de privilégier les sources directes aux citations d’ouvrages multiples. Cet attrait pour l’histoire vivante, répétée de nombreuses fois par l’auteur au fil des pages, ne s’épargne cependant pas un travail d’historien sérieux, documenté et universitaire. Les références bibliographies, commentées pour certaines, occupent à elles-seules les 200 dernières pages du volume, ce qui nous épargne des notes en bas de page kilométriques mais nous impose une gymnastique des mains si l’on veut les compulser.
Mon ambition n’étant pas de faire une lecture scientifique, je ne les ai cependant que très sporadiquement vérifié, mes laissant porter par le style de l’auteur. Car Van Reybrouck fait partie des conteurs davantage que des universitaires purs jus. Il explique d’ailleurs ses sources qu’il n’aurait pu réaliser ce livre dans une contexte universitaire classique et qu’il remercie les sources de financement alternatives qu’il a pu trouver pour rendre ce voyage possible. Car c’est réellement un voyage : à travers Congo. Une histoire, on parcourt réellement le roman d’un pays et de son peuple, pour autant qu’on puisse limiter cet immense territoire, artificiellement réuni par quelques messieurs en jaquette à la fin du XIXème, à un peuple unique.
Et Van Reybrouck de débuter dans son introduction bien avant les débuts de la colonisation en nous dressant un portrait rapide de ce qu’est le Congo, en tant que territoire géographique et ce que fut le Congo, à l’époque où ce dernier n’était qu’une vaste tâche blanche au cœur des cartes rudimentaires détaillant les postes espagnols, portugais et anglais qui émaillaient les côtes africaines. Mais, bien vite, fidèle en cela à sa volonté de construire son livre sur les témoignages d’anonyme acteurs de l’histoire, il enchaîne sur l’ère coloniale, d’abord lorsque le Congo fut propriété privée du Roi, puis lorsqu’il devint, une bonne centaine de pages après, une colonie belge à proprement parlé.
Cette première période est émaillée en fil rouge du témoignage d’un très vieux congolais que Van Reybrouck aurait interrogé. Un homme de plus de 120 ans qui aurait connu dans son enfance le boy de Stanley. Évidemment, si cela peut laisser le lecteur dubitatif, on imaginera aisément qu’il s’agit plutôt d’un homme de 90 ans (ce qui est déjà un très grand exploit, lorsque l’on connait l’espérance de vie masculine en RDC !) qui s’est approprié, au fil des décennies, les souvenirs de son père ou de son grand-père et qui les raconte comme s’il les avait vécu lui-même. Si la récente réouverture de l’Africamuseum à Tervuren a justement posé la question de la nécessité d’éduquer les jeunes belges sur ce que fut le temps des colonies (justement car je n’ai moi-même pas souvenir que l’on m’ait enseigné cela à l’école, alors même que je ne suis pas si vieux que cela), la lecture des premiers chapitres de Congo. Une histoire pourraient très bien être inscrit au programme des écoles secondaires. On y (re)découvre l’ambivalence de cette période d’exploitation commerciale outrancière, avec ses mythes, ses fulgurances et son horreur.
Moins unilatéralement sombre que Le rêve du Celte, de Mario Vargas Llosa (autre excellent bouquin, roman en l’occurrence, qui met en lumière les méfaits de cette période troublée), ces quelques chapitre mettent surtout en lumière l’amateurisme total te la naïveté avec laquelle quelques « civilisateurs » partirent dans une croisade lucrative sous les tropiques en se drapant dans une pseudo-dignité démocratique et religieuse (deux termes, on le sait, qui ne font pas toujours bon ménage). Et ces chapitres cadrent surtout l’origine de tous les maux que connaîtra cette vaste étendue de terres disparates, ce creuset d’une multitude de peuples aux coutumes, vies et habitudes différentes qui allaient devenir quelques décennies plus tard la nation congolaise.
Je vous épargne un résumé détaillé des chapitres suivants pour éviter d’à mon tour écrire un roman, mais sachez que Van Reybrouck enchaîne évidemment avec la période de décolonisation, puis avec l’indépendance abrupte, les troubles qui l’ont suivi, le putsch de Mobutu, son règne interminable qui ne fit rien pour redresser le pays (au contraire : malgré l’image que certains ont aujourd’hui d’un « temps béni » où le Zaïre marchait sous la dictature, Van Reybrouck démontre bien dans son propos que les choix catastrophiques, le manque de sens politique, l’amateurisme et la corruption galopante dès les premiers jours du régime n’ont fait qu’enfoncer davantage le pays dans la misère qu’il connait encore aujourd’hui). Et de poursuivre son œuvre par la fin de règne de Mobutu, son départ précipité face à Kabila et le règne de ce-dernier jusqu’à son assassinat et l’installation de son fils dans le contexte des pages probablement les plus dures à lire de tout le livre, consacrée au génocide rwandais et à ses multiples itérations et résurgences dans les années qui suivirent.
L’essai se conclut sur la nouvelle influence chinoise et cette nouvelle forme de colonisation économique (que j’ai pu voir effectivement dans les rues de Kinshasa, il y a déjà une dizaine d’année maintenant) avec un espoir de redressement à travers une mondialisation où les congolais pourraient avoir un rôle plus actif dans les échanges, de matières premières essentiellement, qu’on leur impose depuis maintenant 150 ans. Manque bien sûr le dernier acte, tout récent, avec ce qui semble être une ouverture timide dans le régime familial des Kabila père et fils avec l’élection toute fraîche du fils Tshisekédi comme Président de la RDC (avec une majorité parlementaire issue des rangs du régime de Kabila, cependant).
De cet essai magistral, il est difficile de retenir toutes les parties, toutes les subtilités, toutes les informations qui peuvent par moment noyer le lecteur. Pour être honnête, je m’y suis un peu perdu lorsque l’auteur détaille par le menu les luttes entre les différents groupuscules armés qui occupaient l’Est du pays à la fin des années 90 et au début des années 2000, leurs allégeances changeant encore plus vite que leur nom.
Mais l’important n’est pas là. Van Reybrouck essaie, à mon sens, de nous dresser le portrait fataliste et pourtant plein d’espoir d’une hydre que l’on appela Congo. A travers la vie de ses témoins et les choix de chapitres qui alternent le grave et le léger (après le génocide rwandais, Van Reybrouck consacre par exemple de nombreuses pages à la pop congolaise et son affiliation aux marques de bières, par exemple), l’auteur nous retrace en effet une histoire. Et il est très agréable de se laisser porter par sa plume, d’époque en époque, d’épisode en épisode, d’anecdote en anecdote. Si d’autres lecteurs regrettent ce parti-pris en ce qu’il impose des répétitions inévitables sans apporter un fondement scientifiques plus grand, c’est pourtant ce qui en fait, à mes yeux, une lecture importante. Parvenir à nous intéresser pendant 700 pages à l’évolution d’un pays sans tomber dans un didactisme érudit est un véritable tour de force. Bien que je ne sois pas allergique aux textes à portée plus scientifique en histoire, il est évident qu’il est plus agréable de lire un bouquin qui propose un choix stylistique agréable qu’un autre. Et Congo. Une histoire réussit ce tour de force : il nous accroche à la trame de ce territoire que d’autres ont voulu être un pays, de ces gens que d’autres ont voulu être un peuple.
Si je ne suis pas aussi dithyrambique que l’inévitable Colette Braeckman (passage obligé en Belgique si l’on veut parler de l’Afrique centrale en ayant l’air intelligent), je dois cependant me plier face à cette étonnante et imprévisible réussite : David Van Reybrouck a signé un best-seller (à son échelle, dans la catégorie essai) qui mérite amplement à mes yeux sa réputation. Il rend un sujet passablement déprimant, quand on y pense (le livre aurait pu s’appeler « Congo, où l’histoire d’un gigantesque concours de circonstance malheureux » ou « Congo. C’est pas de bol« ), tout à fait passionnant. Et rien que pour cela, on lui pardonnera volontiers ses inévitables répétitions et ses ruptures de rythme parfois fort visibles (notamment dans les parties où les témoignages oraux se multiplient et où il devient dur de savoir ce qui relève du témoignage ou du commentaire de l’auteur). Un grand livre, assurément, qui ne juge que sporadiquement et laisse le lecteur tirer ses propres conclusions.

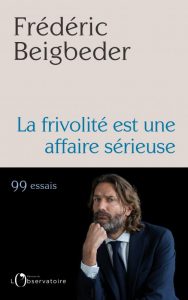 Comment ? Deux Beigbeder dans la même année ? Luxe ultime ! Et… non. Bien essayé. La frivolité est une affaire sérieuse, titre soufflé par l’éditrice de Beigbeder, n’est pas le deuxième texte de fiction de son auteur pour cette année, après l’amusant Une vie sans fin,
Comment ? Deux Beigbeder dans la même année ? Luxe ultime ! Et… non. Bien essayé. La frivolité est une affaire sérieuse, titre soufflé par l’éditrice de Beigbeder, n’est pas le deuxième texte de fiction de son auteur pour cette année, après l’amusant Une vie sans fin, 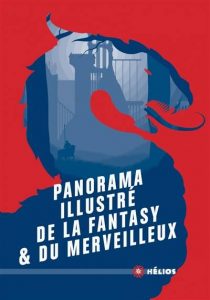 Édité par
Édité par 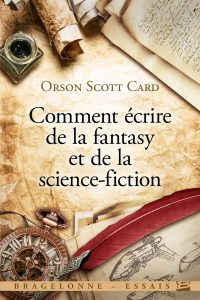 D’
D’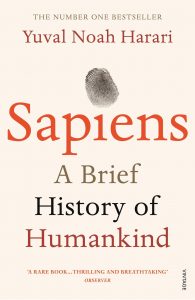 De
De