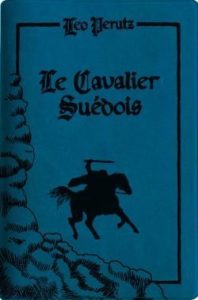 De Leo Perutz, 1936.
De Leo Perutz, 1936.
Roman d’aventure picaresque dans la filiation directe des récits de Hugo ou de Dumas, Le Cavalier suédois aurait pu être écrit un siècle plus tôt. Pourtant, rédigé à l’origine en Allemand par l’écrivain autrichien Léo Perutz, il est bien sorti dans les années 30 du siècle passé, après la 1ère guerre mondiale. Et si je parle de ceci, ce n’est pas par hasard : le fantôme du conflit, meurtrier, inhumain, et inutile, hante le texte sans jamais être explicitement montré. Bien sûr, il ne s’agit nullement du premier conflit mondial dont il est question ici, mais bien des ambitions belliqueuses du Roi de Suède au début du XVIIIe siècle.
Le roman s’ouvre sur la fuite éperdue d’un nobliau suédois, déserteur, sur le territoire frontalier entre la Pologne et l’Allemagne (alors Empire austro-hongrois, bien sûr) et de son compagnon d’infortune, un voleur répondant au seul sobriquet de Piège-à-Poules. À la suite d’un concours de circonstances rocambolesque, le voleur aura l’occasion d’usurper l’identité du lâche suédois pour s’installer sur les terres qui lui étaient dues et marier sa promise. Non par roublardise, mais bien par amour et parce qu’il est convaincu que le déserteur ne sera à la hauteur des attentes de la jeune femme et qu’il ne saura redresser son domaine, spoiler par un parrain concupiscent et par des serfs bien peu regardant.
Le Cavalier suédois est une donc une ode à l’amour véritable, au respect de la terre et à la valeur de l’effort et du travail. Ce qui sonne là comme très conservateur est totalement contrebalancer par la charge virulente du roman contre la folie des hommes, l’armée et la religion. Ironiquement, c’est grâce à la violence que le voleur pourra mener une vie vertueuse et à cause de ses ambitions martiales que le véritable cavalier suédois sera voué aux gémonies. Le Cavalier suédois est également un roman d’aventure où les péripéties et la tension s’enchaînent pour conserver toujours égal l’intérêt de son lecteur. Il est en cela plus moderne que ces illustres modèles (Hugo, Balzac, Zola, etc.), tout en conservant le sel et le charme d’une écriture érudite, complexe et pourtant parfaitement lisible.
Considéré dans les biographies officielles de Perutz comme un œuvre relativement mineure, Le Cavalier suédois est également décrit, par des amateurs éclairés, comme un véritable trésor caché de sa bibliographie. C’est le premier livre de Perutz qu’il m’est donné de lire et je ne pourrais donc juger de la qualité de sa production dans son ensemble, mais il est clair que Le Cavalier suédois est un roman de qualité, maîtrisé dans forme, complexe dans son fond et passionnant de la première à la dernière page. Libretto ne s’est pas trompé quand il a réédité dans une édition spéciale ce roman à l’occasion de leurs dix ans : non content d’être l’un de leur best-seller, c’est également une formidable épopée historique, l’un de ses romans qui sait jouer sur nos sentiments tout en nous faisant réfléchir. Les clés de lecture multiples qui permettent d’apprécier l’œuvre dans sa fausse simplicité ne se livrent pas directement : il faut prendre le temps de reposer le livre sur sa table de nuit et se laisser porter par ses pensées pour saisir la véritable ampleur du Cavalier suédois.
Car au-delà de l’épisode anecdotique de ce voleur au grand cœur et au sens moral atypique, le roman est aussi une œuvre sur l’homme dans ce qu’il a de complexe. Notre héros n’est sans doute pas un homme bon. Et c’est pourtant le meilleur des hommes que nous croiserons dans ces pages. Et c’est aussi un bon père et un bon mari. Le Cavalier suédois n’a rien à envier au destin d’un Jean Valjean ou d’un Comte de Monte-Cristo : c’est un personnage multiple, profond, inquiet et parfois inquiétant que l’on se surprend à aimer. Nous sommes ici dans le domaine de la grande littérature. Perutz ne bénéficie sans doute pas de l’illustre reconnaissance de ses modèles, mais il n’a rien à leur envier en tant que pair. Je ne peux que vous invitez à le découvrir de toute urgence.

 De
De  De
De  De
De  De
De