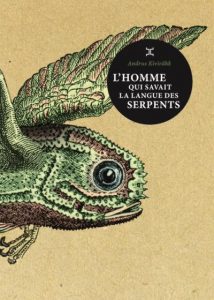 D’Andrus Kivirähk, 2007.
D’Andrus Kivirähk, 2007.
Voilà un article qui promet d’être assez long. Je vous jure que je vais essayer de me contenir, mais ce ne sera pas simple, tant L’homme qui savait la langue des serpents est un livre atypique et riche en niveaux de lecture. Grand succès de librairie en Estonie en 2007, les éditions Le Tripode furent bien inspirées d’en proposer une traduction française voilà quelques années. Sans être un succès commercial en francophonie (Le Tripode n’étant pas réellement une maison ayant pignon sur rue), sa sortie fut pourtant accompagnée d’un accueil favorable de la presse, tant généraliste que spécialisée. C’est sans doute la première particularité de L’homme qui […] : est-ce un conte philosophique ? un roman fantastique ? un pamphlet politique ? Probablement aucun et tous en même temps.
Andrus Kivirähk n’en est pas à son coup d’essai quand il signe L’homme qui […] en 2007. Cela fait, à ce moment-là, déjà dix ans qu’il officie comme romancier et dramaturge, après une carrière dans le journalisme comme chronique aussi acerbe que drôle. Devenu en 2004 l’auteur estonien moderne le plus lu avec Les Groseilles de Novembre (publié là aussi chez Le Tripode en 2014), il récidive trois ans plus tard avec le livre qui nous occupe aujourd’hui. Son œuvre est assez méconnue en francophonie, mais la sortie de L’homme qui […] en 2013 est saluée tant par le toujours très critique Monde des livres que par le beaucoup plus spécialisé Elbakin.net. Le livre ira même jusqu’à gagner en 2014 le Grand prix de l’imaginaire, catégorie roman étranger. Ce qui aura tendance à le classé comme roman fantastique par la suite, alors qu’il est également autre chose, comme je le laissais entendre dans le premier paragraphe. Le roman, comme l’auteur, sont malheureusement restés relativement confidentiels suite aux succès d’estime des trois traductions publiées chez Le Tripode.
Mais de quoi cela parle, finalement, me demanderez-vous. A nouveau, il faut faire une réponse complexe : c’est aussi simple que difficile à saisir. Je m’essaie cependant à l’exercice. L’homme qui savait la langue des serpents débute sur le monologue d’un homme, vivant reclus dans les bois estoniens, qui se plaint d’être le dernier à savoir la langue de serpents. Et qui se prend d’envie de raconter son histoire. Aux animaux qui l’écoute, aux feuilles qui tombent dans la forêt, à l’eau qui coule des cascades, à défaut d’interlocuteur humain. Cet homme s’appelle Leemet et il entreprend donc de nous conter son histoire. Il est né dans une famille qui vit dans la forêt, vêtue de peaux de bêtes et se nourrissant presque exclusivement de viande. Son père est mort quelques années plus tôt, décapité par l’ours qui fut l’amant de sa mère. Sa mère, elle, qui ne s’est pas remise de ce drame, surcompense en passant son temps à cuisiner des cerfs entiers à son fils et à sa fille, pratiquement les derniers enfants des bois à qui l’on apprend la langue des serpents. Cette langue permet non seulement de dialoguer avec les vipères vivant dans les bois, l’autre grande race intelligente de ce microcosme fantasmagorique, mais elle permet surtout de commander à toutes les bêtes sauvages vivant à proximité, des louves que l’on trait pour leur lait aux cerfs qui se livrent tels des agneaux sacrificiels pour servir de nourriture aux humains.
Tout irait très bien si, parallèlement, la modernité n’était pas en train de rattraper cette Estonie médiévale. Leemet est en effet né à la frontière de deux époques, de deux mondes. L’Estonie mythique, puisant sa force et sa connaissance dans la nature magnifiée et l’Estonie arriérée d’autre part, fascinée par ces envahisseurs teutoniques et ces missionnaires chrétiens qui entendent les civiliser en leur faisant raser la forêt pour mieux cultiver la terre. Les habitants de la forêt, les propres voisins de Leemet, quittent toujours plus nombreux le confort des bois pour s’installer au village et découvrir la civilisation, ses certitudes, ses nouveaux dogmes, son dur labeur et, bien sûr, la supériorité des maîtres étrangers. Pourtant Leemet et sa famille n’ont aucune envie de changer de mode de vie. Ils sont heureux de vivre comme ils ont toujours vécus, même s’ils savent qu’ils finiront seuls car ils ne peuvent s’opposer à la marche du monde. Et les évènements rattraperont bientôt Leemet, évènements qui le forceront à prendre position, à se confronter avec une autre époque.
Vous l’aurez compris, L’homme qui savait la langue des serpents est un roman sur le choc des civilisations et sur l’inéluctabilité du changement. Et c’est la là où Kivirähk a l’intelligence de dépasser la parabole passéiste, la fable fantastique moralisatrice. D’autres auraient versés dans une forme de nostalgie qui est parfois le terreau fertile du nationalisme. Pas Kirivähk. Bien sûr, les estoniens qui obéissent aux sirènes du modernisme sont brocardés comme des ignares impressionnables. Mais les habitants de cette forêt mythologique ne sont pas mieux lotis. Leurs coutumes et croyances sont tout autant brocardées et tournées en ridicule. Car la nostalgie d’un passé résolu chez les proches de Leemet est tout aussi artificiel que l’amour aveugle de la nouveauté chez les nouveaux villageois : ils vivent dans un temps qui n’existent déjà plus, si tant est qu’il a existé un jour. Leemet rencontre ainsi deux vieux « anthropopithèques » dans bois, créatures sans âges qui semblent être le chaînon manquant entre l’homme et ses proches ancêtres biologiques. Ceux-ci, bien qu’amicaux, ne peuvent s’empêcher de se moquer à leur tour de l’extrême modernisme de Leemet (il porte des vêtements, imaginez !) ou de l’abâtardissement de l’idiome vipérin qu’il pratique (la langue des serpents que eux maîtrisent est bien sûr plus pure et plus juste). Et Kivirähk a l’astuce de se moquer de ces ancêtres à leur tour, leur prêtant des obsessions idiotes dans leur recherche d’un « état de nature » aussi inaccessible qu’irréaliste.
C’est l’autre message fort de Kivirähk : l’homme n’est jamais bon. Si les chevaliers teutoniques et les missionnaires chrétiens sont invariablement présentés comme des profiteurs concupiscents, il est notable que Leemet et sa famille, loin des fables écologiques présentant un ancêtre en symbiose avec la nature qui l’entoure, sont d’incroyables profiteurs qui n’ont que pour ambition de soumettre la nature qui les entoure. Seul leur petit nombre leur permet d’entretenir un style de vie qui, autrement, détruirait l’écosystème en quelques générations. Ils soumettent les animaux qui les entoure, ont un régime exclusivement composé de viande et se plaisent à dominer toutes les autres espères intelligentes (à l’exception notable du serpent, dont je n’ai pas besoin de vous rappeler la symbolique chrétienne maintenant millénaire). La religion est elle aussi mise à mal par l’auteur. Si la chrétienté est, comme de juste, tourné en ridicule, l’animisme aveugle pratiqué par le chaman arboricole ne vaut pas mieux. S’étant écarté d’une voie raisonnable, les estoniens des bois se sont tournés à leur tour vers des simagrées, des esprits aussi effrayants qu’inexistants. Et Leemet de combattre les deux idéologies, qu’il juge réductrices et abêtissantes.
Leemet, parlons-en, d’ailleurs. C’est le héros et le narrateur du roman. Mais c’est aussi un égoïste colérique qui prend de mauvaises décisions, entraînant le malheur sur ses proches et précipitant la fin du mode de vie qu’il chérit tant. Il ne verse cependant pas non plus dans la nostalgie, à l’instar de Kivirähk. S’il regrette certains choix, il essaiera tout au long du récit d’aller de l’avant et de tirer profit des obstacles ou des changements qui s’imposent à lui. Il traversera sa vie, témoin d’un monde qui s’efface progressivement, d’une histoire qui s’oublie. Mais aussi d’un monde qui se créée et d’une réalité nouvelle qui s’impose, parfois dans la douleur et les cris.
Car si nombre de critiques louent l’auteur pour son humour, je trouve personnellement que peu insistent sur l’ambiance aussi lourde que tragique qui s’installe au fur et à mesure des chapitres. Si la première moitié, correspondant à la jeunesse de Leemet, tient en effet davantage du conte absurde, la seconde moitié verse allégrement dans la tragédie. Si Kivirähk ne se départi jamais de remarques corrosives et acerbes, les évènements qui s’enchaînent dans la seconde moitié du roman, émaillée de morts aussi absurdes qu’injustes, de scènes de violence crues et finalement inutiles et de moments de poésie crépusculaire (Ah! la scène avec le monstre marin. Ou encore celle avec le dompteur de tempêtes), ces évènements, disais-je, ne prêtent pas à sourire.
Leemet ne nous prend cependant pas par surprise : il nous prévient dès les premières pages du roman. Il est le dernier homme qui savait la langue des serpents. Il sera, toute sa vie durant, le dernier homme à être ceci ou cela, à être le témoin de tel ou tel évènement, à être le gardien de tel ou tel secret. Il est le dernier témoin d’une époque révolue et il a l’intention de le crier à la face du monde.
Vous l’aurez sans doute compris entretemps ; je ne peux que vous conseiller la lecture de ce roman estonien. La forme, parfois volontairement simpliste sans jamais être simple, pourrait vous rebuter dans les premières pages. Un conseil : persévérez. Vous avez dans les mains un roman érudit et sans concession sur le changement, sur le deuil d’un mode de vie, sur le mensonge d’un passé sublimé mais faux et sur la vérité crue d’un présent et d’un futur qui détruit autant qu’il émancipe. A éviter de lire quand on est dans une phase de déprime, donc (ce qui est bien sûr mon cas quand j’écris ces lignes).
Notez également la très intéressante postface signée par le traducteur qui replace l’œuvre dans l’actualité estonienne de sa sortie et développe une série de points que je ne fais qu’aborder succinctement dans le texte qui précède. Il ne me reste plus qu’à finalement remercier Le Tripode pour ce choix éditorial courageux et pour le travail d’édition magnifique réalisé sur ce volume en particulier. La couverture est magnifique et les choix du papier comme de la fonte rendent la lecture particulièrement aisée et agréable, ce qui n’est en rien négligeable. Un très très bon livre.

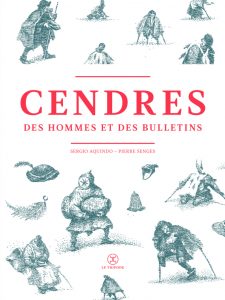 De
De 
 D’
D’ De
De 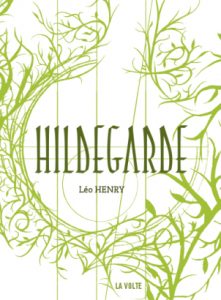 De
De