De Frédéric Beigbeder, 2018.
 Comment ? Deux Beigbeder dans la même année ? Luxe ultime ! Et… non. Bien essayé. La frivolité est une affaire sérieuse, titre soufflé par l’éditrice de Beigbeder, n’est pas le deuxième texte de fiction de son auteur pour cette année, après l’amusant Une vie sans fin, dont nous avons déjà parlé ici. C’est plus simplement un recueil de 99 essais (démarche bêtement commerciale pour rappeler son plus gros succès de librairie, qui date déjà d’il y a un paquet d’année, en fait, puisqu’on comptait encore en francs) que l’auteur a publié un peu partout au cours des dix dernières années. Enfin, essais… davantage des billets d’humeur, qu’il signa pour Lui, Entrevue ou encore des magazines russes et allemands.
Comment ? Deux Beigbeder dans la même année ? Luxe ultime ! Et… non. Bien essayé. La frivolité est une affaire sérieuse, titre soufflé par l’éditrice de Beigbeder, n’est pas le deuxième texte de fiction de son auteur pour cette année, après l’amusant Une vie sans fin, dont nous avons déjà parlé ici. C’est plus simplement un recueil de 99 essais (démarche bêtement commerciale pour rappeler son plus gros succès de librairie, qui date déjà d’il y a un paquet d’année, en fait, puisqu’on comptait encore en francs) que l’auteur a publié un peu partout au cours des dix dernières années. Enfin, essais… davantage des billets d’humeur, qu’il signa pour Lui, Entrevue ou encore des magazines russes et allemands.
Partisan du moindre effort, Beigbeder a donc collecté les textes qui traînaient dans sa cave, les regroupant vaguement par thématique, pour constituer une sorte de « journal » de la dernière décennie. Décennie qui l’a vu passer de la fin de la trentaine (de la petite quarantaine, si l’on est honnête) à la cinquantaine grisonnante, avec deux jeunes gosses. Du coup, les textes évoluent lentement de la fête permanente cocaïne/boîte de nuit/mannequins russes à … la même chose, mais une fois par semaine (car c’est plus difficile de récupérer, avec l’âge).
Et Beigbeder n’est jamais aussi bon que dans la déconne, justement. Dans le je-m’en-foutisme un poil snob mâtiné de name-dropping et de références littéraires très ciblées. C’est d’ailleurs son message, dans La frivolité est une affaire sérieuse : nous ne sommes pas là pour bien longtemps, autant nous amuser, quitte à tomber dans l’excès (c’est cette dernière phrase qui le différencie de D’Ormesson, dont la mort a gâché les vacances de Beigbeder, comme on l’apprends dans l’une des pastilles). Le recueil est divisé, par ailleurs, en trois parties : avant 2015, 2015 et après 2015. Beigbeder voit dans l’année 2015, débutée par Charlie Hebdo et terminée par la vague d’attentats parisiens, une année charnière pour lui. Déjà marqué par les évènements de 2001 (cf. son bouquin Windows on the World, 2003), la vague de 2015 semble, de manière assez résumée, lui avoir fait peur. Et la peur lui avoir fait prendre conscience que son dandysme assumé est en fait plus qu’une simple posture : c’est un manifeste de résistance, une philosophie de vie à opposer aux extrémistes de tout poil, une réponse.
Mouais. Pourquoi pas. Le cynisme est une réponse qui dénote une certaine forme d’intelligence, trait dont sont souvent dépourvus les « hommes en training » (pour paraphraser l’une des victimes du Bataclan, citée par Beigbeder dans l’un des articles). Mais une réponse un peu vaine, je le crains. D’ailleurs, à mes yeux, les textes de 2015 sont les moins bons : on y découvre un bobo finalement un peu de droite qui se replie sur ses valeurs cathos de base et qui tente la moralisation dans plusieurs textes parfois un peu maladroits. La palme revenant à son allégorie sur la libre circulation des armes qui, bizarrement, pourrait presque être utilisée en l’état par la NRA dans un spot publicitaire, tellement l’ironie est parfois trop fine. Chasse et pêche, nous voici.
Heureusement, dans les textes post-2015, il retrouve sa plume acerbe et amusante et navigue à nouveau de frivolités en frivolités, avec cependant un peu plus de poils gris dans la barbe et un peu moins de shots de vodka dans le cerveau. Il y gagne un peu de gravité, mais sait éviter, après l’émotion, la bonne morale en guise de conclusion. On passe donc un moment globalement agréable, où Easton Ellis côtoie bien sûr Salinger et Fitzgerald. Mais aussi Kate Moss et Rihana. Du Beigbeder classique, donc, dans une forme courte, journalistique, qui privilégie le développement d’une idée conne mais drôle en deux pages. Plus direct, moins construit, plus franc, sans doute. Pour ceux qui, comme moi, aime le personnage et savent rire de futilités (je sais, c’est un peu moins valorisant que frivolité), c’est fort agréable. Notons pour finir que l’auteur fait une infidélité à Grasset pour les relativement méconnues Éditions de l’Observatoire. La diffusion médiatique en prends un coup, du coup (justement, pour un observatoire…).

 De J.D. Salinger, 1948-1953.
De J.D. Salinger, 1948-1953. D’
D’ De
De 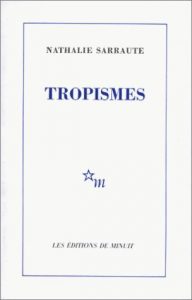 De
De