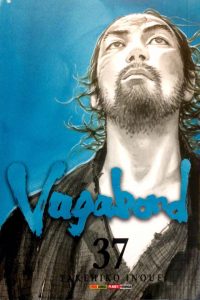De Kazuo Umezu, 1974-1976.
De Kazuo Umezu, 1974-1976.
En me baladant dans une librairie spécialisée en BD l’autre jour (il faut bien anticiper un énième lockdown), j’ai été très surpris de constater que Glénat continuait à éditer certains mangas de son back catalogue que je pensais hors commerce depuis des années. Et c’est ainsi que j’ai pu acheter les volumes 3 et 4 (sur 4) de Baptism, un classique du manga d’horreur par nul autre que le très fameux Kazuo Umezu. Par un quelconque concours de circonstances, je n’avais dans ma bibliothèque que les deux premiers tomes qui prenaient piteusement la poussière depuis tout ce temps dans l’espoir hypothétique de se voir rejoindre par les numéros manquants. L’occasion était donc trop belle.
Kazuo Umezu, pour ceux qui ne le connaissent pas, est l’un des pionniers du manga moderne, au même titre qu’Osamu Tezuka ou Leiji Matsumoto. Bien qu’ayant débuté dans le shojo et que son œuvre la plus vendue soit Makoto-chan, une comédie burlesque et absurde, Umezu est surtout connu sous nos latitudes pour ses mangas d’horreur. Glénat avait ouvert le marché voilà bien des années en publiant coup sur coup dans leur collection bunko (le bunko est une forme plus petite et plus épaisse que les mangas que l’on trouve traditionnellement et que les japonais affectionnent particulièrement pour les rééditions « à bas prix » des grands classiques) le monumental L’école emportée et, donc, Baptism. Il faudra attendre de nombreuses années pour qu’un autre éditeur, Le Lézard Noir, se lance dans la publication d’autres œuvres horrifiques de l’auteur, donc un autre titre fleuve ; Je suis Shingo.
Revenons à Baptism. Première bizarrerie, le titre est pré-publié dans le magazine Shôjo comics (où ont pu être pré-publiés, par exemple, Fushigi Yuugi, Georgie! ou Kare First Love). Donc pour un cœur de cible commercial de petites filles, disons, entre 8 et 14 ans. Pourtant, même si les protagonistes principales de Baptism sont en effet des fillettes, c’est clairement un récit d’horreur.
En deux mots, un actrice star perd de sa superbe alors que les années commencent à marquer son visage. Elle décide alors de se retirer de la vie publique et d’avoir un enfant, une fille, le plus rapidement possible. Alors que cette dernière, Sakura, atteint l’âge de 8-9 ans, elle découvre sur un quiproquo la véritable raison de sa naissance : sa mère entend bien transplanter son propre cerveau dans la boîte crânienne de sa fille et, ainsi, revivre une seconde jeunesse à l’abri des affres du temps qui passe. Et… elle y parvient. Je veux dire : la mère, l’actrice, trépane sa fille avec l’aide d’un mystérieux médecin, fait placer son cerveau dans le corps de sa progéniture et usurpe sa place à l’école. J’oublie de dire que son premier acte, à son réveil, est d’écraser le cerveau de sa fille abandonné par le médecin maléfique et d’enterrer son précédent corps au fond du jardin…
Et c’est sur cette introduction quand même vachement trash que la jeune Sakura, avec le cerveau d’une femme de 50 ans, va manipuler les copines de sa fille et séduire son professeur. En un mot comme en dix, Baptism est pour le moins malsain. Porté par la patte graphique tellement reconnaissable d’Umezu, dont les personnages semblent toujours figés dans l’effroi, Baptism est une véritable descente aux enfers dans les affres d’une psyché malade, d’une femme qui refuse de vieillir et qui est prête à toutes les extrémités pour avoir une seconde chance.
Court, frappant, Baptism constitue une belle pierre dans l’édifice gothique et dérangé qu’est l’œuvre d’Umezu. Il n’a pas le souffle épique (dans l’horreur, entendons-nous bien !) de L’école emportée, mais on y sent les efforts que le mangaka met pour tenter d’amener un public qui ne lui est à priori pas acquis (les fillettes ?!) vers un genre nouveau pour elle. Ses tentatives de mettre en scène des rivalités scolaires, trame de fond de nombre de titres shôjo tournent d’ailleurs assez vite courts. Sakura, contrairement à ses condisciples des shôjos plus traditionnels, ne s’embarrasse pas de drama. Si une fille devient trop curieuse, elle l’enterre vivante. Si la femme du professeur qu’elle convoite devient gênante, elle la torture et la fait passer pour folle…
Bref, du Umezu tout craché. Le « personnage » d’Umezu, cet éternel adolescent de plus de 80 ans maintenant, très mince dans son inamovible t-shirt à manches longues strié rouge et blanc, est aussi indéfinissable que son œuvre. Ce que j’écris ci-dessus ne rend pas justice au manga. J’espère simplement ne pas vous avoir découragé ou dégouté. Même si la moralité de l’ensemble est douteuse et si la fin est malheureusement très décevante, mal amenée et invraisemblable dans la logique interne du récit (bizarrement), Baptism reste à mes yeux un grand succès : c’est un récit effroyable qui joue sur l’une des pires peurs que l’on peut avoir ; être trahis et persécuté par ses propres parents. A ne probablement pas mettre dans les mains d’une petite fille de huit ans. Sacrés japonais !

 D’
D’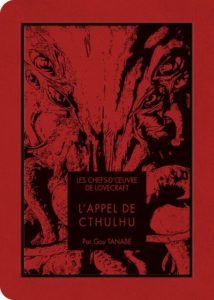 De
De  De
De 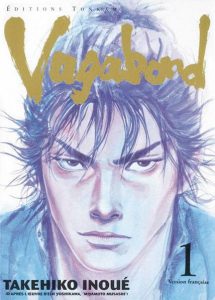 De
De