 D’Arthur Machen, 1894-1895.
D’Arthur Machen, 1894-1895.
Suivi de :
La Lumière intérieure
Histoire du cachet noir
Histoire de la poudre blanche
La Pyramide de feu
Il y a bien longtemps dans les colonnes de ce blog, en 2017 plus exactement, je vous avais parlé d’un classique de la fantasy publié chez une petite maison d’édition, alors relativement confidentielle, du nom des Editions Callidor. Il s’agissait des Habitants du Mirage, d’Abraham Merritt, que l’on ne trouvait plus guère à l’époque que dans les solderies et autres bouquinistes dans ces vielles éditions J’ai Lu, dans la collection « Fantastique » époque Jacques Sadoul. Le classique de 1932, que j’avais apprécié pour ce qu’il était, à savoir un roman assez mécanique et archaïsant, mais posant néanmoins les fondations d’une fantasy qui allait alors se développer à travers les magazines pulp des décennies suivantes, je finissais l’article en précisant que Callidor, dont c’était là le coup d’essai, semblait être en fâcheuse posture.
L’histoire m’a donné tort, apparemment. Non content d’avoir continué à publier, à un rythme de sénateurs, quelques grands classiques dans une diffusion relativement limitée, l’équipe éditoriale a fait un choix drastique (peut-être liée à un contrat avec un nouveau diffuseur ?) il y a quelques années de s’orienter davantage dans l’édition de luxe, tout en maintenant une ligne éditoriale claire consacrée aux classiques de la littérature de genre. Ils sont même légèrement sortis de leur ligne pour publier également des classiques du roman d’aventure, comme l’Appel de la Forêt de London, Shogun de James Clavell ou encore Spartacus de James Leslie Mitchell.
Et ce Grand Dieu Pan, déjà publié chez de multiples éditeurs dans de multiples formats ces dernières années, en est le plus parfait exemple. Beau livre, contenant non seulement la novella éponyme de Machen, mais également quatre autres nouvelles et plusieurs textes connexes signés Guillermo del Toro, Jorge Luis Borges ou encore S.T. Joshi (excusez du peu !), cette superbe édition trouvera aisément sa place dans les rayonnages de la bibliothèque de l’amateur de fantastique éclairé. Sous sa couverture cartonnée illustrée splendidement par un dessin du paraguayen Samuel Araya se cache quelques bijoux de la littérature fantastique du tournant du siècle, ayant inspiré entre autres les premiers écrits de Lovecraft, au même titre que les romans et nouvelles de Lord Dunsany. Le grammage du papier, le choix des différentes cases de caractères (en ce compris celles qui imitent l’écriture scripturale) et le soin apporté à la mise en page et à la reliure en font réellement un objet de collection, réhaussé en cela par un tirage relativement limité (4.000 exemplaires pour le premier tirage, d’après le colophon).
Ajoutons à ce ceci que Machen n’est pas Merritt, puisque je commençais cette critique par le rappel de ce dernier. Là où Merritt livrait une aventure aimable, marquée cependant par les tropes de son époque et un développement parfois trop mécanique, Machen livre au contraire ici des textes fort, qui allient clairement un amour du « surnaturel » et de la belle littérature. La nouvelle éponyme en particulier, sublimée par la traduction initiale de Paul-Jean Toulet, écrivain français amoureux de la langue dont le nom est malheureusement tombé dans l’oubli, est un parfait exemple d’une alliance réussie entre le roman d’aventure à la Robert Louis Stevenson et le drame gothique à la Marry Shelley. Il faut se rappeler que le gallois Machen, lorsqu’il rédige les diverses nouvelles regroupées dans ce volume, n’a pas encore pu s’inspirer du grand succès de librairie qui s’imposera trois ans plus tard : le Dracula de Bram Stoker, publié en 1897. Machen est donc réellement un pionnier qui eut la chance, comme on l’apprend dans le commentaire de S.T. Joshi, le plus grand spécialiste vivant de l’œuvre de Lovecraft, d’avoir pu écrire ce qu’il voulait, épargné des affres de la vie quotidienne par un héritage heureux.
Le Grand Dieu Pan, comme La Pyramide de Feu, firent scandale à leur sortie initiale, bouleversant une Angleterre victorienne peu habituée à ce que les contes pour enfants trouvent une déclinaison plus adulte et horrifique. Les textes regroupés ici, au-delà de certaines scories dues à leur époque, sont étonnement modernes dans leur traitement : le lien entre le sexe et la damnation y est traité par le biais du surnaturel, en s’inspirant des légendes galloises (et plus largement, britanniques) que sont par exemple le petit peuple, nettement plus inquiétant ici que dans les pièces fantastiques du barde Shakespeare lui-même. Exit le gentil Puck de Songes d’une nuit d’été et place aux fées monstrueuses qui inspireront bien plus tard Neil Gaiman pour certains épisodes de Sandman ou moultes auteurs de fantasy modernes qui « revisiteront » nos contes et mythes comme Arthur Machen l’avait déjà fait à la toute fin du XIXème siècle.
La Lumière intérieure, qui suit Le Grand Dieu Pan, est sans doute la nouvelle la plus faible du recueil, avec son déroulé relativement convenu. L’Histoire du cachet noir, elle, nous plonge réellement dans une ambiance lovecraftienne de recherche d’une civilisation passée sont les traces éparses ne peuvent conduire qu’à d’innommables confrontation. Et bien que je sache que c’est bien sûr Lovecraft qui s’est inspiré de Machen et non l’inverse, il est difficile de trouver meilleur adjectif que lovecraftien pour commenter ces textes. L’Histoire de la poudre blanche, elle, ne s’intéresse pas réellement aux civilisations anciennes mais va directement se confronter à la corruption du corps par l’ingérence de substances impies. Certains passages, presque proches du « body horror » revenant à la mode avec le récent The Substance, trente ans après les délires filmiques de Cronenberg dans le domaine, démontre à nouveau l’incroyable relevance et jeunesse de textes de Machen. Enfin, La Pyramide de feu, sous ses dehors de charmante enquête pastorale, nous confronte elle-aussi à l’indicible et se conclut sans espoir par une porte vers l’inconnu que les protagonistes préfèrent refermer, conscients de ne pouvoir influer des forces trop anciennes et trop puissantes pour eux. Si l’on remplace les collines chauves et sauvages du Pays de Galles par les sombres forêts de la Nouvelle Angleterre, à nouveau, nous pourrions parfaitement être dans un récit de l’homme de Providence.
Enfin, et il faut le souligner, l’ouvrage est parfaitement soutenu par les illustrations éthérées et inquiétantes de Samuel Araya. L’artiste, pour qui illustrer du Machen était apparemment un rêve de gamin, a eu l’intelligence de partir de vieux clichés, chiné à droite à gauche dans des vides greniers, pour les « pervertir » de diverses manières afin de faire surgir eu eux l’image du malin, quel que soit le nom qu’on lui donne. Les 26 illustrations n’ont pas toutes la force d’évocation de celles choisies pour illustrer la couverture et la quatrième de couverture, mais elles apportent clairement une touche dramatique supplémentaire, suggérant plutôt que montrant, puisque le mal est par définition indicible. L’illustrateur revendique d’ailleurs intelligemment dans son court commentaire qui clôt l’ouvrage le fait d’avoir illustrer des situations, personnages et paysages qui ne se trouvent pas dans les textes de Machen, faisant en cela appel à l’imagination du lecteur pour créer le sens et les significations de ses choix. Malin, dans tous les sens du terme. Si vous n’êtes pas encore convaincu à ce stade-ci de ma chronique, je ne sais évidemment qu’ajouter pour vous convaincre. 35€ pour cette superbe édition d’un classique du fantastique ayant inspiré nombre d’auteurs modernes, dans un splendide écrin d’une maison d’édition qui aime son catalogue et son métier devraient, je l’espère, clore définitivement votre débat intérieur, pour autant qu’il ait lieu.

 De
De  Edité par
Edité par 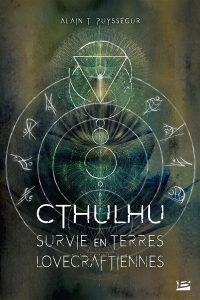 D’
D’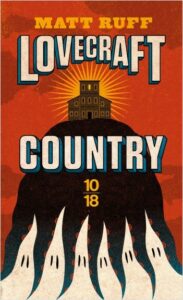 De
De