 De Michael Finkel, 2023.
De Michael Finkel, 2023.
Sous-titré : Une histoire d’amour et de crimes
Michael Finkel est ce qu’il est convenu d’appeler un journaliste-écrivain. Il ne publie en effet pas des romans, mais des portraits d’hommes hors-norme moderne. Son premier coup d’éclat date d’il y a une vingtaine d’année lors de la sortie de True Story : Le Meurtrier et le Journaliste, dans lequel l’auteur décrit son expérience et la relation qu’il a établi avec un meurtrier écroué qui avait également usurpé son identité (celle de Finkel). Il y a une dizaine d’année, Finkel a récidivé avec l’histoire de Christopher Thomas Knight dans son livre Le Dernier Ermite, un ancien cambrioleur américain qui a décidé de vivre coupé de tous contacts humains dans une forêt du Maine entre 1986 et 2013. A la lumière de ces deux livres-témoignages, on constate une certaine attirance de la part de Finkel pour les personnages qui cumulent des destins extraordinaires et un certain mépris pour les lois (le premier était un meurtrier, le second un cambrioleur).
Quoi de plus logique, donc, pour Finkel, que de s’intéresser à l’histoire du français Stéphane Breitwieser, connu mondialement pour avoir été l’un des voleurs d’art les plus prolifiques de tous les temps, à égale mesure avec des personnages de fiction comme Arsène Lupin. Mais c’est précisément là où le bât blesse dès la quatrième de couverture pour moi : présenter un voleur de manière presque romanesque comme un équivalent du personnage inventé par Maurice Leblanc le rend dès le départ beaucoup plus sympathique qu’il ne l’est vraiment.
Revenons en quelques minutes aux faits. Stéphane Breitwieser est un alsacien dilettante, vivant chez sa mère et peu social qui, par ce qu’il décrit comme un concours de circonstances (mal-?)heureux, s’est un beau jour mis à voler des œuvres dans les musées européens. Il clamera, après avoir été arrêté des années après le début de ses méfaits, l’avoir fait par amour de l’Art et par amour de sa compagne d’alors, qui fut son assistante dans nombres de ses vols. Entre le milieu des années 90 et son arrestation en 2001, le couple Stéphane Breitwieser/Anne-Catherine Kleinklauss aura volé des centaines d’œuvres d’art de dizaines de musées européens. Après son arrestation, la police retrouvera une série de pièces dans un canal près de Mulhouse, apparemment jetées par la mère de l’intéressé après son arrestation. Des dizaines d’œuvres sur bois (peintures et autres) auraient été brûlées par sa mère également pour dissimuler les objets du délit et d’autres pièces n’ont jamais été retrouvées. Bref, un terrible gâchis pour la culture européenne en général, des mains d’un couple dont la motivation aurait été, d’après leurs dires, l’attirance pour le beau. Car, toutes ces années après, il n’a en effet jamais pu être démontré que le couple en avait fait un quelconque commerce. Ils volaient et, disaient-ils, entreposaient lesdites pièces dans leur chambre commune, à l’étage de la maison familiale, pour « leur plaisir personnel« .
Et c’est exactement le discours que reprend Finkel dans son bouquin, rédigé sur base d’entretiens avec l’intéressé et différents protagonistes (un ami cadreur, certains policiers, des témoins directs ou indirects) bien des années après le propre livre de Breitwieser, Confessions d’un voleur d’art, publié en 2006. Et le bouquin de Finkel est bien construit, malgré un style un peu quelconque, partant d’un premier portrait du voleur, développant ses principaux coups d’éclat et commentant largement son arrestation et les suites de celle-ci. J’ai cependant un problème de fond avec l’histoire, comme vous l’avez sans déjà compris : j’ai beaucoup de mal à voir les protagonistes principaux comme de gentils idéalistes. Il est d’ailleurs notable que le voleur donnant son titre au bouquin, en filigrane, fini par blâmer sa compagne comme muse de ses vols et sa mère comme complice silencieux et destructrice du patrimoine élégamment emprunté.
Je n’en crois rien. M. Breitwieser est un cleptomane qui a profité du manque de moyens de nombre de musées locaux pour assouvir ses pulsions. Je suis prêt à croire qu’il n’y avait pas là d’intentions bassement pécuniaires, le dossier ne présentant aucune tentative de vendre les œuvres qu’il avait volé. Mais son discours justificatif disant qu’il empruntait là des œuvres mal mises en valeur afin d’en profiter pour lui seul se fissure déjà à sa première arrestation en Suisse, après s’être fait prendre à la suite d’un vol raté dans une galerie commerciale. Et une galerie commerciale n’est pas un musée : les œuvres qui y sont exposées ne sont pas des œuvres mal mises en valeur par des musées désargentés dont on pourrait imaginer « sauver » les œuvres pour profiter d’une forme d’onanisme artistique. Non, ce sont des œuvres vendues au profit des artistes (ou d’autres propriétaires) pour l’onanisme artistique d’un nouveau propriétaire. Donc son acte est bien un simple vol. Et la boulimie dont il fit preuve après quelques années, volant plusieurs pièces sans réel intérêt pour celles-ci, les conservant mal chez lui, voire les abimant définitivement, confirme que l’attrait pour l’art n’est qu’une excuse. Preuve ultime, après avoir été libéré après quelques années de prison, il a été repris pour vol à l’étalage, confirmant en cela sa cleptomanie maladive.
Je suis donc assez peu convaincu par ce portrait d’un triste individu et par le choix de Finkel de lui trouver toutes sortes de circonstances atténuantes ou d’excuses. Je peux comprendre qu’il ait été charmé par le bonhomme, les grands artistes de la cambriole pouvant se revêtir d’un manteau de romantisme, mais la conclusion reste la même. A cause d’un imbécile qui se croyait tout permis, la France, la Suisse, la Belgique, l’Allemagne, les Pays-Bas et le Danemark ont irrémédiablement perdu une partie de leur patrimoine. Et si les différentes polices concernées semblent assez inefficaces, je peux comprendre leur incompréhension face à un profil il est vrai atypique. Reste un livre qui ressemble par bien des aspects à une variante du syndrome de Stockholm : Finkel, apparemment attiré par les personnages aux marges de la légalité, fini par pardonner aux criminels. Sans doute très chrétien, mais à côté de la plaque à mes yeux.

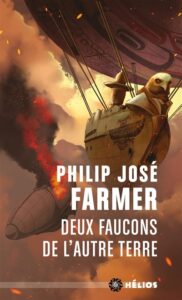
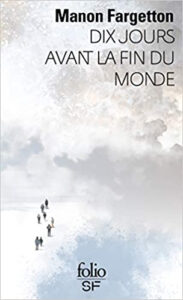 De
De 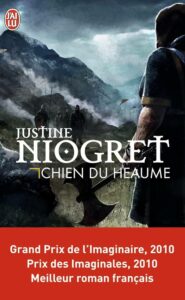 De
De 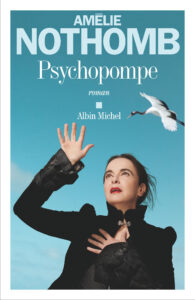 D’
D’