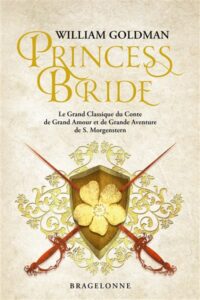 De William Golding, 1973.
De William Golding, 1973.
Sous-titré : Le Grand Classique du Conte de Grand Amour et de Grande Aventure de S. Morgenstern
Véritable madeleine de Proust pour nombre de ses afficionados, l’adaptation en long métrage de ce roman, signée par Rob Reiner en 1987, aura marqué une génération, surtout Nord-américaine, à l’aube des années 90. Le feel good movie est cependant une adaptation, l’adaptation d’un roman sorti plus de dix ans au préalable de la main d’un scénariste émérite d’Hollywood que rien, à priori, n’amenait vers le conte ou la fantasy. Pourtant, Princess Bride fut aussi la porte d’entrée vers une fantasy plus adulte que les longs métrages d’animation de la société aux grandes oreilles. Il était donc plus que temps de se plonger dans ce classique, d’autant plus grâce à la belle réédition de Bragelonne dans son nouveau format prestige, quelque part entre le format poche et le grand format (collection dans laquelle on retrouve l’intégrale du Witcher, mais aussi les trois premiers tomes de la saga des Salauds Gentilhommes de Scott Lynch – on attend toujours le quatrième volume, d’ailleurs ! – ou encore la trilogie du Paris des Merveilles de Pierre Pevel).
Revenons-en au roman de Golding. Après une assez longue introduction extradiégétique de Golding, qui commente l’écriture du roman et le long historique des tentatives d’adaptation en long métrage avant celle réussie de Reiner, le roman fini par débuter. Il est important ici de faire une parenthèse : Golding s’amuse à prétendre qu’il n’est qu’un fidèle copiste qui se contente de réduire et d’adapter un texte de S. Morgenstern, grand érudit et historien de la nation Florine (le Florin étant un pays fictif imaginé par Golding dont l’auteur situe la réalité géographique quelque part dans les pays baltes actuels). S. Morgenstern n’ayant bien sûr jamais existé, nous avons bien entre les mains un roman du scénariste de Butch Cassidy & le Kid, des Hommes du Président (deux films pour lesquels il a eu l’oscar du meilleur scénariste), mais aussi des Jumeaux, de Misery, de Last Action Hero, des Pleins Pouvoirs ou encore du Déshonneur d’Elisabeth Campbell. Une carrière à mi-chemin entre le film dramatique et la comédie d’action.
Et c’est exactement ce qu’est Princess Bride ; une comédie d’action, à laquelle s’ajoute une touche de romantisme et un poil de fantasy. Cocktail parfait pour en faire un best-seller. En gros, Princess Bride répond parfaitement au cahier des charges du conte classique. D’une situation de départ très classique (une jeune fermière extrêmement belle se rend compte qu’elle est amoureuse du garçon de ferme, mutique, mais fidèle depuis de nombreuses années) dans les contes de fées, on passe par l’élément déclencheur (le garçon de ferme part pour devenir l’homme qui peut offrir le monde à sa dulcinée et un méchant noble jette son dévolu sur la jeune fermière) jusqu’au déroulé classique en trois actes du récit initiatique (les aléas se succèdent, les quêtes secondaires s’enchaînent pour arriver jusqu’à la résolution forcément attendue).
Mais là où Golding est fort, c’est qu’il utilise les tropes du genre tout en s’en moquant ouvertement. Ainsi, l’auteur n’hésite pas à interrompre son texte pour donner ses commentaires acerbes sur le déroulé du récit et, en particulier, sur les longueurs inintéressantes qu’il prête volontiers à ses collègues écrivains. Ainsi, l’auteur se concentre sur les phases d’action et non sur la construction du lore de son monde, dont il se moque éperdument. Pourtant, l’ensemble fonctionne à merveille. Et la recette est assez simple à comprendre : connaissant parfaitement les rouages d’un scénario efficace, Golding se concentre sur quelques personnages forts, des dialogues mémorables et de l’action à tout va qui tient le lecteur en haleine. Et ça marche, évidemment. Les ficelles sont grosses, l’auteur les souligne, on sait ce qui va arriver, mais on est malgré tout embarqué dans l’histoire.
Cela tient en particulier aux deux acolytes du héros, le palefrenier Westley. Dans sa reconquête de sa promise, la belle et excessive Bouton d’or, Westley parvient à s’adjoindre les services de l’épéiste de renom espagnol Inigo Montoya et du géant turc un peu simplet Fezzik. Derrière leur rôle qui semble au premier abord unidimensionnel se cache évidemment les personnages les plus intéressants de l’histoire. Le premier est mû par sa volonté de vengeance qui le ronge jusqu’à l’abandon de soi et le second, derrière sa masse musculaire, est un être fragile qui ne craint que de la solitude. Cela donne des scènes mémorables où les méchants sont effectivement méchants (le comte Rugen est un spécialiste de la torture) et où les gentils triomphent malgré l’adversité (les phrases « My name is Inigo Montoya. You kill my father. Prepare to die » sont devenus des memes internet depuis de nombreuses années maintenant).
Il n’est sans doute pas utile de développer davantage l’histoire, pour préserver la surprise de celles et ceux qui n’auraient pas encore lu ce classique ou vu le film qui en fut inspiré. Revenons-en donc au texte. Golding, qui a manifestement des facilités d’écriture, a un côté énervant. A la lecture du bouquin, je me suis dit à plusieurs moments que c’était un classique de fantasy émaillé de l’humour d’un juif new-yorkais. Le Hobbit commenté par Woody Allen, en gros. Et c’est exactement ça. Les commentaires de Golding sur son propre texte sont parfois irritants, mais c’est aussi grâce à eux, grâce à cette distance ironique, que le texte prend. Cela permet de se focaliser sur l’action et sur le développement des quelques personnages principaux. Et même si l’on se doute tous de la fin du livre dès les premières lignes, Golding parvient à maintenir le suspens tout au long du roman, en mettant en scène des solutions abracadabrantesques aux situations les plus périlleuses.
Comme cette édition est celle du 25ème anniversaire de la parution originale du roman, Golding y ajoute un nouveau chapitre, intitulé Le bébé de Bouton d’or, qui se passe quelques années après la fin du roman original. Dans sa mythologie personnelle, Golding informe le lecteur qu’il a du batailler ferme pour écrire lui-même ce chapitre, puisque les ayants droits de Morgenstern (qui, pour rappel, n’existe pas !) voulait confier cette suite à nul autre que Stephen King (un ami de Golding depuis l’adaptation de Misery). Ce nouveau chapitre, au-delà du cliffhanger sur lequel il se clôt, ajoute une dimension importante au personnage d’Inigo Montoya en s’intéressant à son passé à travers un flashback sans lien avec l’intrigue. Je ne sais pas si Golding avait l’intention de poursuivre et de proposer une véritable suite à Princess Bride, l’un des rares romans qu’il aura signé lors de sa longue carrière, mais ce nouveau chapitre a le mérite de ne pas laisser planer le doute sur la toute fin du roman original et de répondre à quelques questions laissées ouvertes. Et de provoquer l’insatisfaction éternelle des fans qui en voulaient forcément plus, Golding étant décédé en 2018 sans jamais avoir repris la plume pour prolonger ce chapitre orphelin.
Reste une aventure picaresque, où le fantastique reste limité à quelques éléments qui tiennent davantage du conte de fées que de la fantasy en tant que telle. Une romance éternelle, également. Et une comédie d’action. À redécouvrir sans modération.

 De
De  De
De  De
De 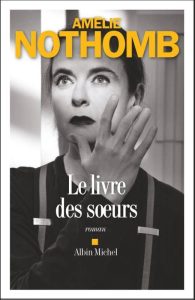 D’Amélie Nothomb, 2022.
D’Amélie Nothomb, 2022.