De Thierry Di Rollo, 2003.
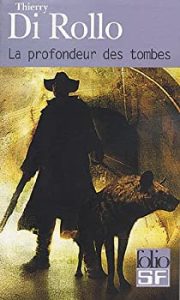 Cela faisait bien des années que je n’avais pas relu du Di Rollo. Pourtant, son style enjoué, sa plume picaresque et l’humour omniprésent font de ses œuvres de vraies parties de plaisir ! … Naaaaan, je déconne. Ça ne rigole pas des masses, dans les romans de Di Rollo. Que du contraire : le nihilisme, le désespoir et l’horreur à échelle humaine suintent de chacune de ses pages. Et La profondeur des tombes, comme son titre le laisse entendre, est du même tonneau que les autres bouquins que j’ai lu de lui.
Cela faisait bien des années que je n’avais pas relu du Di Rollo. Pourtant, son style enjoué, sa plume picaresque et l’humour omniprésent font de ses œuvres de vraies parties de plaisir ! … Naaaaan, je déconne. Ça ne rigole pas des masses, dans les romans de Di Rollo. Que du contraire : le nihilisme, le désespoir et l’horreur à échelle humaine suintent de chacune de ses pages. Et La profondeur des tombes, comme son titre le laisse entendre, est du même tonneau que les autres bouquins que j’ai lu de lui.
Dans un futur postapocalyptique, causé non par la guerre mais par l’extinction des ressources énergétiques qui pousse collectivement l’humanité à retomber sur le charbon, quitte à détruire encore plus vite ce qui lui reste de futur, un homme seul erre au sens propre comme au sens figuré. Porion dans une mine dantesque où la vie humaine n’a que peu de prix, il est chargé de vérifier le travail des uns et des autres et d’amener un nouvel animal synthétique à un « fouineur » chargé de dénicher les nouveaux filons de centaines de mètres sous terre. Il remonte dans la nuit continue, sous un ciel continuellement sombre et dans le froid ambiant causé par la couche de pollution qui voile le soleil faiblard en journée, après avoir traversé des galeries pleines d’âmes en peine.
A la surface, la misère d’une vie solitaire et ses souvenirs l’attendent. Jusqu’au jour où il craque et détruit l’équilibre fragile de sa vie d’esclave lâche et complaisant pour poursuivre une idée, un rêve, dans l’U-Zone, cette grande région de non-droit qui entoure les quelques poches citadines anonyme où l’humanité survit petitement. Il sera accompagné par un ersatz de sa fille, sous la forme d’un répliquant détraqué en fin de vie mécanique et d’une hyène de garde, génétiquement créée et modifiée pour lui obéir en toutes circonstance. Que fera cet homme désespéré, brisé, lorsque son histoire personnelle le rattrapera ?
Et bien il faudra lire le bouquin pour le savoir. Court roman, dur, froid et désespéré, Di Rollo, comme Number Nine, Archeur ou encore La lumière des morts, signe un voyage presque personnel, une étude psychanalytique d’un homme brisé qui a perdu sa raison d’être et de vivre et qui s’enfonce toujours plus loin dans ses illusions. Di Rollo ne se dit pas influencé par K. Dick pour rien : il parvient à dresser en quelques paragraphes disséminés ci et là le portait d’un monde futuriste affreux dont les règles, parfois plus symboliques que pratiques, entraîne invariablement le protagoniste dans une descente aux enfers où souvenirs et présent, où réalité et fictions se mêlent dans un flou violent et presque absurde. Désespérément beau, Di Rollo a également le sens de la fulgurance et la capacité à toucher son lecteur avec quelques tableaux impressionnistes où les trajectoires de vie se croisent et s’éteignent.
A réserver à ceux ne s’enfoncent pas eux-mêmes dans des spirales négatives lorsqu’ils lisent celle d’un autre. Et à classer dans ce genre finalement très française du postapocalyptique personnel, psychologique et pratiquement absurde (le Mondocane de Barbéri m’est revenu en tête à plusieurs moments). Un bon roman, pour autant qu’on est sensible à ce que Di Rollo tente de démontrer. Et pour autant qu’il tente effectivement de démontrer quelque chose et pas simplement de plonger son lecteur dans une expérience de l’absolu, sans concession à la bienveillance ou même au récit en tant que tel.

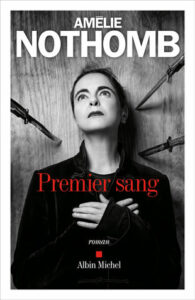 D’
D’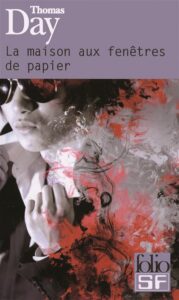 De
De  De
De 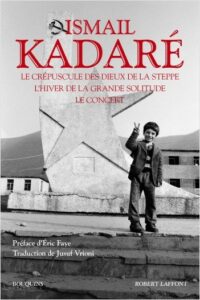 D’
D’