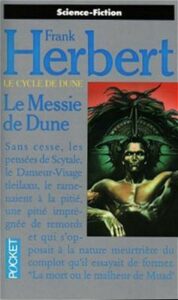 De Frank Herbert, 1969.
De Frank Herbert, 1969.
Il y a un peu moins d’une année, je signais ici une assez longue critique du premier tome de la saga Dune, en préparation de la nouvelle version ciné de Villeneuve (qui n’est toujours pas sortie à ce jour !). Il est temps, aujourd’hui, de plonger plus avant dans la saga fleuve SF des années 60 et 70. Herbert aura mis quatre ans pour rédiger et publier la suite à son premier opus, le Messie de Dune, sorti en 1969. Nettement plus court que son prédécesseur, ce deuxième tome fait l’impasse, assez logiquement, sur des chapitres introductifs nous présentant l’univers de Dune ou la vie et la destinée de ces principaux protagonistes. Il n’en constitue cependant pas une suite directe. Si Paul Atréides, connu désormais sous le nom de Muad’dib, l’Empereur-Dieu de Dune, est toujours le « héro » de notre histoire, il s’est passé une dizaine d’année entre la fin de Dune et le début de ce tome.
Et la situation a changé en dix ans. Le djihad, tant redouté par Paul a eu lieu en son nom. Des mondes innombrables ont basculé dans la guerre au nom de la nouvelle foi, au nom du nouvel Empire. On l’apprendra plus tard dans le roman, des centaines de millions (s’agissait-il de milliards ?) de personnes sont mortes dans des guerres de conquête locales, le mouvement religieux lancé par et centré autour du prophète Muad’dib ayant des vocations prosélytes assez agressives (c’est un euphémisme, pour ceux qui n’auraient pas capté). Mais ce n’est pas de ceci que parle le Messie de Dune. Cela n’est que l’arrière-plan qui nous mène à l’intrigue réelle du roman.
Le Messie de Dune est en fait, pratiquement, un huis-clos. Une série de quelques personnages issus du premier tome, à savoir la révérende-mère du Bene Gesserit qui avait testé Paul dans sa jeunesse, un représentant de la Guilde Spatiale, la propre femme de Paul, fille de l’ancien Empereur déchu, et, nouvel antagoniste, un Danseur-Visage tleilaxu (sorte de métamorphe aux ordre de la Bene Tleilax, une école de pensée et groupe d’influence qui crée des mentats -les ordinateurs humains- « tordus ») se rassemble pour ourdir un complot visant à renverser Paul et reprendre leurs droits, tant économiques que philosophiques, sur la galaxie et l’Empire en particulier. Pour cela, ils veulent offrir à Paul un cadeau particulier, qui le déstabilisera et leur offrira un moyen de pression bien utile.
Et tout le tome, pendant ses 250 pages, ne nous contera que la mise en place de ce piège, entrecoupé par des passages d’introspection où Paul et sa sœur se posent des questions sur leurs pouvoirs, leur influence, leur rôle dans le devenir de l’humanité. Il est bien sûr question d’Arakis, mais Herbert laisse largement le world-building dans ce tome pour s’attarder surtout sur ses personnages, sur la tragédie classique qu’il construit pierre par pierre (ou grain de sable par grain sable, bien sûr… ouarf-ouarf-ouarf, qu’est-ce qu’on se marre). A tel point d’ailleurs, que le livre, pour ses deux premiers tiers, est essentiellement théâtral. Des scènes de dialogue succèdent aux scènes de dialogues sans que l’histoire ne progresse réellement, les décisions (et surtout l’action) étant systématiquement repoussées.
Et cela donne, à nouveau, comme dans le premier tome, un roman de SF avec un rythme très étrange. Lent, introspectif, volontairement mystique, voire obscur, Le Messie de Dune m’a fasciné et frustré à la fois. Fasciné car il y a quelque chose de grandiose à assister à l’inéluctable destin d’un prophète maudit, d’un futur Dieu qui n’a pas choisi ce qui lui arrive. Il devenait déjà de plus en plus antipathique vers la fin du premier tome. Il connait dans ce second opus à nouveau quelques émotions humaines, notamment et surtout envers sa femme et sa sœur, accentué encore l’arrivée du « cadeau » des conjurés [SPOILER], à savoir un Duncan Idaho, fidèle lieutenant de feu le père de Paul et véritable mentor dans sa jeunesse, ressuscité ici par les bons soins des technologies tleilaxiennes [/SPOILER]. Mais elles ne sont que passagères ou accessoires. Paul, omniscient et présent dans plusieurs réalités/temporalités, n’est plus vraiment un humain. Il est autre chose. Il est le prophète ultime, le Dieu vivant qui craint, regrette et anticipe son destin tout à la fois.
C’est en cela que Dune reste une œuvre magistrale et passionnante : elle nous plonge aux confins d’un univers de SF très construit et de la création d’une véritable religion avec toutes les incompréhensions, injustices et horreurs que cela provoque. Cependant, je disais également que la lecture du Messie de Dune était une expérience frustrante. Les défauts qui m’avaient dérangé dans le premier tome, à savoir une certaine tendance au verbiage technico-ésotérique hermétique et un rythme extrêmement lent, sont ici poussé un cran plus loin. Il ne se passe virtuellement rien dans ce roman avant le dénouement annoncé dès les premières pages. Et ça bavarde beaucoup. Pire, ça bavarde sans s’écouter. Les protagonistes se lancent systématiquement dans de grandes tirades à double-sens, abusant d’un vocabulaire très marqué qui n’est que partiellement défini dans les annexes du roman (copiées-collées des annexes du premier tome), et se coupent l’un l’autre pour assener à l’autre leur propre vérité (ou leur propre sous-entendu, beaucoup plus souvent). Cela donne des dialogues assez abscons, qui plongent volontairement le lecteur dans des abimes d’incompréhension. Et j’avoue avoir toujours un peu de mal avec ce principe. Boileau disait voilà déjà quelques siècles « ce qui se conçoit bien s’énonce clairement« . Hebert aurait mieux fait de s’inspirer davantage de la maxime : ses dialogues, qui constituent la très large majorité du roman, sont tout sauf clairs, rendant son propos parfois confus, souvent pénible.
Reste un acte nouveau, une transition nécessaire entre un premier opus qui constitue la Genèse de l’œuvre et sa suite. C’est une pierre nécessaire dans l’édifice magistral que Herbert construisait alors. Mais est-ce un bon livre pour autant ? Eh bien, j’hésite. Je suis heureux de l’avoir lu et, comme à la fin de l’article consacré au premier tome, je reste persuadé que je lirai les prochains opus. Mais ne peux subjectivement prétendre avoir vécu une superbe expérience de lecture. Disons que c’est une histoire passionnante malgré la forme. Je suis impatient de savoir comment les diverses forces en présence se positionneront à la suite des évènements qui concluent ce tome et j’anticipe, malheureusement, de devoir faire un effort de lecture et de compréhension pour aller au-delà d’une forme lourde et volontairement obscurantiste.

 De
De 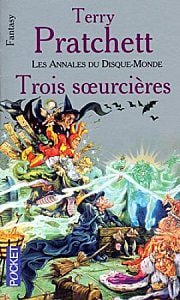 De Terry Pratchett, 1988.
De Terry Pratchett, 1988. De
De 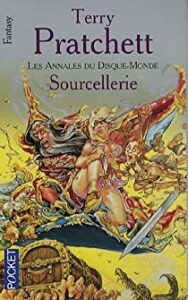 De
De