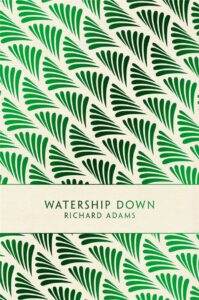 De Richard Adams, 1972.
De Richard Adams, 1972.
La fantasy animalière est une grande spécialité anglo-saxonne. Entre Le Vent dans les saules, que nous avons déjà abordé ici, les livres de Beatrix Potter ou encore la saga Rougemuraille de Brian Jacques, cette branche particulière de la fantasy a livré au fil de son siècle d’existence quelques chefs-d’œuvre. L’on pourrait argumenter que la tradition des récits animaliers date d’avant le début du XXème, puisque La Fontaine en abusait par exemple dans ses fables. Mais le principe du récit, construit, complexe, et qui n’appartient plus tout à fait au genre du conte ou de l’allégorie simple, n’en déplaise à Orwell et à sa Ferme aux animaux, date quant à lui bien du début du siècle précédent (voir un peu avant, avec Le Livre de la jungle, de Rudyard Kipling, qui date de 1894). Richard Adams inscrit donc son premier et plus fameux roman dans une tradition littéraire finalement assez récente (moins d’une centaine d’année est assez court, pour un genre littéraire) et, jusqu’alors, essentiellement orientée vers un public enfantin.
Le défi était donc grand, pour Adams, de faire éditer un premier roman à plus de 50 ans mettant en scène une bande de lapins dans la campagne anglaise. Adams, vétéran de la seconde guerre mondiale et haut fonctionnaire britannique, s’est découvert une carrière d’écrivain sur le tard, sous la pression de ses deux filles pour lesquelles il avait inventé l’histoire de Hazel et Fyveer lors d’un trop long voyage. Rien ne le prédestinait réellement à prendre la plume, ce qu’il fit cependant pour laisser une version écrite de son récit à ses filles pour leur faire plaisir. Dix-huit mois de rédaction nocturne plus tard, Watership Down voyait le jour. Refusé par de nombreux éditeurs, qui voyaient mal comment vendre ce récit à un jeune public alors que le ton et le style étaient résolument adultes, le roman devait encore sommeiller quelque temps avant d’être finalement publié en 1972.
54 millions d’exemplaires plus tard, trois adaptations animées (deux longs métrages, une série télé) réalisées entretemps, Watership Down est devenu un classique moderne, aimé par une armada de lecteurs qui le découvrirent dans leur enfance, s’émerveillant de la nature anglaise et tremblant face aux menaces rencontrées par le lapin Hazel et ses semblables. C’est l’un de ces classiques anglais à ranger aux côtés du Hobbit, du Vent dans les saules ou encore des Chroniques de Narnia. Ce ne serait cependant pas lui faire totalement justice : bien qu’inventé pour ses propres filles, Adams n’a pas écrit un livre pour enfants. Watership Down est un roman assez sombre où les protagonistes ne s’en sortent pas toujours. Le monde qui les entoure est violent et la guerre qui les menace n’est pas un pantomime : les chats, les chiens, les renards ou encore les garennes adverses sont autant de dangers mortels pour les protagonistes principaux.
Il serait donc plus juste, pour s’embarquer dans un parallèle boiteux avec l’œuvre de Tolkien, de comparer Watership Down au Seigneur des Anneaux, là ou Le Vent dans les saules est l’équivalent du Hobbit. Le parallèle est boiteux comme je le disais, cependant, car Watership Down n’a pas l’ambition épique, voire mythique, du grand œuvre de notre philologue préféré. Watership Down est plus simplement une histoire d’exil et de survie. Une ode à la nature, dans ce qu’elle a de plus beau et de plus cruel à la fois. Le roman s’ouvre sur une « vision » de Fyveer, le frère malingre de Hazel, le lapin/personnage principal du roman. Fyveer voit leur garenne détruite par des humains dans les jours qui viennent et presse son frère de prendre le chemin de l’exil pour s’établir ailleurs. Rejeté par le chef de son clan, Hazel parvient à convaincre quelques lapins de sa garenne de s’enfuir pendant qu’il est encore temps. S’ouvre alors une longue période d’errance, amenant Hazel et les siens, le puissant Bigwig, le sage Holyn et bien d’autres encore, à chercher un nouveau foyer et à affronter nombre de dangers. Ils devront faire face à des environnements étranges et méconnus, à des prédateurs belliqueux et surtout à des garennes rivales qui s’organisent en un culte étrange ou en une tyrannie absolue. Jusqu’à trouver leur nouveau territoire, leur garenne : Watership Down, qu’ils devront aménager et défendre contre les menaces extérieures. Ces nombreux développements leur apporteront de nouveaux alliés, comme la mouette Keehar, et, surtout, une expérience et une sagesse plus grandes qui leur éviteront de prendre de mauvaises décisions. Je vous épargne davantage de détails sur l’histoire en elle-même pour ne pas vous gâcher le plaisir de lecture.
La première chose qui frappe, une fois la dernière page de Watership Down tournée, est sans doute de se dire que nous avons été tenus en haleine pendant plus de 500 pages (d’un texte fort dense) avec une histoire de lapins des prés. Adams a construit un récit balancé et équilibré qui pousse le lecteur à trembler avec ces rongeurs angoissés que sont les lapins de garenne. Et c’est un véritable exploit. Chacun d’entre eux a une personnalité bien marquée, complexe, et possède un arc narratif qui le fait évoluer au fil des aventures. Adams a développé par ailleurs un langage particulier que les lapins utilisent pour certains concepts essentiels dans leur culture ainsi qu’une mythologie propre que les lapins se racontent au fond de leur terrier. Cette mythologie, construite autours du lapin héroïque Shraavilshâ, le malin père de leur race, ressemble davantage aux récits mythologiques indiens qu’à ceux issus des cultures germanique ou scandinave comme on les rencontre plus souvent dans la fantasy britannique. J’y vois peut-être une influence du fait qu’Adams fut envoyé sur le front pacifique pendant la seconde guerre mondiale, où il a pu découvrir le Mahabharata ou le Panchatantra, dont les « fables » ressemblent fort à celles qu’il invente dans sa cosmogonie lapine. On retrouvera bien sûr aussi l’influence de son expérience martiale dans la description du siège de Watership Down ou des diverses batailles qui émaillent le récit. En filigrane, on lit également l’engagement d’Adams dans la préservation de l’environnement, dans la glorification d’une certaine idée de l’Angleterre rurale qu’il partage avec Tolkien également (Adams a par ailleurs commencé sa carrière administrative comme assistant du Ministre de l’Environnement !)
Watership Down mérite parfaitement son aura de classique moderne. A l’instar du Vent dans les saules qui m’avait également marqué en 2020, je suis heureux d’avoir maintenant lu ce roman qui fait partie de la culture anglo-saxonne. De fait, bien que le roman ai été traduit et publié en français en 1976, et réédité en poche en 1986, le roman était largement oublié dans nos contrée ces dernières décennies. La nouvelle adaptation par la BBC et Netflix en 2018 nous a remis le livre en mémoire, mais c’est surtout l’excellente idée des toujours inspirées éditions de Monsieur Toussaint Louverture de rééditer le bouquin en 2016, puis dans une version illustrée en 2018 (et en poche en 2020) qui a permis à une nouvelle génération de lecteurs francophones de redécouvrir cet excellent roman. Bien que j’eusse acheté la version de 2016, j’ai finalement lu le roman dans sa réédition dans la collection « Les grands animaux » de Monsieur Toussaint Louverture, dont j’apprécie les couvertures stylisées, le format semi-poche et le grammage du papier qui en font une expérience physique de lecture très agréable et plus pratique que leurs grands formats. Et pour le prix très modeste de 12,50 €, il n’y a _vraiment_ aucune raison d’hésiter. Jetez-vous dessus, vous ne serez pas déçu du voyage.

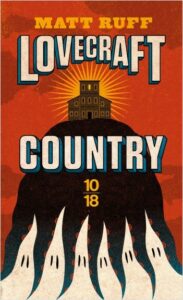 De
De 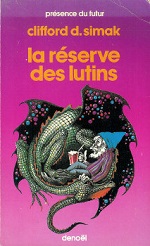 De Clifford D. Simak, 1968.
De Clifford D. Simak, 1968.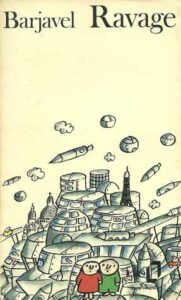 De
De 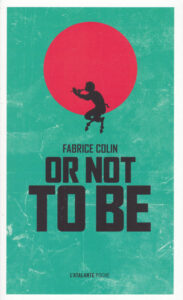 De
De