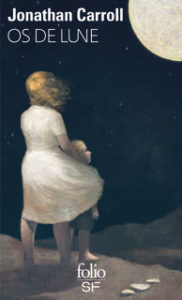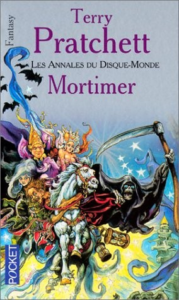 De Terry Pratchett, 1987.
De Terry Pratchett, 1987.
Pratchett trouve son rythme de croisière. A partir de 1987, il signera pratiquement deux tomes des annales du Disque-monde par an. Alors qu’il ouvrait le chapitre des sorcières avec le précédent opus, il choisit de prendre nul autre que la Mort comme personnage principal dans ce tome, qui aura droit à d’autres opus plus tard dans la série. Enfin… pas tout à fait la Mort. Celle-ci ayant un gros coup de blues professionnel (un burn-out avant l’heure), elle décide de se mettre au frais et de découvrir les petits plaisirs de l’existence qui semblent diriger la vie de humain à laquelle il met un terme depuis de longs siècles (millénaires ?) Mais, le travail n’attendant pas et étant un peu le seul qualifié pour accompagner les mourants à faire le dernier pas, la Mort est obligée de se trouver un remplaçant.
Et quel meilleur remplaçant que Mortimer ? Ce brave jeune homme, paysan des campagnes reculées du Disque-Monde, est un grand mystère pour son père. Adolescent ayant grandi trop vite, il a non seulement deux mains gauches, mais aussi deux pieds gauches. Du coup, son père est trop content de le laisser en apprentissage chez ce grand type tout maigre avec une voix d’outre-tombe : personne d’autre n’en voulait à la foire du village local. Et Mortimer de suivre son nouveau maître et de découvrir un métier bien particulier…
Pratchett continue donc à développer son monde imaginaire en y ajoutant une nouvelle bordée de personnages aussi gauches et déplacés qu’attachants. La fille adoptive de la Mort, avec son surpoids et ses airs de princesse, est un personnage qui peut sembler détestable au début mais qui se révèle en fait être vraiment sympathique eu attachante. Même chose pour Mortimer, pour la Mort ou encore pour leur vieux cuisinier (bon, faut pas trop l’ennuyez, quoi). Ajoutez à cela une histoire d’amour improbable et un problème d’équilibre entre les lois naturelles et l’intervention divine de Mortimer et vous avez le terreau adéquat pour une aventure de fantasy aussi épique qu’hilarante.
Car au-delà du comique de situation, Mortimer, plus encore que La huitième fille (qui souffrait d’un rythme un peu inégal et qui mettait fort longtemps à entrer dans le vif de son sujet), raconte réellement une histoire, avec un début, un développement et une fin. C’est en cela qu’on comprend que Pratchett, d’amateur de gags doté d’un certain sens de la formule, se transforme au fil des tomes en véritable conteur. Il y a, dans ce 4ème opus, un véritable moteur narratif qui ne ressemble pas à une succession de tableaux ou à un deus ex machina improbable. Le récit, bien que partant d’une situation abracadabrantesque (quid si la Mort en a marre de son boulot ?), parvient à accrocher le lecteur par son développement intrinsèque. Et, comme toujours, on ne peut que se rendre à l’évidence : Pratchett adore les désaxés, les inadéquats, les anti-héros qui n’ont pas de bol. Ce qui les rend particulièrement attachants pour le geeks comme nous. Et si Rincevent tombait dans la caricature, Mortimer est plus humain et, donc, plus intéressant à suivre.
Un très bon quatrième tome, donc, qui augure des suites toujours mieux écrites, mieux maîtrisées et plus passionnantes. Pourvu que ça dure ! Notez également que si la lecture des volumes précédents peut aider pour comprendre le monde dans lequel l’action se passe, le volume peut se lire indépendamment de la série sans poser trop de soucis. Bien sûr, les caméos échapperont au néophyte, mais le tout reste drôle, touchant et passionnant. Foncez !

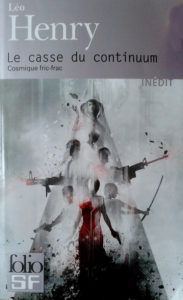 Sous-titré Comsic fric-frac
Sous-titré Comsic fric-frac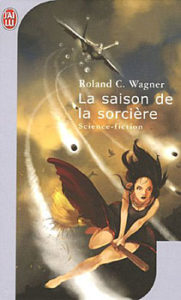 De
De 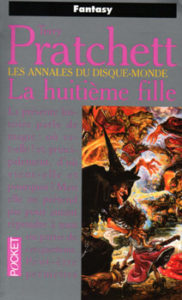 De Terry Pratchett, 1987.
De Terry Pratchett, 1987.